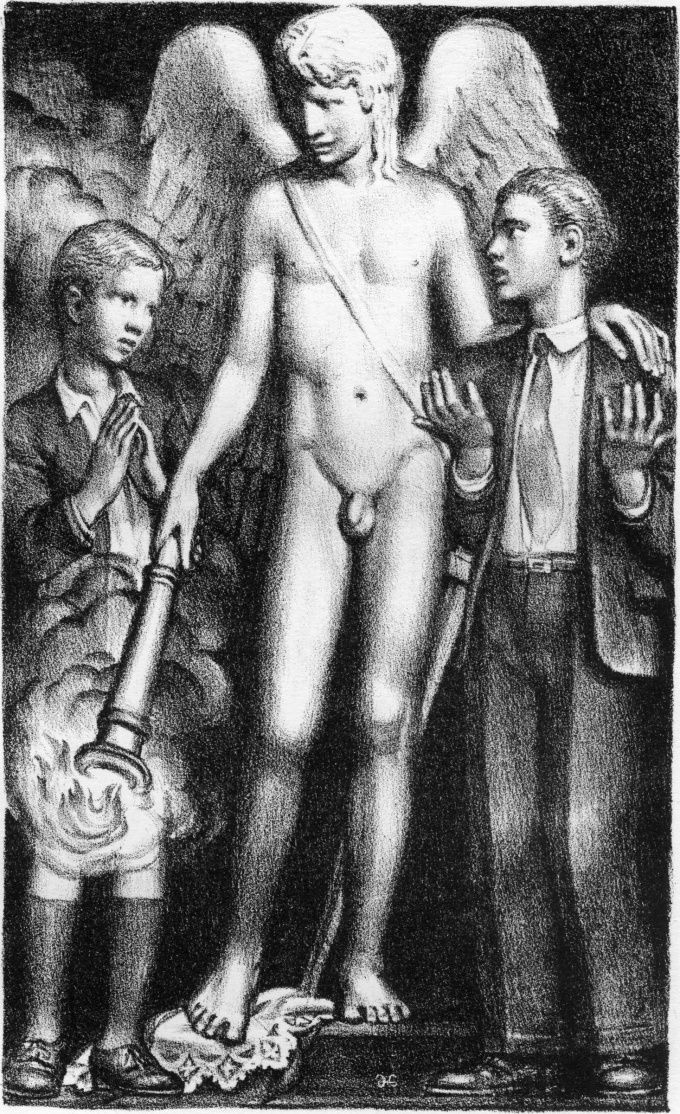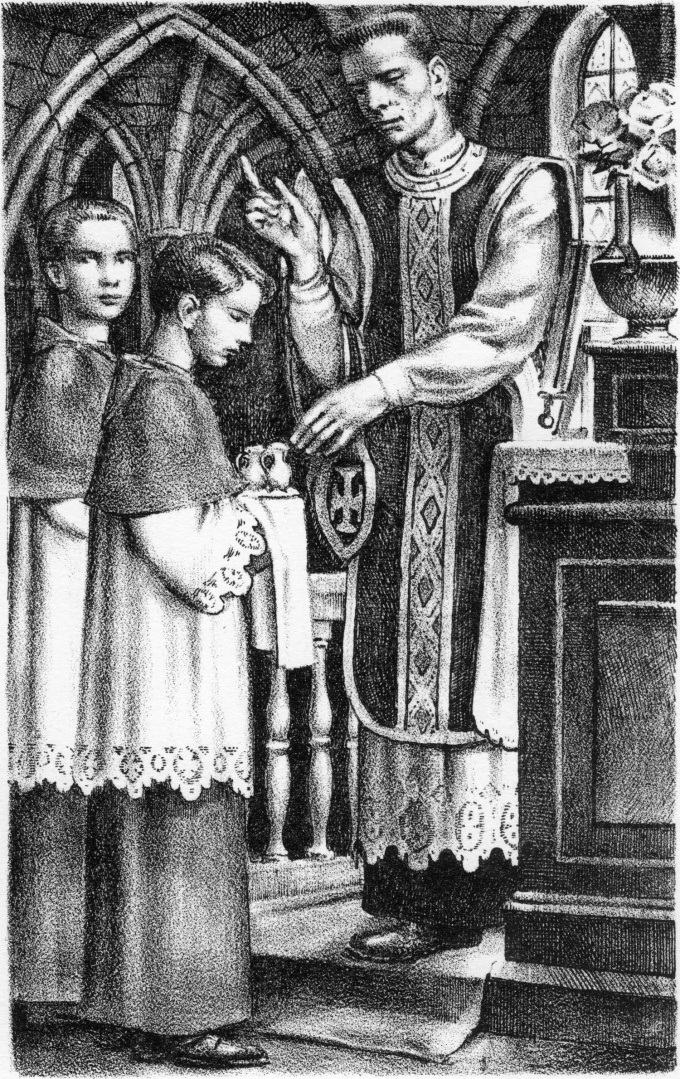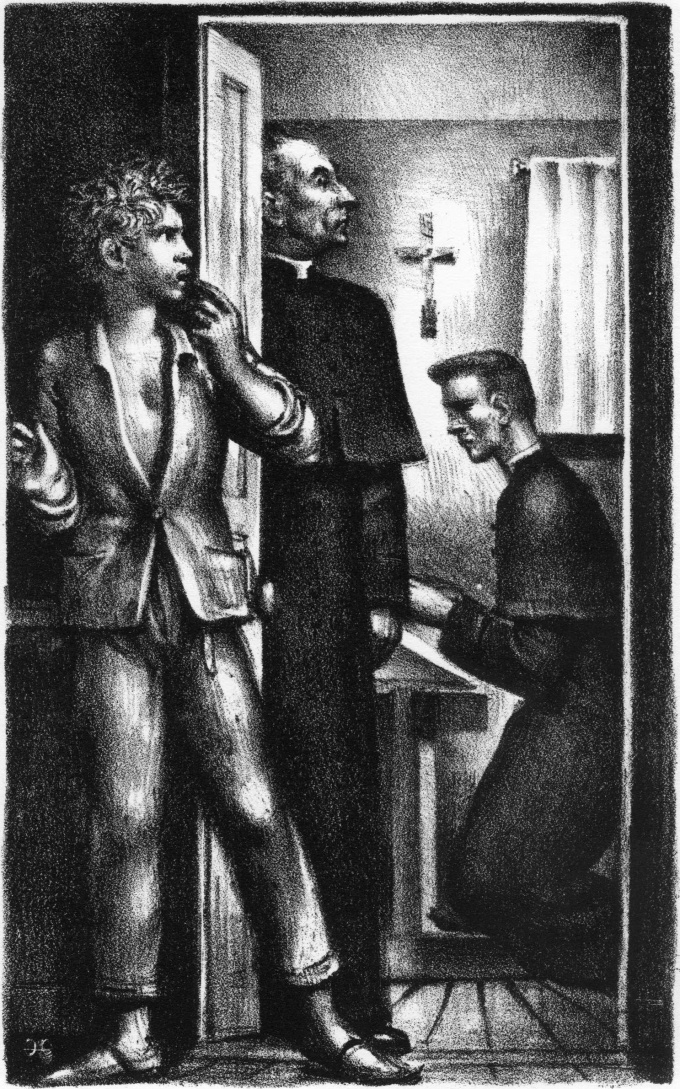Les amitiés particulières (texte intégral) – 3
La troisième partie du roman de Roger Peyrefitte Les amitiés particulières raconte les vacances de Pâques et le début du troisième trimestre de Georges de Sarre au collège Saint-Claude, du mardi 11 avril au vendredi 19 mai.
Ce soir-là, pendant qu’on était au salon, Georges demanda à son père de lui laisser admirer de plus près la monnaie d’Alexandre — le médaillier était fermé. Il parla de son travail sur la Grèce, qui avait contribué à son élection académique. Il dit qu’il s’était souvenu de cette pièce d’or afin de mieux évoquer le passé de ce pays.
Il prit le petit disque lourd avec respect. Il contemplait cette effigie, que le contact de sa peau réchauffait doucement, comme la médaille que l’enfant portait au cou. Les contours en étaient inégaux : ils avaient été rognés, lui dit son père, par quelque antique Harpagon. Mais le profil du héros était d’une intacte fraîcheur ; il avait défié le temps et les hommes, avec son casque empanaché. Au revers, était la figure de la Victoire, dont une des ailes semblait soutenue par le nom d’Alexandre. Ces présages n’étaient pas moins favorables que ceux de l’Amour de Thespies.
« La pièce, dit M. de Sarre, qui s’appelle un statère, est vraiment à fleur de coin : elle garde Alexandre dans sa fleur pour l’éternité. »
Ces paroles firent à Georges un plaisir délicieux. Il embrassa son père tout à fait gentiment — qui aurait pu dire si c’était là un saint baiser ?
Il décida de faire aussi une collection, quand il serait grand, et elle serait consacrée à cet Alexandre qui avait illustré le nom de son jeune ami : il y aurait non seulement des monnaies, mais des bustes, des tapisseries, des tableaux, des estampes, tous les ouvrages écrits sur lui. Il s’y ruinerait. Ce serait son monument. Le culte du Saint Nom de Jésus n’avait jamais inspiré autant de ferveur à Lucien que Georges n’en aurait pour le Beau Nom d’Alexandre.
Sa principale occupation était, chaque jour, de surveiller le courrier. Entre les passages du facteur, il sortait pour tâcher de se distraire. Il allait à bicyclette ou à ses leçons d’escrime, ou à la piscine, ou en canot sur la rivière. Il ne se sentait plus le goût de rester à la maison. La lecture, qui était autrefois son occupation favorite, ne lui disait rien, tant qu’il n’aurait pas lu le message qu’il espérait. Il avait emprunté à la bibliothèque paternelle La Pécheresse de Henri de Régnier, en mettant un autre livre à la place, suivant son habitude. Ce roman ne retint pas plus son attention que si c’eût été la vie de saint Jean-François Régis.
Une lettre arriva : elle n’était que de Lucien. Celui-ci disait avoir, cette fois, écrit le premier à André, qui ne pourrait lui faire de reproches. Il venait de lire Thaïs, et partageait l’ancienne admiration de Georges, bien que quelques passages l’eussent ennuyé.
Est-il possible, écrivait-il, que j’aie lu, aux dernières vacances, « L’aimable Jésus », traduit de l’espagnol ?
Il n’offrait plus ses services auprès de l’oncle astrologue, car Georges avait déclaré que les horoscopes l’intéressaient aussi peu que les indulgences.
On reçut ensuite le bulletin trimestriel. À l’article « Observations », le supérieur avait écrit : « Très bon élève », mais il avait fait suivre ces mots de trois points de suspension, qui parurent à Georges pleins de sens. Ses parents n’y prirent pas garde. En revanche, ses cousines, qui étaient arrivées ce jour-là, ne manquèrent pas, dans le particulier, de lui en parler avec malice. Elles se montrèrent curieuses des mystères de son collège.
« Tout ce que je puis vous en dire, répliqua Georges, c’est qu’ils ressemblent à ceux de Mithra (voyez dictionnaire) : les femmes en sont exclues.
— Moins peut-être que tu ne l’avoues, répondit Liliane : les uns pensent à elles, les autres les remplacent. »
Ce mot agaça Georges, et il décida de le faire expier à sa cousine en se montrant insupportable. Il savait bien d’ailleurs que, pour lui, Alexandre ne remplaçait personne et ne pouvait être remplacé par personne. Et c’est toujours à Alexandre qu’il pensait.
Le silence de l’enfant commençait à l’inquiéter. Il se demandait si l’affaire du billet, même réglée au collège, n’avait pas eu de suites dans sa famille. Il comptait sur la bonne foi de son protecteur, le père Lauzon, mais craignait que le supérieur ne se fût pas contenté de quelques points de suspension dans son bulletin.
Il souffrait beaucoup de ne pouvoir écrire lui-même à Alexandre. Celui-ci avait eu probablement ses motifs pour le prier de s’en abstenir. À titre de compensation, Georges envoya une courte missive à Maurice et à Blajan, comme aux vacances de Noël. Il avait été tenté de leur réclamer des nouvelles de leurs dulcinées, mais ne voulut pas donner raison à Liliane, même indirectement. Il voulait encore moins qu’Alexandre pût questionner Maurice à ce sujet, si ce dernier lui montrait cette lettre.
Le soir du mardi de Pâques, Georges accompagna ses cousines à la gare, bien content d’être débarrassé de leur présence. Elles avaient prétendu qu’il était tout changé, qu’il ne se plaisait qu’à rester seul, que l’internat faisait d’un joli ourson un ours mal léché. Et il leur avait répliqué en leur citant des titres de l’Imitation, retenus des dernières lectures au réfectoire : « Qu’il faut éviter la trop grande familiarité dans le commerce du monde… », « Qu’il faut éviter les entretiens inutiles…, aimer la retraite et le silence…, supporter les défauts d’autrui… »
En rentrant, il trouva à son nom, sur le plateau, une carte postale qui semblait avoir attendu le départ des cousines pour arriver. Il n’y avait que ces mots :
Toujours. Alexandre.
Ravi, Georges monta s’enfermer dans sa chambre afin de rêver à son aise.
Certes, il aurait souhaité en lire davantage, mais il avait une imagination qui lui permettait de paraphraser cet heureux laconisme. Il lui parut que l’essentiel avait été dit par un nom qui soutenait l’Éternité, comme, sur la monnaie, il soutenait la Victoire. L’enfant lui donnait tout ce qui lui importait en se donnant pour toujours à lui.
Georges prenait plaisir à voir son propre nom et sa simple adresse tracés en regard par la main d’Alexandre, d’une écriture plus fière, plus ferme et plus élégante encore que celle des billets. Il se jugeait aujourd’hui en possession valable de ce nom et de cette adresse, qui jamais ne lui avaient été si bien confirmés.
Il aima trouver un sens jusque dans l’illustration : « S… Vue de la gare. » L’enfant ne lui faisait-il pas entendre que, de sa résidence, seule la gare offrait quelque intérêt, puisqu’elle allait les rapprocher bientôt l’un de l’autre ?
À présent, Georges était tout heureux. Ses craintes l’avaient quitté : s’il y avait eu un orage chez Alexandre, ce n’avait pas dû être grave. Cette idée le réconcilia avec ses parents, à qui il en avait voulu d’être des parents, lorsqu’il supposait Alexandre persécuté par les siens. Au dîner, on le félicita d’être moins maussade.
Quand il fut couché, il reprit la carte qu’il avait mise à sa portée. Ici, ce n’était plus comme au dortoir, où il fallait lire avec une lampe de poche, dissimulé sous les draps. Librement, en pleine lumière, remparé de son oreiller, il relut les billets de l’enfant et le cantique interprété. Il replaça tous ces messages sur la table de chevet, avec la mèche de cheveux, et il dressa près d’eux, au pied de la lampe, l’image de l’Amour de Thespies. Demain, il écrirait une lettre charmante au père Lauzon.
Après son petit déjeuner, il remit les billets dans son portefeuille. Le soleil, qui éclairait la chambre, fit miroiter la boucle, que Georges s’apprêtait également à renfermer. Il la détacha du papier collant, pour mieux en voir jouer les reflets, et la posa dans le creux de sa main. Elle était du même or que la monnaie du médaillier, et lui parut presque aussi lourde : n’était-elle pas le symbole de la petite tête dorée ? Il se rappelait la première fois qu’il avait aperçu au soleil les cheveux d’Alexandre, dans la cour du collège, un dimanche de février. Prenant la boucle, il l’arrangea sur la tête de l’Amour, qui soudain sembla vivante. Il laissa les choses ainsi, et alla faire sa toilette.
Il pensait à cette boucle en se peignant. Ces cheveux blonds étaient infiniment plus beaux que ceux de sa cousine Liliane, à qui il disait, pour la faire enrager, que sûrement elle se faisait teindre. Il se demanda comment il serait lui-même s’il se teignait en blond. Sa peau mate, ses yeux marron s’accorderaient assez peu avec une couleur aussi claire. Enfin, l’idée de se teindre n’était-elle pas ridicule et indigne d’un homme ? Georges se plut à en retenir quelque chose. Il songeait à ces garçons qui avaient une mèche de leurs cheveux d’une autre nuance, comme certains de ses camarades à Saint-Claude : il s’inspirerait de cette fantaisie de la nature en vue de rendre à Alexandre un hommage original.
Ne voulant pas acheter dans son quartier les ingrédients nécessaires, il prit sa bicyclette afin d’aller plus loin. Une boutique dont le patron était le seul occupent, lui parut mériter sa confiance. Il demanda une teinture pour cheveux blonds.
« Il y en a de quatre nuances, dit le coiffeur. Désirez-vous blond doré, blond cendré, blond clair, ou blond ? »
Georges était embarrassé. Il se souvint tout à coup que la mèche était dans son portefeuille. Se détournant, il la retira de la poche de cuir, où elle voisinait avec l’image de Thespies, et la fit voir au coiffeur.
« Permettez que je l’examine », dit celui-ci en la prenant.
Cet homme, dont le métier était pourtant de toucher des cheveux, ne commettait-il pas une violence en touchant ces cheveux-là ?
« Ils sont blond cendré », dit-il.
Et il allait jeter la boucle, mais on la lui reprit d’un geste empressé. Georges vit tomber quelques cheveux, avec plus d’émotion qu’il n’avait vu tomber, chez le supérieur, la barbe d’Anatole France.
Il les aurait ramassés, si l’amour-propre l’eût permis.
« Quand on possède des cheveux blonds aussi fins, dit le coiffeur, les premiers cheveux blancs ne doivent guère se remarquer, et un peu d’eau oxygénée suffit d’ordinaire à les blondir. »
Les premiers cheveux blancs ? Alexandre avec des cheveux blancs ! Pour cette idée bouffonne, Georges pardonnait au coiffeur.
« Je ne comprends pas, dit-il en souriant.
— Il s’agit bien d’une personne blonde qui désire teindre ses cheveux blancs ?
— Mais pas du tout ! Il s’agit d’une personne brune qui désire se teindre en blond, de la nuance des cheveux que je vous ai montrés.
— Ah ! bien ! nous y voici ! Cela ne s’appelle pas se teindre, mais se décolorer. C’est une opération délicate, qui doit être faite par un coiffeur.
— La personne en question tient à en faire l’essai chez elle, sur une mèche de cheveux.
— Dans ce cas, je vais vous donner un produit de ma composition. Cette personne n’aura qu’à se mouiller les cheveux avec un morceau de coton imbibé de ce liquide. Qu’elle procède soigneusement, en partant de la racine. »
Georges filait sur sa bicyclette. De temps en temps, il touchait le flacon dans sa poche, pour être sûr que le bouchon tenait bien. Il pensait à sa conversation avec le perruquier, et s’amusait du : « Nous y voici ! » Quel véritable interrogatoire ! À travers tout le dédale de l’art capillaire, on était parvenu enfin à la vérité.
Installé devant le miroir de sa chambre, Georges se demanda de quel côté il allait se teindre : à droite ou à gauche ? ou au milieu ? Il choisit à gauche, du côté du cœur. Il dégagea une mèche, assez longue pour qu’elle pût tomber sur son front, comme celle qui voilait parfois les yeux d’Alexandre, et suivit les prescriptions.
C’était la première fois de sa vie qu’il avait apporté une transformation à son être. Cette blondeur ne lui messeyait pas. La nuance était bien celle des cheveux d’Alexandre, auxquels il la compara. Mais il regrettait la facilité vulgaire avec laquelle il venait d’obtenir ce qu’il avait cru, chez l’enfant, un miracle inimitable. Il se peigna, recouvrant la mèche blonde sous ses cheveux foncés. On n’en voyait que la pointe, comme celle d’une flèche.
Pendant le repas, sa mère remarqua cette petite singularité. Georges expliqua l’accident par une malencontreuse recette de shampooing à l’eau oxygénée. Ses cousines n’auraient pas été si aisément satisfaites. La blonde Liliane n’avait aucune raison de se persuader que ce fût une allusion flatteuse à son égard. Cette mèche, symbole d’un autre visage, aurait été à ses yeux un nouvel indice de ce qu’elle appelait « la grande métamorphose des petits internes ».
Georges, en effet, était bien changé, plus que par une mèche, plus qu’Alexandre n’avait semblé l’être au père Lauzon. Ce qu’il trouvait à la maison n’était que le passé. Pour lui, le présent et l’avenir étaient ailleurs. Alexandre le laissait indifférent à tout, parce qu’Alexandre était plus que tout. La carte d’hier ne lui avait rendu le goût de rien, parce que, sans cette présence qui lui manquait, il n’y avait rien. Il comprenait la valeur de l’affection qu’il avait nourrie de sa moelle : la vue de celui qui en était l’objet était nécessaire à son équilibre physique et moral. Il ne recommencerait à vivre qu’à son retour au collège, quoique ce fût pour vivre en marge du collège. C’est en dehors de la vie de famille, aussi bien que de la vie de collège, qu’il avait désormais sa vraie vie : suivant les termes d’un de ses billets, Alexandre était devenu sa vie.
C’est également afin de mieux se donner l’illusion d’être avec lui qu’il se plaisait à être seul, suivant la remarque de ses cousines. D’ailleurs, il le possédait si bien qu’il ne craignait pas de le perdre. Les autres ne paraissaient plus exister qu’en vue de le rappeler indirectement, d’une façon quelconque. À table, par exemple, quand il était question du collège, de l’académie, du supérieur, du cardinal, c’était le visage bien-aimé qui venait se profiler, comme si tout ce qui l’avait approché se réduisait à lui. Georges ouvrait doucement la main sur la nappe, la paume en haut, et il croyait contempler encore le statère ou la boucle blonde. Au salon, il n’osait pas redemander la clef du médaillier, de peur d’attirer l’attention sur son secret. Il se contentait de s’appuyer à la glace, et d’y déposer, au-dessus d’Alexandre, la couronne éphémère d’un baiser. De nouvelles évocations lui étaient fournies par un des objets de collection qui ornaient cette pièce : c’était un encensoir d’argent, travail du xviie siècle, qui lui remémorait l’encensement d’Alexandre. Il en soulevait le bonnet et, de la coupe vide, s’élevait une légère odeur d’encens qu’il respirait avec délices, — il la mêlait dans son souvenir à celle de la lavande qui avait longtemps imprégné la boucle. L’or et l’argent, l’encens et le parfum, n’était-ce pas ce qu’il offrait à Alexandre le jour de l’Épiphanie, le premier dimanche où ils avaient été face à face, le dimanche des Rois ?
Le 22 avril, au dernier courrier, comme celui qui avait apporté la carte, arriva enfin une lettre d’Alexandre. Georges, enivré de joie, se demanda où il en ferait la lecture. Il avait déjà utilisé sa chambre pour lire la carte. Au salon, sa mère recevait des visites. Il se rendit au bureau, où il n’y avait personne, et se plongea dans un fauteuil de cuir.
Il engagea un doigt sous le pli de l’enveloppe, mais songea que c’était un moyen bien peu noble d’ouvrir la première enveloppe d’Alexandre. L’idée de la voir hérissée de déchirures lui fut désagréable. Il se leva afin de prendre un coupe-papier : c’était celui du supérieur qu’il aurait fallu, celui de l’académie, avec l’inscription : « Dieu et la France. » Il choisit le plus beau. La lettre le méritait bien : six grandes pages ! Cela rachetait la brièveté de la carte. Avant de lire, Georges passa la main sur ses cheveux et tira ses chaussettes, qui étaient plissées.
Mon cher Georges,
Je me suis juré d’y arriver, et j’y arrive, je t’arrive. Mais, vraiment, je commençais à désespérer de pouvoir t’écrire une vraie lettre, et à temps pour le 23, en l’honneur de ta fête. Tous mes vœux, mes tendres vœux. Que saint Georges nous protège plus efficacement que saint Alexandre ! Maintenant, nos deux patrons se sont rejoints et ils pourront mieux faire.
Au collège, tu as compris, n’est-ce pas ? que l’on m’avait privé de liberté. D’après les ordres de Lauzon, le surveillant ne me laisse plus sortir seul durant les études. J’ai réussi à t’apporter mon cantique dans l’intervalle de deux classes.
Ici, les choses sont pires encore. D’abord, Lauzon — toujours lui ! — m’a donné à faire un cahier de vacances — cahier spirituel, pascal, tout ce que tu voudras — dans le genre des cahiers de retraite. C’était un nouveau prétexte pour me serrer de près et me faire la morale régulièrement. Ensuite, arrive le bulletin, où le supérieur a eu la « vacherie » de mettre cette observation : « A passé par une petite crise. » Cela m’a rappelé la « tare » du préfet. Crise et tare vont ensemble. Mon père m’a dit que Lauzon l’avait déjà renseigné, et il n’a pas été trop méchant. Il s’est contenté d’un petit « speech » qui a porté sur les sentiments permis et sur les sentiments défendus ; puis, en qualité de médecin, il a repris à sa manière les propos de mon directeur concernant les mauvaises pensées, mais les a nommées « mauvaises habitudes ». Pauvres gens, avec leur mal ! En tout cas, sous prétexte de ceci ou de cela, je suis épié à chaque instant, et dois prendre garde. Enfin, on m’oblige à voir d’anciens camarades, à faire partie d’un patronage, etc., de manière que je ne reste jamais seul, ici comme là-bas. C’est pourquoi je n’ai pu t’envoyer qu’une carte, pendant un entracte au « Bon Cinéma ».
Voilà qu’aujourd’hui, avant-veille de ta fête, Lauzon m’emmène en promenade. Bientôt il me dit avoir reçu une lettre de toi, extrêmement édifiante. C’était la première fois qu’il prononçait ton nom depuis notre rencontre devant son bureau. Cela m’a causé un tel plaisir que je décidai à l’instant de me réconcilier avec lui, car je lui avais fait grise mine jusqu’alors. Mais, pour me venger de toutes ses tracasseries, j’ai voulu rire un peu à ses dépens, et je lui ai raconté que j’étais à présent terrassé par la Providence, ainsi que Saul le fut sur le chemin de Damas. Je me figurais t’entendre parler à ma place, mais j’étais inquiet, craignant d’avoir exagéré. Pas du tout ! Je vois mon homme ravi, comme s’il n’avait attendu que cela. Et de me dire qu’il n’a jamais douté de moi, qu’il me rend sa confiance, que ma conduite en vacances l’a — bien malgré moi — rassuré, que c’était le plus dangereux à passer, et que c’est fait. « Au collège, ajouta-t-il, les choses iront désormais sans difficultés. » — « Je l’espère aussi », ai-je répondu. Là-dessus, nous entrons dans une église afin de réciter une « prière d’encouragement et de reconnaissance ». Après quoi, il me laisse revenir à la maison. Par miracle, il n’y a personne, et j’en profite aussitôt. Tu vois tout ce qu’il a fallu.
La nuit, en effet, je ne peux t’écrire, parce que je couche dans la même chambre que Maurice. Il m’a avoué qu’il avait été chargé par Lauzon de surveiller si j’avais une correspondance secrète. Il cherchait à savoir avec qui ça pouvait être et était très intrigué. Je lui ai dit que c’était avec un bossu.
Sois tranquille au moins pour tes billets. Chaque soir, je glisse le portefeuille sous le traversin. Ta prose et tes vers me disent alors toutes sortes de choses, et j’imagine de longues lettres, que tu ne reçois pas. C’est triste, quand même.
Je prends patience, en ce moment, puisque nous n’avons rien combiné. Et nous n’avons rien eu à combiner, puisque tu as cédé — je veux dire : fait semblant de céder. Excuse cette sorte de reproche, je sais bien que tu n’as pas agi par lâcheté, et aujourd’hui j’ai agi de même, mais je ne recommencerai pas, car il me semble plus beau de tenir tête.
Et pourquoi céderions-nous sans cesse ? Parce que nous sommes des enfants, aurions-nous toujours tort ? Les enfants ne sont-ils pas des êtres vivants ? Seraient-ils les seuls à n’avoir pas le droit d’aimer ? D’ailleurs, avec nous deux, ce sera peine perdue. Il n’y a ni parents ni maîtres qui puissent nous empêcher de nous aimer, mon Bien-Aimé.
P.-S. — Le surlendemain de la rentrée — vendredi, en mémoire de nos chers vendredis — rendez-vous à la serre à six heures. N’importe comment j’y serai.
J’ai acheté un flacon de lavande.
Georges lut ces lignes trois fois de suite, puis il les couvrit de baisers. Son cœur exultait. Il se leva pour mieux goûter le plaisir de vivre. Il sortit sur la terrasse et se promena un moment. Cette lettre, véritable profession de foi, lui inspirait autant d’enthousiasme que celle d’André en avait inspiré à Lucien. Il y retrouvait aussi cette revendication des droits, qu’André avait brièvement posée, ce sentiment de révolte, qu’un jour il avait éprouvé lui-même à l’idée que son amitié pût être soumise au jugement d’autrui. Mais ce qui n’avait été de sa part qu’un mouvement passager, et chez l’ami de Lucien qu’une remarque secondaire, était ici une protestation décisive : Georges la faisait sienne. Maintenant, il aurait bravé le monde.
Quand il fut couché, il plia la lettre en quatre et la mit dans la pochette de son pyjama ; elle resterait sur son cœur pendant son sommeil, comme ses billets reposaient la nuit sous la tête de l’enfant.
Le lendemain, la matinée était si belle que Georges descendit en tenue de nuit faire un tour au jardin. Il se rendit à la serre. C’était le pèlerinage tout indiqué pour la Saint-Georges : la Saint-Alexandre n’avait-elle pas été fêtée à l’intérieur d’une serre ? Il n’y avait pas d’orangers dans celle-ci, mais elle n’était pas moins embaumée que l’autre. Des glycines grimpaient le long des vitres, et des pots de jacinthes garnissaient les étagères.
Georges était heureux d’associer à ces fraîches images l’enfant dont il voulait relire la lettre ici. Sa mère lui avait dit que la glycine représentait, dans le langage des fleurs, la délicatesse en amitié. Et il savait que les jacinthes rappelaient le jeune Hyacinthe, aimé d’Apollon, qui les avait fait naître de son sang. Il cueillit quelques corolles et les glissa dans l’enveloppe de la lettre.
Il s’assit ensuite sous une tonnelle, d’où il apercevait l’escalier. Il lui plut de se figurer que celui dont il rêvait était son hôte et descendait au jardin pour le rejoindre, vêtu d’un pyjama pareil au sien. L’enfant sautait par-dessus les bordures de buis, s’amusait au bassin. Ses cheveux dépeignés tombaient sur ses yeux. Il s’arrêtait près du dieu Terme et lui caressait la barbe. Il s’allongeait au beau milieu de la pelouse, s’y roulait avec délices. Puis il se relevait et venait vers la serre, où Georges l’attendait comme à Saint-Claude. Pensant à leurs rendez-vous furtifs de là-bas, ils riaient de se retrouver en pyjama, dans une serre.
À présent, Georges n’était guère ému par les quelques mots que venait de lui envoyer Maurice : il avait mieux. Toutefois, il ne regrettait que plus vivement de ne pouvoir écrire à Alexandre. Pour tromper le temps, il voulut s’adonner à une entreprise qui lui fût consacrée, en attendant la collection historique qu’il réunirait un jour autour de son nom. Il décida de rassembler en son honneur tous les poèmes relatifs à des enfants, et de les lui dédier, comme à leur coryphée. Cela formerait la couronne d’Alexandre, plus digne du Parnasse que celle de l’Hôtel de Rambouillet. La bibliothèque était assez riche ; Georges avait de quoi chercher : ce serait l’occupation de la fin de ses vacances.
Il commença par les modernes, mais parcourut en vain la table de nombreux ouvrages. Il n’y avait rien de nature à l’intéresser. Son époque ne laisserait-elle à ce sujet que la Prière de l’enfant à son réveil, La joie de la maison, et autres vers pour prédicateurs et bonnes gens, sur « les enfants-encensoirs », les anges du foyer ? Quoi ! les êtres les plus sensibles et les plus beaux n’auraient inspiré que la poésie familiale et la poésie religieuse ! Sans doute, trouverait-on d’autres accents dans les livres de M. de Fersen, où André avait copié, à l’intention de Lucien, des vers assez étranges. Malheureusement, la bibliothèque ne possédait aucun ouvrage de cet auteur peu répandu.
Georges espéra avoir plus de chance avec les anciens. Mais les Grecs n’étaient pas ici très nombreux. Sauf Homère et les tragiques, il n’y avait que des prosateurs, et il n’eut pas l’idée, évidemment, de leur demander assistance.
Rome était mieux représentée. Négligeant Virgile, dont il connaissait les principales églogues, Georges compulsa les traductions des divers poètes et prosateurs latins. Il découvrit beaucoup de choses, trop de choses, surtout dans le Satiricon de Pétrone, ouvrage bien différent de Quo Vadis ? Il aurait voulu être touché et non pas choqué.
En définitive, il ne retint de son rapide examen qu’une courte épigramme, où Catulle se proposait d’embrasser trois cent mille fois et plus encore les yeux de miel de Juventius. Ce serait l’offrande poétique de l’antiquité à Alexandre. « Les yeux de miel… » Il y avait déjà eu les mots de miel dans le chant du Bien-Aimé. L’enfant dirait que l’on dépassait la mesure : on le noyait dans le miel jusqu’aux yeux.
Songeant aux vers de ce chant-là, Georges se sentit gêné qu’Alexandre l’en crût toujours l’auteur et en berçât encore ses songes. Cette duperie qui l’avait d’abord flatté lui devenait pénible. Il avait le devoir de ne dire à Alexandre que la vérité. En lui citant Catulle, il lui parlerait d’Edmond Rostand.
Il avait reçu, entre-temps, une lettre du père Lauzon. C’était, avec les réponses de Blajan et de Maurice, le cinquième message qui, en huit jours, lui serait parvenu de S… On voyait bien que toutes ses batteries étaient tournées de ce côté. Il s’amusa de ces « Je » qui commençaient chaque paragraphe du bon père : ne croirait-on pas vraiment, que ce fût un homme énergique et absolu ?
Cher enfant,
Je vous remercie de votre lettre, à laquelle je n’ai pas voulu répondre plus tôt. Il faut laisser en paix les collégiens en vacances. C’est pourquoi ma lettre sera plutôt une introduction à la rentrée.
Je suis heureux de ce que vous m’écrivez, puisque j’y trouve la preuve que vous n’avez rien perdu de vos bonnes résolutions. Vous avez profité également, je le vois, des avis que je vous ai donnés quant au choix de vos lectures, mais je ne connais pas l’ouvrage dont vous me parlez (« L’aimable Jésus »). D’ailleurs, en cela comme en toutes choses, vous ne sauriez mieux faire que de demander conseil à vos parents. Ce sont eux qui, avec vos maîtres, ont pour mission de vous apprendre prudemment la vie.
Je vous félicite aussi de n’avoir pas oublié que, bientôt, vous alliez être reçu à titre définitif dans la congrégation. Vous avez senti d’avance la portée de cet événement, puisque vous vous efforcez, me dites-vous, de ne pas vous contenter d’une perfection morale trop restreinte.
Je vous prie de croire à mon affectueux dévouement en Jésus-Christ.
P.-S. — J’ai eu, le 23, une pieuse intention pour vous, en célébrant le saint sacrifice de la messe.
Enfin, la rentrée ! Georges aurait désiré emporter la lettre d’Alexandre, mais il estimait préférable de la laisser à la maison, ainsi que les billets : savait-on ce qui pouvait arriver pendant le dernier trimestre ? D’ailleurs, cet acte de prudence le dispenserait de montrer à Lucien un message dont il était jaloux. Celui-ci, en effet, n’avait pas trop insisté à l’endroit des billets, mais risquait de réclamer l’égalité de traitement en ce qui concernait la lettre, puisqu’il avait fait lire celle d’André. Georges lui jurerait en conscience qu’il regrettait infiniment de ne pouvoir le satisfaire.
Il vida un coffret précieux qui était au salon, et le porta dans sa chambre. Il dit à sa mère qu’il voulait y serrer ses tableaux d’honneur, ses petits papiers de collège, et demanda la permission d’en conserver la clef. Sous le précieux dépôt d’Alexandre, il glissa, séparées par un carton, les lettres de Lucien. Dans son portefeuille, il ne garda que la mèche de cheveux. Il la laissa sur l’image de Thespies qui avait reçu le visa du supérieur.
Il ne regagnait pas Saint-Claude par le chemin de fer, comme au mois de janvier. Ses parents le reconduisaient en voiture. Ils étaient surpris de son allégresse.
Pendant la visite, le supérieur n’avait pas commenté les points de suspension du bulletin. M. l’académicien était donc tout à fait rentré en grâce, mais pouvait-il l’être seul ? Sûrement que, pour Alexandre aussi, l’incartade de mars était une affaire close.
Quand il fut libre, Georges parcourut les couloirs, à sa recherche ; mais vainement, et l’heure tardive l’obligea à rejoindre Lucien en récréation. Il bavarda un peu avec Maurice, et, bientôt après, se réjouit d’entendre sonner le salut traditionnel.
Il cherchait des yeux la petite lumière blonde qui, naguère, éclairait là-bas le dernier rang et, dont, aujourd’hui, l’absence l’inquiétait. Il se crut fasciné par sa vision intérieure : Alexandre arrivait dans le chœur, en tête des acolytes, précédant le père Lauzon qui célébrait.
La réparation était complète. C’était le premier miracle de saint Georges et de saint Alexandre réunis. Les hymnes retentissaient d’alléluias : le temps de la Passion était fini.
Parfois, l’enfant souriait, probablement de la bonne surprise qu’il faisait à Georges. Dans l’échancrure de la robe, brillait la cravate rouge, comme leur signe de ralliement. Elle n’était pas assortie seulement à cette robe et à la cravate de Georges, mais à la chape du prêtre et aux ornements du tabernacle : plus encore qu’à la rentrée dernière, tout portait, ce soir, la couleur chère aux deux amis.
Georges regarda dans son missel quelle était la fête : saints Clet et Marcellin, papes et martyrs. Non, rien ne lui parlait du martyre, pas même, comme avant Noël, de celui d’un agneau.
Jamais Alexandre n’avait semblé plus séduisant. Le bonheur resplendissait en lui. Georges, son livre ouvert sur l’accoudoir, fixait les yeux plus loin, là où un point unique les aspirait. Il revoyait ce profil qui valait mieux que celui des gravures et des médailles, mieux que toutes les poésies antiques et modernes, mieux que la gloire et la richesse, mieux que la vie et que l’éternité. Il revoyait cette bouche, à la fois fleur et fruit, ces cheveux dorés, parfumés sans doute à la lavande, cette nuque bien dégagée dans sa courbe élégante, cette oreille rose, si minutieusement découpée.
Ce que Georges aimait en ce moment, ce n’était pas seulement Alexandre ; par lui, à cause de lui, il aimait le collège. Il remerciait le père Lauzon, le supérieur, tous et un chacun. Désormais, personne ne lui semblait à craindre : on ne respirait ici que la bénignité.
Au dortoir, il n’y eut pas de conversation. Le surveillant, qui était nouveau, paraissait plein de zèle. Il ne cessait de faire sa ronde. Quand on ne l’entendait plus, on l’apercevait encore dans un coin ou dans un autre.
S’il perdait, à ce changement, ses bavarderies nocturnes, Georges trouvait pourtant une raison de se consoler : l’ancien surveillant de sa division était transféré chez les petits, remplaçant celui qui s’était montré rigoureux envers Alexandre. L’enfant pourrait donc sortir comme autrefois, puisque, selon toute apparence, le père Lauzon était rassuré et ne renouvellerait pas ses consignes. Quant à Georges lui-même, il se persuadait que le nouveau venu lui serait favorable : il avait bien le droit de compter sur quelqu’un qui s’appelait le père de Trennes. La particule créait entre eux une sorte de lien. Il n’y avait pas beaucoup d’élèves dont le nom en fût orné et, de l’autre côté de la barricade, elle ne signalait jusqu’à présent que le supérieur, le maître de chapelle et le professeur de rhétorique.
Il est vrai que le père de Trennes imposait assez, avec sa haute stature, son visage macéré, ses cheveux en brosse, et ses regards insistants.
Depuis si longtemps séparés, Georges et Alexandre étaient enfin réunis dans la serre. Tout de suite, l’enfant aperçut la mèche blonde que l’on avait mise au jour en son honneur. Il comprit cette allusion galante, car il dit en riant :
« Quelle gentille idée !
— Et aussi, n’est-ce pas, quelle drôle d’idée ! répondit Georges. Au reste, tu vois, ce nouveau secret est facile à cacher. »
Devant son miroir de poche, il arrangea ses cheveux, en dissimulant la longue mèche claire.
« Puisque je ne pouvais t’écrire, dit-il, il me fallait bien faire quelque chose pour te montrer que j’avais pensé à toi. »
Il lui parla ensuite de l’enquête poétique qu’il avait effectuée également à son intention, et lui cita les vers de Catulle à Juventius, sur les quelque trois cent mille baisers. Réflexion faite — moitié par un reste d’amour-propre, moitié pour ne pas avoir l’air de faire un cours de littérature — il ne dit rien d’Edmond Rostand. Qu’importait cela ? Les paroles du Bien-Aimé n’appartenaient plus à leur auteur ni au plagiaire, mais à Alexandre.
« Moi aussi, j’ai pensé à quelque chose, dit l’enfant, quelque chose que nous avions à accomplir : échanger un peu de notre sang, toi et moi. Ainsi nous serons unis pour toujours. »
Il tira un canif de sa poche, retroussa une de ses manches, et se fit au bras une légère incision : quelques gouttes apparurent. Il s’approcha de Georges, afin de les lui faire boire. Puis il lui tendit le canif, et ce fut son tour de goûter au sang. Côte à côte, ils restèrent un moment silencieux, pendant que se cicatrisait la coupure.
Georges était bouleversé par cette scène, dont la rapidité n’avait pas amoindri la valeur à ses yeux. Ses idées lui semblaient bien pauvres, au prix de celles de l’enfant. Il avait honte de son Juventius : il n’aurait pas osé ajouter de vrais baisers à ce que venait de faire Alexandre. Il était surpassé en imagination, mais ne s’en plaignait pas. Il était dans le ravissement d’avoir un tel ami.
Il songeait à Lucien qui avait célébré les mêmes rites avec André. Combien Georges avait regretté d’être arrivé trop tard près de lui, et comme il s’en félicitait maintenant ! C’était une chose qui ne pouvait se faire qu’une fois.
Georges était uni — pour toujours, en effet — à celui qu’il aimait plus qu’il n’avait encore aimé personne. Ils étaient unis, non seulement par des citations et par des baisers, par des billets et par des cheveux blonds, mais par leur propre sang. Ils étaient initiés l’un à l’autre. Chacun avait été prêtre et victime. Leur amitié était devenue une religion, ils l’avaient mise à l’abri des hasards ; ils se l’étaient assimilée à eux-mêmes ; suivant les paroles du cantique, elle se cachait dans leurs blessures.
Dimanche, dernier jour d’avril, à la congrégation, les aspirants se mirent à genoux devant l’autel, un cierge à la main. Le père Lauzon leur posait les questions d’usage, et ils lui répondaient ensemble.
« … Mes enfants, qu’est-ce qui vous amène devant l’autel de Marie ?
— Mon père, c’est le désir ardent d’être reçu dans la congrégation de la Très Sainte Vierge… »
Le père exhorta ensuite les récipiendaires à cultiver les vertus qui doivent distinguer les enfants de Marie, notamment la pureté, et il les déclara admis. Puis ceux-ci récitèrent l’acte de consécration, et le père épingla sur leur poitrine une médaille à ruban vert. Enfin, ils donnèrent aux autres le baiser de paix. Sous le regard du père Lauzon, Georges échangea avec Alexandre impassible un saint baiser.
Ce soir, Lucien et lui avaient résolu de veiller tant qu’il le faudrait pour reprendre leurs petites conversations d’autrefois. Depuis la rentrée, c’est pendant les récréations, faute de pouvoir jaser au dortoir, qu’ils se confiaient leurs secrets. Georges n’était plus aussi exclusif que dans les premiers temps de son amitié avec Alexandre, et déjà avant les vacances, il avait plaisir à entendre Lucien parler d’André. Mais c’est surtout la nuit que ces évocations en commun leur étaient agréables à tous les deux : ils ne voulaient pas s’en priver plus longtemps.
Ils se sentaient moins intimidés par le père de Trennes. On était maintenant renseigné à son sujet, et lui-même semblait ne demander qu’à se familiariser. Ce père était un archéologue, ami du supérieur ; il se reposait ici d’un long séjour dans le Proche-Orient, où le retenaient ses recherches, et avait sollicité ce modeste rôle de surveillant ; c’était sans doute une façon de payer son écot.
Sa distinction était parfaite, sa tenue très soignée. On ne se souvenait pas d’avoir vu à Saint-Claude des soutanes d’une étoffe si fine, des manières à la fois si nobles et si onctueuses, des joues si bien rasées et que voilait toujours un peu de poudre. Cela atténuait la sévérité du premier aspect.
Le père était déjà apprécié des grands élèves, avec qui il aimait à se promener pendant les récréations, en leur racontant ses voyages. Il soignait également sa popularité chez les élèves de quatrième, au milieu desquels il se mêlait dans des parties de ballon — il disait ne pas être assez fort pour leurs aînés. D’ailleurs, malgré le règlement, il ne contraignait personne à jouer, et on remarquait que le préfet n’osait pas intervenir. En étude, il ne refusait jamais aucune permission. C’est seulement au dortoir que, par sa vigilance continuelle, il paraissait décidé à faire régner une stricte discipline. On n’avait qu’à être plus tenace que lui.
Georges vit enfin la lumière s’éteindre dans la chambre du père — le rideau noir n’était pas bien tiré. Il appela Lucien qui somnolait. De manière à parler aussi discrètement que possible, ils avaient rapproché leurs lits avant de se coucher. Georges avait préparé une brillante rentrée en scène. Il découvrait sa poitrine et montra sa médaille de congréganiste, qu’il avait épinglée à son pyjama. Lucien étouffa un éclat de rire.
« Tu as oublié le temps où tu me faisais voir tes scapulaires, dit Georges. Mais ce n’est pas toi que je copie : c’est un de mes oncles, qui porte la brochette de ses décorations sur sa robe de chambre. D’ailleurs, j’aime cette médaille d’enfant de Marie. En as-tu bien examiné le revers ? Il y a deux cœurs percés d’un poignard, entourés de roses et d’épines, et lançant des flammes. Les flammes, c’est pour moi — la devise de ma famille, inspirée d’un calembour sur mon nom, digne de ceux que l’on fait ici, est : Sarmentis flamma (par les sarments la flamme).
— C’est tout un programme. Mais il faut être assuré contre l’incendie.
— Le poignard, c’est le canif avec lequel Alexandre et moi nous nous sommes coupés au bras, comme tu as fait avec André. Quant aux roses et aux épines… »
Tout à coup, Georges vit Lucien, qui avait commencé à sourire des roses et des épines, fermer les yeux et se figer dans l’immobilité de quelqu’un qui dort profondément. En même temps, un léger craquement du plancher lui fit tourner la tête ; le surveillant était devant son lit. Le père s’approcha de Lucien et dit à voix basse :
« Ne faites donc pas semblant de dormir, cher petit monsieur Rouvère. »
Il souriait en disant ces mots. Ce sourire rassura Georges. Le père s’assit sur la petite table de Lucien, dont il poussa la caissette contre la muraille. Il était entre leurs deux chevets, à la place d’André et d’Alexandre.
« Qu’est-ce que ces deux inséparables peuvent avoir à se dire si tard ? » demanda-t-il.
Il souriait toujours et sa voix était devenue à peine perceptible. C’était un murmure plutôt qu’une voix.
« Ils se disaient peut-être, poursuivit-il, que leur nouveau surveillant — surveillant d’occasion — qui a conduit la promenade, puis prêché à vêpres, devait être bien fatigué et se donnerait ce soir un peu de relâche. Eh bien, vous le voyez, il était rentré dans sa chambre, mais il ne dormait pas. Il écoutait, l’oreille collée derrière le rideau de sa fenêtre. Il sait qu’une surveillance d’une certaine durée finit par décourager ceux qui ne pensent qu’à de vains bavardages, mais il sait également que d’autres attendent patiemment pour des raisons plus sérieuses. Or, tout ce qui est sérieux l’intéresse : c’est ce qui l’incite à attendre aussi de son côté. »
Le père avait eu tort de rappeler qu’il avait prêché à vêpres : les images grandioses dont son éloquence avait rempli la chapelle nuisaient à la grâce du chuchotement de ce soir. Il jetait les yeux tour à tour sur Georges et sur Lucien, afin de se rendre compte, probablement, de l’effet produit. Mais, Georges évitait son regard : il éprouvait une gêne qu’apparemment Lucien partageait. Le père reprit :
« C’est quelque chose de très captivant que l’archéologie — ma profession dans le siècle, vous le savez. On reconstitue un temple d’après quelques fragments de son architecture, on déchiffre une inscription dont presque tous les mots sont effacés. Contrairement à la plupart des hommes, j’applique ma science à la vie. Ici, à un geste, à un coup d’œil, avec un rien, je reconstitue et je déchiffre les secrets de chacun.
« J’avais deviné, dès le premier soir, que votre isolement dans ce coin, puisque la place à gauche de M. de Sarre n’est pas occupée, favorisait les affaires des deux garçons futés que vous me paraissiez. J’ai ouvert l’œil et l’oreille, mais je commençais à craindre d’être mis en défaut par vous, aussi bien que par vos condisciples, lorsque j’ai noté, tantôt, que vos deux lits s’étaient miraculeusement rapprochés. Je venais voir si le miracle avait des suites. »
Il regarda Georges et Lucien. Il croyait certainement les avoir mis à l’aise ; mais Georges, de plus en plus surpris, consulta Lucien du regard et, comme lui se détourna.
« Bon ! dit le père en se levant brusquement. La plaisanterie a assez duré. »
Sa voix était restée aussi sourde, mais le ton avait bien changé.
« Tous les deux à genoux, allons vite ! » ajouta-t-il.
Georges avait retiré, à l’abri des draps, sa médaille d’enfant de Marie. Il s’agenouilla sur la descente de lit, ainsi qu’il le voyait faire à Lucien.
« Pas là, s’il vous plaît ! dit le père. Dans l’allée, que j’observe de quelle façon vous vous tiendrez. »
Il s’adossa, non loin d’eux, aux casiers qui garnissaient ce côté du dortoir. Dans la poche de sa douillette, il avait pris son chapelet et l’égrenait silencieusement.
Georges ne savait que penser de ce mélange de patelinage et de rigueur. Le père avait feint de rassurer avant de punir. Il ne s’était servi de l’aménité qu’en vue de mieux accabler. Quelle sorte d’homme était-ce là ? Ses paroles n’étaient pas moins insolites que ses procédés. Il était comme un valet, ou comme Néron, derrière un rideau. Il cherchait à surprendre les conversations, et c’était afin de s’y joindre. Il les prolongeait, puis se fâchait subitement. Se fâchait-il parce que l’on avait parlé, ou parce que l’on ne parlait plus ? Certes, pour ceux qui n’étaient pas archéologues de profession, son cas était aussi difficile à déchiffrer qu’une inscription incomplète.
Au reste, Georges se souciait peu de percer tant de mystères. Il voulait seulement ne pas mécontenter un homme de qui allaient dépendre ses rendez-vous avec Alexandre. Il se tenait admirablement sur ses genoux pliés, pour donner la preuve de sa bonne volonté. Il songeait à sa médaille qui était dans le lit ; le ruban serait froissé.
Quand le père eut terminé son chapelet, il se dirigea vers les deux garçons et leur ordonna de se lever. Les rapprochant l’un de l’autre, il les pressa contre lui, entre ses bras, comme s’il voulait leur pardonner par cette étreinte affectueuse. Puis il s’écarta lentement : il les regardait à la lumière de la veilleuse, mais son visage à lui était dans l’ombre. Enfin il leur dit d’une voix grave :
« Vous prierez beaucoup pour moi. »
Georges et Lucien concevaient encore moins, d’après son attitude d’aujourd’hui, ce qu’avait pu leur vouloir le père de Trennes, la nuit dernière. Une fois de plus, en effet, il avait changé d’humeur à leur égard : c’était en leur marquant une parfaite indifférence. Il avait bien vite oublié qu’il s’était recommandé à leurs prières, ou il regrettait peut-être de l’avoir fait. Quel motif avait-il, d’ailleurs, que l’on priât beaucoup pour lui ?
Bref, les deux amis n’étaient pas éloignés de conclure qu’il était un peu timbré. Ils se promettaient, en tout cas, de ne pas s’exposer à une nouvelle irruption de sa part, si lui-même ne s’était déjà promis de ne plus s’occuper d’eux. Le père n’avait-il pas déclaré que sa visite était une plaisanterie qui n’avait que trop duré ? Celle-ci aurait vraiment été courte.
Au milieu de son sommeil, Georges ressentit l’impression d’une vive clarté et ouvrit les yeux. À son chevet, du côté où il n’avait pas de voisin, il aperçut le père de Trennes qui, une lampe électrique à la main, l’éclairait et l’observait. Le père éteignit la lumière et s’assit sur la table de nuit. On eût dit que ces tables n’avaient été faites si basses que pour lui permettre de s’asseoir.
« Excusez-moi de vous réveiller, murmura-t-il. Laissons dormir Rouvère. »
Se soulevant un peu, il ralluma sa lampe pendant quelques secondes, et la braqua sur le visage de Lucien qui était tourné justement de ce côté.
« Voyez comme il dort bien ! fit-il. Ses yeux fermés contemplent les anges et sa bouche les respire. Il rappelle ce que Musset a écrit délicieusement :
Les lèvres des enfants s’ouvrent comme les roses
Au souffle de la nuit…
Le père alluma de nouveau, semblant heureux de faire admirer à Georges la beauté de Lucien.
Lui qui devinait tout, avait-il deviné qu’au dernier trimestre, la lampe électrique avait, pour Georges, joué un rôle au dortoir ? Elle montrait un visage plus beau que celui-ci ; elle faisait lire des vers plus délicieux que ceux de Musset.
La citation du père non seulement flattait Georges — on le traitait poétiquement — mais lui inspirait confiance : Musset était peu en crédit chez les pères ; celui qui venait de louer cet auteur montrait donc qu’il avait les idées larges. Enfin, n’ayant rien à se reprocher, Georges estimait la visite de ce soir incontestablement amicale, et saluait déjà comme une aubaine la protection qui s’offrait. Il assurait ses rendez-vous, fortifiait son amitié. Contre les autres pères, contre le supérieur, Alexandre et lui auraient le père de Trennes. Cela valait bien un sourire, dont le surveillant parut ravi. Il pencha sa tête près du traversin et dit dans un souffle :
« Vous n’avez pas sommeil, j’espère ? Je me sens en train de bavarder longtemps avec vous. Pour une fois, et bien mal, je remplacerai Lucien. »
Les fraîches odeurs d’un élixir dentifrice et d’une eau de toilette se mêlaient à ces paroles. Georges était troublé d’entendre un prêtre lui parler ainsi, à lui seul, presque à l’oreille, dans ce lieu et dans cette demi-obscurité. Il songeait à Alexandre écoutant, après confesse, les propos du père Lauzon sur les mauvaises pensées. Peut-être que le père de Trennes allait également lui recommander des oraisons.
Celui-ci s’était tu un moment, comme s’il cherchait par où débuter :
« Je tenais à vous féliciter d’avoir été le premier en version grecque, dit-il. C’est très bien. De tous les premiers des diverses classes, vous étiez d’ailleurs le mieux fait pour porter cette couronne. Vous êtes plus digne encore de l’Académie de Platon que de celle de Saint-Claude.
— Vous me comblez », dit Georges en souriant de nouveau.
Il ajouterait le patronage de Platon à celui de saint Claude, lorsqu’il poserait sa candidature à l’Académie française.
Le père reprit, sur un ton de rêverie :
« J’aime beaucoup le grec, et j’aime beaucoup la Grèce, que je connais. Je souhaite que vous la connaissiez aussi. Il faut que vous voyiez ce pays, où est née la perfection et qui est une autre perfection lui-même. Ses rochers et ses sources, son ciel et ses rivages, ses montagnes nues et ses champs d’oliviers ne vous instruiront pas moins que le Parthénon, le stade de Delphes ou l’Hermès d’Olympie. Mais ces merveilles ne se comprennent que dans cette lumière qui les éclaire et semble les avoir créées. De même, chez les hommes, la beauté et la pureté devraient se trouver toujours unies. Je vous ai fait mon compliment de la première, mais le méritez-vous pour la seconde ? Vous rendriez-vous témoignage de cette vertu, plus essentielle mille fois que cette qualité ?
— Mais oui, mon père, dit Georges, étonné de la promptitude avec laquelle on venait de passer de la pureté du ciel de la Grèce à la pureté de ses mœurs.
— Votre amitié avec Lucien Rouvère me paraît bien étroite. Ne s’est-elle jamais égarée ? »
Georges rougit sur son traversin. Il trouvait que l’intérêt du père allait un peu loin. Cependant, il réussit à répondre sans trop de vivacité :
« Vous savez, mon père, que j’ai un directeur de conscience pour ces questions-là.
— Allons, mon petit Georges, ne vous offensez pas de mon insistance. Un gentilhomme ne doit pas rougir, ou plutôt ne doit rien commettre qui puisse le faire rougir. Il doit être, comme Bayard, sans peur et sans reproche. Mais quand il a, par malheur, certaines choses à se reprocher, je sais bien qu’il hésitera à s’en confesser, si son directeur de conscience est un homme ordinaire. Il doit, par conséquent, en choisir un autre dans sa caste. Ce mot de « caste » n’est-il pas synonyme de « chasteté » ? Tout est pur aux purs, suivant la parole de l’apôtre. »
Georges pensait au prédicateur qui dissertait beaucoup, lui aussi, sur la pureté, et donnait à ce mot la même étymologie que celle d’ « enfant » en latin : on mettait les enfants et la pureté à toutes les sauces. Il se rappelait aussi le texte complet de la sentence dont le père de Trennes n’avait dit que la moitié : « Tout est pur aux purs, mais rien n’est pur aux impurs. »
« Moi, continua le père, je connais les garçons. Ils m’ont fait comprendre ce sophisme grec, que la neige est noire. Quel trompe-l’œil que leur candeur ! Il y en a qui ne s’accusent, au tribunal de pénitence, que d’aimer trop les confitures, et qui se livrent à des péchés sans nom, de ces péchés dont saint Paul, à juste titre, ne voudrait même pas entendre parler entre chrétiens. C’est peut-être pour lui donner raison que, se livrant à ces péchés-là, ils préfèrent ne pas en parler, du moins à leur directeur de conscience.
« Samedi, j’étais irrité en regardant vos camarades revenir bien tranquilles de leurs confessions. Je lisais sur leurs visages non la paix de l’âme, mais le triomphe de la perversité ; et cette heure, où toute la vie secrète du collège devrait se révéler, est celle de la suprême duperie. Sans doute, j’excuse mes confrères. Comment interroger un enfant, quand on n’a pas été soi-même un vrai enfant qu’à force de volonté et de prières on a vaincu ? Les occasions de péché sont si nombreuses — sept fois par jour pour le juste, a dit l’Écriture ! Et les enfants ressemblent si peu à des justes ! Plus souvent encore que les hommes, car ils ont à la fois plus de loisir et plus d’observation, ils pèchent par la pensée, par la vue, par l’ouïe, quand ils ne le peuvent de fait.
« Vous n’avez lu, probablement, ni les Confessions de saint Augustin, ni celles de saint Pierre Canisius, pas plus que les Coutumes Bénédictines du Bec et de Cluny.
« Saint Augustin, après nous avoir donné quelque aperçu des désordres qu’il commettait, jeune garçon, avec ses petits camarades, ajoute ceci qui en. dit plus long : « Est-ce là cette prétendue innocence des enfants ? Il n’y en a point en eux, Seigneur, il n’y en a point, mon Dieu (il se répète), et je vous demande pardon encore aujourd’hui d’avoir été du nombre de ces innocents. » Il termine par quelque chose de plus fort encore, quoique un peu bizarre : c’est qu’à son avis, lorsque Notre-Seigneur déclare que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants, il ne propose pas comme modèle de vertu leur prétendue innocence, mais seulement la petitesse de leur taille comme symbole de l’humilité.
« Voilà ce que dit le Père de l’Église latine. Saint Pierre Canisius qui, au xvie siècle, fut un des rénovateurs de l’enseignement catholique, est encore plus accablant dans l’aveu de ses erreurs d’enfance, de ses funestes camaraderies ; mais il y a lieu de tenir compte, sans doute, des saintes exagérations de l’humilité. Je me contenterai de citer sa pertinente conclusion : « Seigneur, ouvrez les yeux aux éducateurs de la jeunesse, afin qu’ils cessent d’être des guides aveugles. »
« Au moyen âge, les moines de saint Benoît avaient médité les remarques de saint Augustin et prévenu les vœux de saint Pierre Canisius : les règlements de leurs écoles nous le prouvent. Il y est noté ceci, par exemple : « En quelque lieu que les enfants se trouvent, il leur est défendu de s’approcher de trop près les uns des autres… En classe, on doit leur donner à chacun un siège, au lieu de bancs communs. » Chaque élève avait constamment auprès de lui son pédagogue, qui reposait la nuit dans un lit voisin.
« De nos jours, c’est l’innocence des enfants qui est à la mode. Ici et partout, on voit régner ce préjugé, favorable à de charmants hypocrites. Les règlements, aussi bien que les lois, sont unanimes à s’inspirer, à ce sujet, du fameux : Maxima debetur puero reverentia. Cette formule, dont Juvénal est l’auteur, vous le savez, résume la doctrine morale que le monde chrétien a héritée du monde païen sur le problème de l’enfance. Peut-être avez-vous lu les écrivains grecs et latins ailleurs qu’à Saint-Claude. Sinon, vous croirez, d’après ce bon Juvénal, que, dans l’antiquité, les enfants étaient tellement respectables qu’on devait particulièrement les respecter. Mais, si j’ai pu vous dire sans trop de honte ce qu’avait été l’enfance de deux grands saints, j’hésiterais à vous parler de celles des plus grands hommes de l’antiquité. D’ailleurs, n’accusons pas la nature devant ces tristesses : car tout cela est la faute du péché originel.
« Et tout cela vous montre, mon cher Georges, quelle vertu fragile est la chasteté. On lit, dans la vie de saint Bernardin de Sienne, que « personne ne saurait être chaste, à qui Dieu ne fait le don de la chasteté », mais il y est ajouté que, pour nous favoriser de ce don-là, il veut que nous le lui demandions. Encore faut-il pouvoir et savoir le demander.
« De pareils soins dépassent un peu les forces d’un garçon de votre âge. Si vous restez seul, je veux dire sans secours contre vous et contre les autres, vous succomberez. Il est nécessaire qu’un œil attentif et ami surveille votre cœur. Je serai le surveillant de votre cœur. »
Il sourit lui-même de ces paroles, et se leva :
« Bonsoir, dit-il, en serrant la main de Georges. Naturellement, l’offre que je vous fais s’adresse également à votre ami. Nous serons les trois amis. »
Lucien parut amusé de toutes ces histoires, mais, Georges annonçant l’intention d’en divertir aussi Alexandre, il lui conseilla d’être discret. Cela ne regardait qu’eux deux. Ils étaient assez grands pour n’avoir aucun compte à rendre à personne, ni rien à craindre de personne. L’enfant n’était pas en état d’apprécier l’intérêt qu’ils avaient à cultiver ces relations. Intérêt assez piquant, en vérité : un de leurs maîtres les vengeait du règlement — du règlement de Saint-Claude, qui leur importait plus que ceux du Bec et de Cluny. Ils étudieraient sur le vif la doctrine des équivoques, dont on leur avait parlé en classe de français à l’occasion des Provinciales. Ils convinrent seulement de mener, autant que possible, cette petite intrigue en commun. Si l’un d’eux était réveillé par le père, il ferait en sorte de réveiller l’autre. Et ils lui diraient grand merci quant aux confessions, bien entendu.
L’heure du coucher leur sembla pleine de mystère. Après la prière, ils s’étaient regardés d’un air complice, en prévision des événements de la nuit. Georges se sentait troublé, lorsque le père passait doucement devant son lit. Le chapelet cliquetait contre les boutons de la soutane. Puis, de nouveau, le bruit léger s’éloignait, et l’ombre du surveillant s’étendait le long du mur. Les images que ses propos avaient évoquées flottaient sur le dortoir.
Cet homme qui connaissait la Grèce — la patrie d’ « Alexandre, fils de Philippe » — avait un grand prestige aux yeux de Georges. Il avait contemplé les statues et les monuments reproduits dans la Mythologie et dans l’Histoire de l’Antiquité. Peut-être, un de ces soirs, parlerait-il de l’Amour de Thespies. Il devait avoir vu ce marbre au Vatican, si Rome l’avait retenu sur le chemin d’Athènes, et il trouverait un biais pour le mettre dans la conversation, même à propos du pape.
Georges regrettait de n’avoir plus à penser uniquement à Alexandre. Il savait bien, néanmoins, qu’il ne lui faisait aucune infidélité. Comme l’enfant l’avait dit lui-même à propos de Lucien, il y a amis et amis, comme le père Lauzon avait dit qu’il y a baisers et baisers. Ce commerce avec le surveillant était purement intellectuel ; malgré les prétentions de celui-ci, le cœur n’y jouait aucun rôle. Le père de Trennes remplaçait Marc de Blajan, dont les opinions sur les garçons avaient annoncé les siennes. Enfin, puisque Alexandre avait pu admettre l’amitié de Lucien, qui était quelque chose, il admettait implicitement celle-ci, qui n’était rien.
Georges fut surpris de n’ouvrir les yeux que le matin, avec tout le monde. Il n’y avait pas eu de visite, cette nuit. Durant la journée, le père ne fit pas davantage la moindre attention à lui ni à Lucien. Le soir, leur curiosité n’en fut que plus vive. Bien que ne pouvant converser, ils tardèrent beaucoup à s’endormir. Georges avait voulu parier que le père viendrait, mais Lucien pensait de même.
Ils constatèrent, au réveil, qu’ils s’étaient trompés : ils étaient presque déçus. Est-ce que le père se retirait après toutes ces avances, en emportant les trésors de son érudition ? Il aimait à pratiquer la douche écossaise. Lucien expliquait cela par son séjour dans les pays chauds.
Pendant l’étude de jeudi, au retour de la promenade, Georges, en recopiant sa narration, songeait qu’il allait revoir Alexandre. C’était assez pour lui faire oublier aujourd’hui l’éloquence et le silence du père de Trennes. Il regagnait un autre monde. Il n’attendait du surveillant que la permission de sortir, quand il la demanderait bientôt.
En tout cas, il se félicitait d’avoir eu la prudence de ne pas multiplier les rendez-vous : il voulait solliciter modérément les faveurs d’un homme à la fois si fin et si lunatique. Les rapports avec lui présentaient trop de vicissitudes pour que l’on pût en espérer de grands profits. Il fallait se résoudre à changer d’avis sur ce point. Vendredi, Alexandre avait souhaité deux rencontres hebdomadaires comme au début, mais, par une espèce d’intuition, Georges avait maintenu le principe d’une seule, qu’il avait fixée au jeudi. En définitive, il lui déplaisait de succéder au confesseur. Il avait cru ne tenir compte que des avertissements donnés par le sort, sinon par le père Lauzon, et déjà, à son insu, il en avait écouté d’autres.
L’enfant arriva dans la serre, animé encore par la promenade de l’après-midi. Ses cheveux étaient un peu en désordre. On se plut à le repeigner ; le peigne faisait partie maintenant de leurs rendez-vous.
Sa classe était allée herboriser dans la forêt.
« Toutes ces fleurs, dit-il à Georges, je les ai cueillies à ton intention. Je murmurais : « Pour lui ces violettes, pour lui ce chèvrefeuille, pour lui ce muguet, pour lui cette jacinthe rouge », et les voilà ! »
Il tira de sa poche un mince bouquet.
« C’est dommage que ce soit un peu flétri, ajouta-t-il. Il y a aussi de la glycine : je l’ai coupée au retour, près d’un jardin. »
La trouvaille de la jacinthe et de la glycine était vraiment étonnante : il semblait que l’enfant eût deviné quelles fleurs d’une autre serre on avait mises, à Pâques, dans l’enveloppe de sa lettre. Georges le lui raconta, et plaça, à cette occasion, la légende du bel Hyacinthe, d’où Apollon fut nommé Hyacinthien.
Alexandre dit en riant :
« Nous appellerons la jacinthe rouge Hyacinthus Georgianus. Je suis très fort en botanique, autant que toi en mythologie. Tu m’as dit ce que c’était que la jacinthe, mais sais-tu ce qu’est le taraxacum ? Tu donnes ta langue au chat ? C’est le pissenlit. Dans mon herbier, j’écris les noms latins à l’encre rouge : je m’en souviens mieux.
— Nous sommes voués au rouge. Mais voilà que j’allais oublier de te souhaiter ta fête, puisque, suivant le martyrologe, c’était, hier, 3 mai, la Saint-Alexandre. Je te présente donc mes vœux une seconde fois, et c’est moi qui aurais dû t’apporter un bouquet. Tu te contenteras des fleurs de ma rhétorique.
« Le missel m’a appris également que le 11 septembre, jour de ton anniversaire, c’est la fête de saint Hyacinthe, martyr. Tu es Hyacinthe dans nos deux religions.
— Oui, mais, dans les deux, je verse mon sang. C’est peut-être pour cela que le rouge est ma couleur, à moi ? J’aurais dû mieux réfléchir avant d’adopter ta cravate. »
Georges sourit :
« Cette couleur a un autre sens et même deux. J’y ai fait une sorte d’allusion au cours de notre premier entretien. Le Cantique des Cantiques — je ne te parle que de ça — nous apprend que « l’amour a des lampes de feu et de flammes », c’est-à-dire qu’il est rouge. Et ailleurs, toujours dans la Bible, il s’agit des « péchés rouges comme le cramoisi » (le prédicateur de la retraite nous a dit le passage). L’amour et le péché, voilà le choix que nous avions, et nous avons bien choisi.
— Mais nous n’avons choisi ni l’un ni l’autre : nous avons choisi l’amitié.
— Qu’importe le. terme ? Il ne s’agit que de s’aimer. Dans tes billets, dans ton cantique, dans ta lettre, tu m’as bien dit que tu m’aimais.
— Je l’écris, je ne le dis pas.
— Et tu le répètes malgré toi, puisque tu viens de rougir. C’est un troisième rouge : celui de l’aveu. Mais je n’en ai pas fini avec saint Alexandre.
« J’étais heureux, à la méditation d’hier, d’entendre le supérieur discourir du « grand pape saint Alexandre, qui a dirigé l’Église sous le règne de l’empereur Adrien ». Or, le dimanche où tu m’as encensé, je me figurais que tu pourrais être pape, si l’envie t’en prenait. Je ne savais pas que tu l’avais déjà été. Dans l’Histoire romaine que le supérieur m’a prêtée, j’ai lu que l’empereur Adrien avait un jeune favori nommé Antinoüs, qui est resté célèbre par sa beauté, ainsi qu’Alexandre lui-même — Alexandre le Grand, non pas le grand pape. Et on éleva des temples à Antinoüs lorsqu’il fut mort, comme à Hyacinthe : je me disais que si j’avais été empereur romain et ton ami, je t’aurais fait élever des temples de ton vivant, et tu aurais été un dieu sur la terre. C’eût été plus que d’être pape. Je pensais à ces choses pendant la méditation. Antinoüs me faisait aimer saint Alexandre, comme Alexandre m’avait fait aimer Alexis, dans une églogue de Virgile.
— Juventius, Antinoüs, Alexis, Hyacinthe, dit l’enfant en comptant sur ses doigts : nous sommes à quatre. »
Georges et Lucien se trouvaient dans la chambre du père de Trennes, qui tenait encore une rose à la main : c’était la fleur qu’il leur avait fait respirer un moment, pour que le parfum les réveillât. Georges avait eu la primeur de cette opération galante, puis il en avait suivi la manœuvre sur Lucien. Musset avait dit que les lèvres des enfants s’ouvraient la nuit comme des roses : le père de Trennes ouvrait sous les roses les yeux des enfants.
Il avait prié les deux garçons d’aller bavarder chez lui, ce serait plus commode : leur était-il possible de refuser ? Il leur avait recommandé de ne pas faire de bruit, d’arranger leurs lits de sorte qu’on ne pût s’apercevoir de leur absence. Ils avaient mis leurs pantoufles et, voyant qu’ils endossaient leurs vestons, il les avait priés de rester en pyjama — s’ils avaient frais, on allumerait un radiateur électrique. Et maintenant, ils étaient là, tout étonnés.
Le père avait placé la rose dans un vase et dit en souriant :
« Rosa mystica, la rose de nos mystères. »
Il avait fermé doucement la fenêtre masquée qui donnait sur le dortoir. Le lit n’était pas défait. À côté de la table de toilette, que garnissaient plusieurs flacons, il y avait un tub en caoutchouc. Sur la table, près de la lampe, trois verres étaient posés, entre une bouteille de liqueur et un paquet de biscuits.
Ayant avancé des chaises à ses hôtes, le père s’installa en face dans un fauteuil de paille .
« Je dois répéter, dit-il, le mot du psalmiste : « Qu’il est bon et qu’il est doux d’habiter avec ses frères ! »… habitare fratres in unum. C’était une maxime favorite des Templiers, et leurs persécuteurs voulurent y voir un sens infâme. Une grande fraternité suscite des calomnies, si ce n’est des persécutions. Je vous ai réunis ici pour en préserver la nôtre. Le lieu n’est pas seulement plus commode, mais plus sûr. J’ai vérifié, lit par lit, que tout le monde dormait. D’ailleurs, l’heure est favorable : c’est celle du premier sommeil, qui est le plus lourd. Néanmoins, parlons bas et approchez davantage. »
Ils poussèrent leurs chaises vers lui. Leurs genoux touchaient presque les siens.
« Le jour, continua le père, je m’entourerai des mêmes précautions. Vous ne me verrez jamais frayer avec vous qui m’intéressez, mais avec ceux qui m’amusent et ne m’intéressent pas : vos aînés, qui se croient des hommes, vos cadets de quatrième, qui se croient des enfants. Vous n’aurez que mieux le sentiment d’être au-dessus des autres, et vous apprendrez ainsi que les vrais triomphes sont secrets. »
Puis, il ajouta en souriant de nouveau :
« Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. »
Il se leva, déboucha la bouteille, versa à boire. Georges lui posa des questions sur la Grèce : comment étaient les gens, les hôtels, la nourriture, les routes, si l’on trouvait encore de belles statues à acheter. Le père répondit avec complaisance. Il promit également de commander les poésies de Musset : Lucien lui avait dit qu’il souhaiterait les lire, puisque, d’après Georges, il avait eu l’honneur de lui en rappeler un passage.
« Je constate avec satisfaction, déclara le père, que vous ne vous cachez rien, comme j’avais constaté que vous restiez à l’écart de vos camarades. Tant d’intimité et tant de prudence sont faites pour m’attirer et pour me retenir. »
Il offrit à ses invités un dernier petit verre, et recula afin de les examiner.
« C’est bien ce qu’il me semblait, fit-il : vos pyjamas ne vous vont pas parfaitement. Celui de Lucien irait mieux à Georges, qui est plus mince, et celui de Georges à Lucien, qui est plus râblé. Troquez-les dès demain. Suivant le mot de Pythagore, tout est commun entre amis. »
Il regarda sa montre et dit :
« J’ai soin de votre repos. Vous allez me quitter pour regagner le monde des songes. Que je voudrais savoir à quoi, à qui vous rêvez ! Peut-être que demain, grâce à mon idée, Georges rêvera de Lucien, et Lucien rêvera de Georges. »
Il les contempla, comme l’autre soir :
« Ne l’oubliez pas, dit-il, et je ne cesserai jamais de vous le répéter : la pureté est, aux yeux de Dieu, la plus belle parure des enfants, mais elle est aussi trop souvent la seule qui leur manque. À votre âge, c’est-à-dire à quatorze ans, saint Nicolas de Tolentino ne se gardait chaste qu’en usant de chaînes, de ceinture de fer et de cilices, jeûnant quatre fois par semaine et ne couchant qu’à même le sol.
« Certes, gloire à celui qui a toujours su dompter le Malin ! Mais il faut se rappeler que la voie du repentir reste ouverte, si l’on a failli. La virginité du cœur peut se refaire, et c’est celle qui importe. Dans une grande âme, la fureur des vices annonce la force de la grâce qui viendra les purifier. Ne désespérez pas ; au fond de vos misères, je vous ferai retrouver Dieu. »
Ce dimanche-là, une troupe de passage devait représenter, dans la salle des fêtes, Polyeucte, tragédie chrétienne. Georges n’admirait guère cette pièce qui figurait au programme de sa classe et qui avait été abondamment commentée par le Tatou. Là-dessus, il partageait l’avis de l’Hôtel de Rambouillet. Il se souciait également fort peu de prendre une leçon d’art dramatique, bien qu’il eût été gratifié d’un rôle dans Les Plaideurs, que les grands devaient jouer à la distribution des prix. Et cependant, il était enchanté : Polyeucte serait une occasion d’apercevoir Alexandre, comme Les Plaideurs en seraient une de se montrer à lui, et plus heureuse sans doute que les pompes académiques du mois de mars.
MM. les curés des environs avaient été invités. Lorsqu’ils entrèrent, leur tournure rustique, leurs formes épaisses divertirent les jeunes spectateurs. On les plaça au premier rang, là où les académiciens s’étaient assis glorieusement aux côtés du cardinal, mais les fauteuils étaient restés chez le supérieur. À quelques rangs derrière MM. les curés, à quelques rangs devant Georges, se dessinait la nuque blonde d’Alexandre.
Enfin, Polyeucte apparut, gourmandé par Néarque. Chaque fois que se faisaient entendre des mots tels que « Dieu », « Ciel », « Chrétien », « Baptême », les braves curés éclataient en applaudissements. Aussi, dans leur diction, les acteurs détachaient-ils avec soin des syllabes si propices. Les élèves s’empressaient d’imiter MM. les curés, et l’on eût dit une tempête. Il fallait que le supérieur, en se retournant, apaisât les bravos. Et encore le voyait-on gêné par la crainte de paraître désapprouver tout ensemble le jeu des acteurs, le zèle des invités et le caractère d’une tragédie qui portait l’épithète de chrétienne et qui était une œuvre du grand siècle. Il était tenu en échec à propos de Polyeucte, comme il l’avait été par la carte postale de Georges : « L’Amour de Thespies. Palais du Vatican. »
Maurice, qui était non loin de Georges, disait qu’on aurait dû organiser une contre-manifestation pour applaudir autre chose : « Femme », « Amante », « Appas », « Bel œil », « Hymen… Hyménée ». Il tapait du pied discrètement au passage de ces termes, qui formaient sa protestation plaisante, et il n’oublia ni « Chair », ni « Jupiter », ni « Volupté ».
Ce fut d’une voix de stentor que le digne Félix lança le dernier vers :
Le professeur avait dit en classe : « Remarquez que la pièce se termine par le mot : « Dieu ». On le remarqua bien aujourd’hui. Dans le tohu-bohu de la sortie, Georges se glissa jusqu’auprès d’Alexandre, qui le cherchait des yeux. Heureux de braver le ciel et la terre, il échangea quelques mots avec l’enfant. L’ardeur de Polyeucte était passée en lui, et le père Lauzon lui-même ne l’aurait pas arrêté.
Le lendemain au soir, Georges et Lucien se trouvaient pour la seconde fois dans la chambre du père de Trennes. Il était plus de minuit.
« Vous me pardonnerez une heure aussi indue, dit le père. Mais au moment où je venais vous réveiller, j’ai surpris un de vos camarades qui fumait, assis tranquillement dans l’embrasure d’une fenêtre. Voilà ce que c’est de laisser ouvert la nuit, ainsi qu’on le fait maintenant. Les parfums qui montent des lilas de la cour intérieure troublent le sommeil de beaucoup de garçons. J’ai confisqué les cigarettes du fumeur, et nous allons les griller à son intention. Je l’ai mis à genoux, comme vous le premier soir, et ensuite, il a été très lent à se rendormir. C’est ce qui m’a retardé. »
Ils prirent une cigarette.
« Mais vous, mon père, dit Lucien, ne dormez-vous donc jamais ?
— Quelques heures me suffisent, répondit le surveillant. En toute chose, je sais me contenter de peu. Mais je demande que l’on me contente, au moins quand il s’agit de peu de choses. Je vous avais suggéré d’échanger vos pyjamas, et au lieu de suivre ma suggestion, chacun de vous a pris un pyjama neuf, qui lui va d’ailleurs mieux que l’ancien. Pour vous apprendre à être plus dociles, j’ai retiré ceux-ci de vos sacs à linge respectifs, et les ai remplacés, dans vos trousseaux, par deux autres, à peu près de même taille — j’en avais justement dans une valise, qui étaient destinés à des neveux. À titre de mortification, vous mentirez à vos familles en disant que le changement fut une erreur de la sœur lingère. »
Il remplit les verres et donna des biscuits : l’incident était clos.
« Bien que votre confiance ne répondît pas encore tout à fait à la mienne, continua-t-il, je ne saurais me passer de vous. Avant de porter mes affections sur quelqu’un, j’étudie soigneusement son visage. J’ai étudié ainsi vos camarades, et c’est vous deux que j’ai élus. Chaque nuit vient ratifier mon choix. Je m’assieds un moment à côté de vos lits, allumant de temps à autre ma lampe électrique afin de mieux vous admirer. Avec quelle impatience j’attends ce moment-là ! Je m’y prépare comme pour une fête. Socrate aussi se faisait beau, disait-il, quand il se rendait auprès d’un beau. Mais il y a cette différence entre lui et moi, que mon principal soin de beauté consiste à me raser. Avez-vous remarqué quelle négligence, digne moins de Socrate que des philosophes cyniques, mes confrères affectaient à cet égard ? Certains ne se barbifient que le dimanche, avant la grand-messe. Mon cérémonial est différent : je me rase non seulement le matin pour tout le monde, mais le soir pour vous. Je veux offrir, à vos yeux même endormis, au miroir même voilé de votre âme d’enfant, à vos visages sans souillure et sans défense, un visage honorable de l’homme. »
Georges ne put s’empêcher de sourire de ces raffinements de barbe, et dit d’une voix légèrement ironique :
« Saintes douceurs du ciel, adorables idées ! »
Ce souvenir de Polyeucte les fit rire tous les trois — le père voulut prouver sans doute qu’il entendait raillerie. Ensuite, montrant aussi qu’il savait changer de sujet, il porta le propos sur la représentation de la veille. Il raconta le repas des bons curés, à la salle à manger des hôtes, où il leur avait tenu compagnie. C’était là qu’on les avait confinés, probablement en vue de les soustraire le plus longtemps possible à la malignité des élèves. On les excluait du réfectoire, comme si c’eût été de la chambre bleue d’Arthénice. Le surveillant dépeignit leurs manières pastorales : les serviettes mises autour du cou, les clappements de langue après boire, les assiettes inclinées d’une main et furieusement saucées de l’autre, les pilons de volailles brandis à bout de bras. La conversation était à l’avenant : l’un des voisins du père de Trennes l’avait beaucoup pressé sur la pêche de l’anguille, et l’autre sur la béatification prochaine de la première sainte Peau-Rouge, annoncée par un journal.
Georges se réjouissait que la conversation même du père n’eût pas repris aujourd’hui un tour insidieux. Il en était d’autant plus étonné que, d’après la conclusion de la précédente, il s’était attendu à un laïus sur la « fureur des vices » — l’expression l’avait fait pouffer souvent avec Lucien, qui préférait, quant à lui, « le fond de vos misères ».
Le père suspendit ses discours plaisants :
« Vous vous amusez de mes histoires — je ne parle pas de la sainte Peau-Rouge — et vous les oublierez aussi vite que celles de Thucydide et de Salluste. Ce qui comptera pour vous, de vos années de collège, ce sont des souvenirs d’un ordre différent, dont toute votre vie sera marquée : la complicité d’un regard, le reflet d’une chevelure, l’éclat d’une lèvre, la chaleur d’une main. »
Il se tourna vers Georges et lui demanda :
« Quel est cet enfant à qui hier vous avez parlé, après la séance ? »
La question perça Georges comme un trait, mais il répondit tranquillement :
« C’est le frère de Maurice Motier.
— Vous le connaissez bien ?
— Oh ! pas plus que n’importe qui.
— C’est dommage. Je vous féliciterais d’une pareille amitié. Elle serait doublement digne de vous, parce que vous l’auriez gardée secrète, et que cet enfant est un des plus beaux ouvrages formés par la main de Dieu. »
Le père de Trennes terminait volontiers ses discours sur le mot : « Dieu », comme Polyeucte, ou sur quelque chose d’approchant. Mais Georges, qui, maintenant, pensait dans son lit à l’entretien de ce soir, n’en était pas plus rassuré. Il n’avait pas la naïveté de se croire la seule cause de l’intérêt qu’Alexandre inspirait au surveillant. Il avait appris à connaître un personnage dont toutes les paroles, toutes les démarches cachaient une intention. Il sentait qu’Alexandre avait pris place dans les pensées de cet homme, qui soupçonnait déjà leur liaison. L’archéologue avait déchiffré l’inscription, reconstitué le temple. Georges payait cher la témérité que lui avait donnée Corneille et qui l’avait trahi. C’est lui à présent qui avait attiré sur son amitié une nouvelle menace. Elle venait de quelqu’un dont le silence lui était acquis, et pourtant il était plus inquiet que l’autre fois. Le supérieur et le père Lauzon n’avaient été, à leur manière, que les artisans du bien ; mais qu’était au juste le père de Trennes ? Cette question, que Georges s’était posée dès la première escarmouche, n’était pas résolue. En tout cas, il se promettait de ne pas se laisser dire, Alexandre étant ajouté à Lucien : « Nous serons les quatre amis. » Malgré le mot de Pythagore, il prierait le père de mettre des bornes à son amitié. Bien mieux, il esquiverait ce thème de conversation. Il saurait empêcher que l’on ne mêlât Alexandre à de pieuses ou savantes digressions sur la pureté et l’antiquité. L’enfant et lui n’avaient besoin du concours de personne auprès des anges ni des dieux.
Lorsqu’il demanda à sortir, pendant l’étude de jeudi soir, il nota que le surveillant, avec un léger sourire, le suivait des yeux jusqu’à la porte. Sans aucun doute, son rendez-vous était deviné, et par conséquent, son intrigue était découverte, ainsi qu’il avait craint. La discrétion que le père avait gardée depuis lundi n’avait pas été faute de mémoire. Il avait certainement observé que Georges, dont les sorties étaient rares, sollicitait la permission de s’absenter chaque jeudi à la même heure. Et Georges se reprochait de ne pas avoir prévu cette observation.
La présence d’Alexandre n’arriva pas à dissiper le malaise qu’il éprouvait. Il voyait le père de Trennes à côté de l’enfant, comme au dortoir à côté de Lucien.
Leurs surveillants se liguaient contre eux, d’une manière ou d’une autre : Alexandre avait à se méfier du sien, qui avait jugé sa dernière absence un peu trop longue, et qui, en le laissant sortir aujourd’hui, lui avait fait un signe d’avertissement. Naturellement, l’enfant était prêt à tout affronter, mais Georges tenait plus que jamais à éviter les complications. Il ne voulait pas renforcer, par un retard suspect, les présomptions du père de Trennes, et déclara qu’un devoir difficile l’obligeait, malgré lui, à écourter l’entrevue. C’était l’excuse qu’Alexandre avait fait valoir, une fois, au père Lauzon pour aller rejoindre Georges. Celui-ci pensait à changer le jour et l’heure des rendez-vous, dans l’espoir de dérouter le surveillant, mais il s’avoua que la précaution serait à présent bien inutile.
Au dortoir, le souvenir du rendez-vous gâché le tourmentait. Ce n’était pas seulement son plaisir d’aujourd’hui qui avait été troublé : son bonheur même était en péril. Il regrettait de ne pouvoir parler avec Lucien ; cela lui aurait fait reprendre confiance. Il ne regrettait pas moins d’avoir laissé chez lui les billets d’Alexandre. De nouveau, il aurait veillé aussi longtemps qu’il aurait fallu, afin de les relire sous ses draps. Peut-être aurait-il chassé ainsi la vision qui l’obsédait. Pour lui, les heures du dortoir n’étaient désormais que les heures du père de Trennes. Il ne les attendait plus avec impatience ou avec curiosité. Il les appréhendait, songeant au prêtre bien rasé qui allait se pencher sur son sommeil.
Cela commençait à devenir agaçant : la délicatesse orientale de ce réveil au parfum d’une rose avait cessé d’être à son goût. Il avait eu envie de s’écrier à haute voix : « Zut à la rose ! » comme il criait, quand il jouait, petit garçon : « Zut au berger ! » Il se disait cela, et docilement se rendit jusqu’à la chambre, avec Lucien. Il aurait dû ne jamais y mettre les pieds, s’il ne voulait pas être, en quelque sorte, contraint d’y revenir. Il prévoyait un interrogatoire sur le rendez-vous de l’après-midi, et ne se sentait pas d’humeur à répondre aimablement.
« Je vous ai réveillés, dit le père, en vue de vous annoncer une bonne nouvelle : demain matin, je célébrerai la sainte messe, non pas, comme les surveillants, pendant la première classe, mais pendant la messe en commun, dans la tribune qui est de notre côté — je me suis arrangé avec M. le préfet — et j’aurai deux enfants de chœur : Lucien Rouvère et Georges de Sarre. »
Il paraissait très content.
« Vous ne devineriez jamais, ajouta-t-il, ce qu’il m’a fallu inventer pour arriver à ce simple résultat ; mais dès qu’on touche au trantran de la vie collégiale, c’est toute une affaire.
« J’ai dit que vous m’aviez exprimé le vœu de me servir la messe ensemble ce jour-là, par suite d’une dévotion particulière que vous aviez à saint Pancrace, dont la fête est demain. Ce saint, originaire de l’impure Phrygie, patrie de Ganymède, fut martyrisé à quatorze ans, et je suis certain d’avoir prévenu vos intentions en vous donnant ce jeune protecteur : c’est ce qui justifie mon pieux mensonge. Il est dit, en outre, qu’on aurait voulu le sauver des supplices en raison de sa beauté, autant que de son âge. C’est en effet vers les délices et non pas les supplices (la rime est d’une terrible justesse) que vous appellent votre âge et votre beauté — délices d’un instant qui, si vous mouriez dans cet instant, vous condamneraient à d’éternels supplices. Puissiez-vous, avec l’aide de saint Pancrace, rester forts contre leur séduction ! Puissent vos amitiés ne jamais dégénérer ! »
Encore un saint de quatorze ans. Depuis la saint Placide, les amitiés du collège ne manquaient pas de protecteurs. Les listes du père de Trennes étaient aussi complètes que celles du prédicateur d’octobre, et ses histoires contenaient toujours des détails aussi dignes d’intérêt. Le langage de ces deux hommes était presque identique, mais celui du père de Trennes éveillait des échos différents. Il y avait loin de saint Placide ou de saint Edmond à saint Pancrace ou à saint Nicolas de Tolentino, c’est-à-dire que la manière dont on avait présenté les uns ne ressemblait en rien à celle dont on présentait les autres. Quand le surveillant parlait de la chasteté, c’était pour expliquer qu’elle concernait surtout le cœur. Quand il parlait de la beauté, on sentait également que ce n’était pas dans le même esprit que l’orateur de la retraite. Sans doute la voyait-il plutôt sur la terre, et s’il levait les yeux afin de la chercher dans le ciel, était-ce vers Ganymède enlevé par l’aigle ou vers saint Pancrace enlevé par les anges ?
Il reprit :
« J’aurai donc le bonheur de vous donner la sainte eucharistie. Cette communion doit être la plus belle de votre vie ; elle sera vraiment votre communion solennelle. Vous allez vous y préparer par une confession complète. »
Il montra le prie-Dieu, sur lequel reposaient l’étole et le surplis. Georges resta interdit. La différence qu’il avait faite entre les discours du père de Trennes et ceux du prédicateur, il la faisait encore davantage entre une confession dans cette chambre et sa première confession à Saint-Claude, dans la chambre du père Lauzon. Il se voyait devant un coup monté. Le surveillant n’avait pas renouvelé ses offres de direction de conscience, parce qu’il attendait cette occasion. Évidemment, on pouvait ne pas lui dire la vérité, mais il était plus prudent de ne pas se laisser interroger. Il s’agissait d’un autre homme que le père Lauzon. Si sa dialectique s’inspirait de Socrate, comme certains de ses principes, il devait être un confesseur redoutable. Après avoir décidé de parer toute attaque directe au sujet d’Alexandre, Georges n’entendait pas s’exposer aux embûches d’une confession. Fût-il un pénitent de mauvais aloi, il lui plaisait de n’avoir affaire qu’à un confesseur authentique. C’est pour des raisons semblables qu’il avait même songé à décliner l’invite de servir la messe, mais il jugea plus habile de couper la poire en deux.
« Vous m’excuserez, mon père, dit-il. Je serai votre acolyte avec plaisir, mais la confession est inutile. Je me sens en état de communier demain. »
Lucien s’empressa d’approuver pour son compte. Le surveillant, qui s’était dirigé vers le prie-Dieu, se retourna avec vivacité :
« Quoi ! s’écria-t-il, vous refuseriez de m’obéir ?
— Il n’est pas question de vous désobéir, dit Georges, mais la preuve que nous n’avons pas grand-chose sur la conscience — je me crois autorisé à parler au nom de mon camarade — c’est que nous fréquentons la sainte table chaque matin.
— Quelle perfidie est la vôtre de m’opposer un tel argument ! On ne m’abuse pas, moi ; l’avez-vous oublié ? Mais c’est moi qui voudrais oublier tout ce que je sais de vous et de vos pareils, lorsque je vous vois approcher du pain des anges. Trop beau spectacle, digne de ces retours de confesse que je décrivais à l’un de vous !
« Eh oui ! tous ces spectacles sont des hymnes apologétiques, des poèmes de bénédiction, continua-t-il sarcastiquement en parcourant la chambre. Ah ! je voudrais composer un autre hymne, vraiment, un poème, un péan qui chanterait la pureté des jeunes garçons. Elle y aurait des rimes de choix : « puerpérale » - « baptismale », « éburnéenne » - « nivéenne », « adamantine » - « cristalline », « mirifique » et « séraphique ».
S’arrêtant devant ses hôtes, il leur dit d’un ton rageur :
« Allez vous coucher, avec votre pureté ! »
Ils se levèrent ; ils approchaient de la porte, lorsqu’il les rappela doucement, et ils comprirent à son regard que sa colère était tombée.
« Les enfants, dit-il en souriant, sont comme les chats : ils se méfient toujours et n’aiment personne. Mais on ne peut s’empêcher de les aimer.
« Ne partez pas que nous n’ayons au moins fait ensemble une prière, afin d’appeler la grâce divine sur la messe de demain. J’accepte de croire, en dépit de mon expérience, que vous n’avez pas besoin de mes secours et que vous m’avez dit vrai. »
Il gagna le prie-Dieu, s’agenouilla entre ses deux compagnons. Ayant fait le signe de la croix, il commença une oraison à laquelle ils répondirent.
« Si vous m’avez menti, dit-il ensuite à voix basse, demandez-en pardon à Dieu du fond du cœur. »
Il leur prit une main à chacun, et, muet, resta un moment ainsi, comme s’il les offrait en sacrifice.
Quand on se rendit à la chapelle, Georges et Lucien, après avoir été chercher leurs missels, suivirent le père de Trennes dans l’étroit escalier qui menait à la tribune. Pendant que le surveillant se recueillait, ils allumèrent les cierges, disposèrent les cartons, le pupitre, les deux vases qu’on avait garnis de roses — « les roses mystiques », dit Lucien.
Tout en vaquant à ces soins, Georges tournait les yeux vers la division des petits, qui faisait face. À présent, il apercevait Alexandre à sa place lointaine, presque aussi bien que lorsqu’ils étaient vis-à-vis. D’ici, les distances lui paraissaient moins grandes que d’en bas. Sans doute l’enfant aurait-il l’idée de regarder là-haut, quand il aurait constaté l’absence de son ami. Il croirait que celui-ci ne l’en avait pas prévenu dans l’intention de lui faire une surprise, comme lui-même en avait fait une à celui-ci le soir de la rentrée.
Près de la petite table qui servait de vestiaire, le père de Trennes, aidé par ses deux acolytes, revêtait les habits sacerdotaux. Jamais encore Georges n’avait pris garde aux paroles latines qui commentent cette cérémonie. Le père prononçait distinctement chaque syllabe. En mettant d’abord les ornements blancs — l’amict et l’aube — il conjura les « assauts du démon » et demanda d’être « blanchi par le sang de l’Agneau ». Puis il ceignit le cordon, pour « éteindre dans ses reins l’humeur de luxure ». Et, maintenant, peu à peu, il se recouvrait de rouge, avec le manipule à son bras, symbole des « gerbes de la douleur et de la joie », l’étole à son cou, insigne de « l’immortalité », la chasuble enfin, marque suprême de son ministère, « joug suave et fardeau léger ».
Lorsqu’il se retourna, il sembla transformé aux yeux de Georges. Il n’était plus le père de Trennes, l’archéologue de la jeunesse, le surveillant des cœurs : c’était le prêtre de Jésus-Christ.
Comme il évoquait, hier au soir, sa première confession au collège, Georges songeait maintenant à la première messe qu’il y avait servie. C’était au supérieur qu’il avait servi cette messe, en compagnie de ce même Lucien, et en mémoire de saint Tarsicius, l’acolyte qui avait péri pour son Dieu. Saint Pancrace était mort pour le même Dieu. D’autres étaient morts pour d’autres dieux.
Et eux, que faisaient-ils ici tous les trois ? De quelle religion célébraient-ils donc les rites ? Le Dieu qu’ils honoraient était-il vraiment leur Dieu ? Ce prêtre était-il vraiment son prêtre ? Méritait-il de se parer du sang des martyrs, de se blanchir du sang de l’Agneau ? N’est-ce pas lui qui avait mis là ces roses, afin de rappeler ses visites au dortoir, ses étranges propos, l’hospitalité de sa chambre ? Et ses deux acolytes n’étaient-ils pas dignes de lui, plutôt que de saint Pancrace et de saint Tarsicius ? Jadis, la foudre serait tombée sur eux, ou le sol se serait ouvert et les aurait engloutis ; une voix céleste aurait étouffé ces paroles : « Je laverai mes mains parmi les innocents. »
Georges, en revenant de présenter l’eau, jeta un coup d’œil vers le fond de la chapelle, et ses désirs furent comblés : Alexandre l’avait vu et lui avait souri. L’enfant devait guetter son apparition au-dessus de la balustrade, comme on l’avait guetté longtemps, lui aussi, dans l’autre tribune. Georges ne se sentit plus du tout en état mystique. Il était redevenu plein d’indifférence à l’égard du surnaturel. Il avait retrouvé sa foi véritable : la foi dans son amitié. Ce n’était pas seulement du haut de cette tribune qu’il dominait le collège. Il était le triomphateur secret, plus que le père de Trennes ne le lui avait promis. Il vivait en dehors de la discipline du père, autant qu’en dehors de celle du collège ou, pendant les vacances, en dehors de celle de la famille. Malgré son sourire mystérieux à l’étude d’hier, le surveillant, grâce à Dieu, n’avait pas reparlé d’Alexandre cette nuit. Et ce matin, en pleine chapelle, Georges avait reçu, à titre de revanche, un autre sourire.
Le nom de saint Pancrace le fit penser au refrain de la chanson : Les noces de la fille du président Fallières. Ces trois vers ne s’étaient pas présentés à son esprit depuis la Saint-Ignace, au commencement de ce mois de février qui lui avait apporté Alexandre :
Le grand-père Ignace,
Le cousin Pancrace,
L’oncle Célestin.
Georges feuilleta son missel pour voir si saint Célestin y figurait. Oui, et la date était même très prochaine : le 19 mai. Bientôt, la chanson serait finie.
Le moment de la communion était arrivé. De nouveau, Georges se sentit ému. Le prêtre demandait « la parole qui guérit », et son sacerdoce lui donnait le droit de l’obtenir. L’acte qu’il accomplissait ne pouvait être une parodie. Il se tourna lentement vers Georges et Lucien qui s’étaient mis côte à côte. Le ciboire à la main, il regarda au loin, dans la direction d’Alexandre. Il éleva l’hostie étincelante qui se détachait sur la chasuble rouge, entre les deux vases de l’autel.
Le lendemain au soir, l’honneur ne fut que pour Georges, mais il n’y avait pas de fleurs : c’était un réveil à la lampe. Probablement, le père jouait-il la parodie de la vierge sage, avec sa lampe allumée. Il s’était assis près de Georges, qui mesurait la difficulté de mettre Lucien de la partie, malgré leurs conventions.
« J’aime beaucoup, dit le père, le moment où vous vous réveillez : les beaux yeux qui clignotent, la petite moue un peu fâchée, une joue plus rouge que l’autre — celle du côté où vous dormez. Et qui plus est, par un miracle de l’art de la coiffure, vous n’êtes presque pas dépeigné. Seule, votre mèche blonde, dont on ne voit que le bout du nez pendant le jour, s’échappe alors comme pour prendre le frais. »
Le père alluma sa lampe électrique et regarda encore cette chevelure intéressante. Aujourd’hui justement, Georges s’était éclipsé, au cours d’une récréation, afin de raviver discrètement la blondeur de sa mèche avec le produit qu’il enfermait à clef dans sa boîte de toilette.
« À quel phénomène cette mèche est-elle due ? » reprit le surveillant.
Georges, excédé, raconta, en peu de mots, l’histoire du shampooing à l’eau oxygénée.
« J’avais cru, dit le père, qu’il s’agissait d’une blondeur naturelle. N’avez-vous jamais blondi que cette mèche-là ?
— Oui, répondit Georges.
— Il y a dans votre portefeuille une mèche de même nuance que vous semblez conserver précieusement. Je m’étais imaginé que vous l’aviez retranchée de vos propres cheveux. C’est donc le souvenir d’une autre chevelure blonde. »
Georges s’était soulevé brusquement.
« Quoi ! dit-il. Vous avez osé regarder dans mon portefeuille ! »
Le désespoir que lui causait son impuissance triompha de son indignation. Sa tête retomba sur le traversin, des larmes lui vinrent aux yeux. Il avait été astucieusement dépisté, et se voyait, avec Alexandre, prisonnier de l’homme qui venait de lui parler. Les deux amis n’avaient échappé au supérieur et au père Lauzon que pour tomber entre ses mains.
Le prêtre caressa doucement le front de Georges :
« Il ne faut pas pleurer ainsi, enfant que vous êtes ! murmura-t-il. Je serais moins indiscret si vous étiez moins secret, et vous n’avez pas le droit de m’en vouloir. Je ne vous en veux pas non plus, puisque je vous avais félicité d’avoir su cacher votre intrigue, mais à partir de ce moment, vous n’aviez plus rien à me cacher. Vous n’avez pas compris encore que tout ce que je puis apprendre reste entre nous, et que je tiens à tout savoir, non dans le dessein de vous punir, mais de vous éclairer. Je vous le répète, mille dangers vous entourent sans que vous vous en doutiez. C’est pour cela qu’il faut être vigilant : je suis épris de votre pureté, comme il est dit dans le psaume : « Le roi est épris de votre beauté. » Et la pureté est la beauté des anges. Je vous ai, un soir, paraphrasé cela.
« Nous nous sommes partagé les rôles : vous êtes mon ange, et je suis votre gardien. Ne cherchez pas à vous garder de votre gardien. Vous et l’enfant que vous aimez, vous n’aurez jamais à craindre que j’outrepasse mon pouvoir. J’agis à la manière de Théognis auprès de son jeune ami Cyrnos : « Je franchis les remparts, mais ne ravage point la ville. »
« Si j’avais plus de présomption, je me comparerais à de glorieux serviteurs de Dieu, comme saint Romuald ou saint Jean de Quenti, qui, tentés par quelque mets au milieu de leurs austérités, se le faisaient apporter afin de le contempler plus avidement encore, puis le faisaient remporter. Ils appliquaient le précepte du stoïcien : « Dans ta soif la plus ardente, ne fais que te gargariser. » Je sais rester sur ma faim et sur ma soif. »
Le père, en se levant, tira de sa poche un petit paquet.
« Pour vos sorties du jeudi soir, dit-il, je vous donne ces cigarettes, qui vous feront penser à moi. Elles sont meilleures que celles de l’autre fois. Elles viennent d’Égypte, où je les ai achetées. »
Georges aurait voulu lui lancer à la tête ses cigarettes égyptiennes. À quoi donc cet homme s’intéressait-il dans Alexandre ? À la pureté ou à la beauté ? Que cherchait-il à savoir et jusqu’où iraient ses investigations ? Il examinait les portefeuilles, comme le supérieur, et prétendait, de même, qu’on ne devait pas avoir de secrets avec lui. Quelle chance au moins que Georges eût laissé les billets à la maison, ces billets que, tout dernièrement, il regrettait de ne pouvoir relire ! C’était encore mieux que de les avoir laissés au dortoir, la nuit de sa visite au supérieur.
Il se rassurait, d’ailleurs, en se disant qu’Alexandre était protégé par la barrière de la division. L’obstacle qu’il avait si souvent maudit pour les besoins de sa propre cause, lui paraissait maintenant providentiel. L’idée que le père de Trennes se serait assis au chevet de l’enfant le rendait fou. Georges voulait bien garder le silence, quand il ne s’agissait que de lui ; mais dans l’autre cas — purement imaginaire, Dieu merci — il aurait apostrophé le père, ameuté le dortoir.
Les jours suivants, on eût dit que celui-ci avait pris à tâche de se faire oublier. Il affectait même de ne jamais jeter les yeux sur ses deux élus et les laissait dormir en paix. Il se détachait aussi un peu de la communauté ; à quelques récréations, l’ancien surveillant venait le remplacer.
Pendant l’étude du jeudi soir, Georges, assez troublé néanmoins, sollicita la permission de sortir, que le père lui donna d’un air distrait.
Après leurs premiers épanchements :
« J’ai quelque chose à te dire », fit Alexandre.
Sa voix avait été assez grave.
« Est-ce que je dois me mettre à distance, comme certain jour ? dit Georges en riant.
— Ce n’est pas nécessaire : je veux seulement te demander ce que tu penses du père de Trennes. »
Ce nom dans cette bouche !
« Pourquoi ta question ? dit Georges qui réussit à rester calme, comme il l’était resté à la première question du père au sujet d’Alexandre.
— J’ai vu Maurice dimanche ; il m’a raconté que ce père était très gentil, lui donnait de bons conseils, et quelquefois l’invitait, la nuit, dans sa chambre, à boire des liqueurs et à manger des biscuits. Après quoi, il m’a engagé à profiter de tout cela, en prenant à mon tour le chemin de cette chambre, non pas au clair de lune, mais durant des récréations où le père reste chez lui. Tu penses si j’ai envoyé balader Maurice ! Mais il m’a prié de réfléchir et de n’en parler à personne, notamment au père Lauzon, qui pourrait se piquer en tant que directeur de conscience. Tu ne trouves pas que c’est un peu bizarre ? »
À mesure qu’Alexandre parlait, la stupeur faisait place chez Georges à un immense dégoût. Il plaignait, il méprisait ce prêtre, voué par état à la vérité et qui ne vivait que dans le mensonge. Si les garçons mentaient, c’était pour défendre leur bien, et non pour s’emparer de celui des autres. Le père cherchait à tromper non seulement les maîtres, mais les garçons, et jusqu’à ces derniers entre eux. Il s’attaquait même à ceux qu’il disait aimer. Il se croyait bien fort, mais, à son insu, il était démasqué.
Était-ce réellement à son insu ? Pouvait-il ne pas se douter que l’enfant dévoilerait à Georges ces machinations, et que Georges apprécierait ainsi à leur valeur les assurances de l’autre soir ? Le père s’en inquiétait peu sans doute. Il avait prétendu montrer d’abord que, d’une manière quelconque, il parvenait à ses fins. Pourtant, ses démarches étaient toujours si déconcertantes qu’il aurait peut-être fallu lui faire crédit, précisément dans le cas où elles semblaient des plus suspectes. Peut-être n’avait-il songé qu’à réunir par surprise Alexandre et Georges, comme il réunissait par habitude Georges et Lucien. Mais cette surprise n’était pas pour plaire à Georges ; elle lui répugnait autant que l’idée qui lui était venue hier au dortoir ; elle lui faisait horreur.
« J’espère bien, dit-il à l’enfant, que l’on n’ira pas te relancer. Du reste, ton histoire ne m’étonne qu’à demi. Le père de Trennes est une espèce de fou, dont nous ne comptons plus les extravagances, et il importe de se tenir à l’écart de ses opérations.
— Rouvère et toi, vous êtes assez bien avec lui, puisque vous lui avez servi la messe.
— Pas du tout ! Il nous a enrôlés au pied levé, s’imaginant nous faire plaisir, ainsi qu’à saint Pancrace, que l’on glorifiait. C’était, je le devine maintenant, un moyen de donner le change : tu le vois, ton frère est son grand favori, et jamais encore il ne lui a servi la messe. »
Dès que Georges rentra en étude, le père de Trennes lui fit signe d’approcher. Voulait-il vérifier si l’on avait fumé ses cigarettes ou voulait-il parler du rendez-vous ? Georges monta les degrés de la chaire. Il pensait à la punition qui l’avait accueilli, le jour où il s’était attardé avec Alexandre. Pour le déconcerter une fois de plus, le père allait-il à son tour lui infliger une sanction ? Il lui dit simplement :
« Vous ferez la lecture tout à l’heure au réfectoire. »
La charge de lire pendant le repas était réservée aux élèves des plus hautes classes, qui étaient nommés par le préfet. En troisième, personne, jusqu’ici, n’avait lu.
Georges se demandait quel était le but de cette nouvelle manœuvre. Le père se donnait les apparences de lui être agréable par cette faveur extraordinaire, qui ferait plaisir également à Alexandre. Il avait aussi l’avantage de brouiller les cartes en contrebalançant les révélations de ce dernier. Peut-être enfin se jouait-il à lui-même un simple intermède, sans prendre la peine d’en donner l’explication. Georges n’était pas moins résolu de ne se prêter à ses caprices que dans la mesure où ce fût, comme à présent, selon les règles.
Sauf le dimanche, on n’avait que rarement Deo gratias au dîner, et le père s’était assuré sans doute que cette exception ne se produirait pas aujourd’hui. Qu’avait-il raconté à son ami le supérieur pour motiver cette curiosité, et au préfet pour faire choisir Georges ?
Pendant ce mois de Marie, on lisait La Vie des Saints, alors qu’on avait lu La Vie de la Sainte Vierge au second trimestre. En effet, la méditation de chaque matin étant consacrée désormais aux mystères du rosaire, le supérieur ne traitait plus son sujet habituel qui, au moins quant aux saints principaux, faisait les frais de la lecture au réfectoire. Cela avait dû permettre au père de Trennes de dire que Georges, non content de saint Pancrace, s’était voué au saint de ce jour-là. Mais, duquel était-il question ? Il y en avait deux sur les rangs : d’une part, saint Venant, dont c’était la fête, martyr à quinze ans — un des jeunes saints du prédicateur de la rentrée ; d’autre part, le saint que choisirait le supérieur pour la lecture — ce ne serait pas saint Venant, qui n’était pas un saint d’importance. On quittait à peine saint Jean-Baptiste de la Salle, plus grand rénovateur encore de l’enseignement religieux que saint Pierre Canisius ne l’avait été. Georges regrettait que Tartarin de Taras-con ne fût plus le héros du réfectoire : c’est lui qui, pour le bonheur de tous, avait succédé à la sainte vierge et au vertueux Décalogne. Le supérieur variait les lectures, mais celle de Tartarin avait été passablement expurgée, autant que Georges, qui connaissait l’ouvrage, avait pu s’en rendre compte. Le supérieur corrigeait les morts et les vivants.
La belle saison faisait bénéficier d’une récréation avant le dîner. Georges, après avoir instruit Lucien, déclara qu’à partir d’aujourd’hui, il n’irait plus dans la chambre du père de Trennes. On ne l’emmènerait pas de vive force. Au premier monologue, il se retournerait de l’autre côté. Il en avait assez d’un homme qui soufflait le chaud et le froid, et, en cas d’insistance, n’hésiterait pas à lui dire son fait. Puisque le père avait parlé de noblesse, on lui en donnerait une leçon.
« Je crois, dit Lucien, qu’il était temps de retirer notre épingle du jeu. Alexandre nous a rendu un fier service. Notre père à tous nous a cité le mot de l’Évangile : « Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. » Et nous savons maintenant que, dans la chambre du père, il y a plusieurs camériers : du moment qu’il ne s’est pas contenté de nous, tu penses bien qu’il ne se contente pas davantage de Maurice. Ses élus, ses neveux, les pyjamas, les visages, tout est dans le même sac.
« Il nous a menti. Il fait le contraire de ce qu’il nous a dit : il s’intéresse aux autres et il s’amuse de nous. Nous ne comprenions pas son humeur changeante : c’est qu’il devait y avoir un roulement dans les visites. Ce sera bientôt le secret de Polichinelle, et il en cuira à quelques-uns. André a été renvoyé à cause de moi : toi, tu serais prêt à l’être avec Alexandre. Mais ad patres avec le père de Trennes ? Les fils et non les pères ! »
À la fin de la récréation, Georges se repeigna à la fontaine. Il n’avait pas besoin de lotion : ce n’était plus pour Alexandre. Mais il n’était pas mécontent de s’être fait élégant ce matin. Le soin qu’il avait pris à l’occasion du rendez-vous lui vaudrait une satisfaction publique de vanité.
Il espérait lire aussi bien qu’à la fête de la mi-carême. Il songeait aux lecteurs malheureux qui s’attiraient un coup de sonnette du supérieur, agrémenté d’une remarque impérative : « Trop haut ! » ou « Plus haut ! », ou même, si la phrase ou une expression était mal coupée : « Contresens ! », voire : « Comprenez donc ! »
Lorsque Georges monta dans la chaire, la division des petits se trouvait déjà en place et lui tournait le dos, attendant la récitation du bénédicité. Ensuite, pendant qu’on s’asseyait, le supérieur fit signe à Georges de venir chercher le livre. Rien encore n’avait appelé l’attention d’Alexandre sur le lecteur de ce soir. Georges descendit dans le bruit des tiroirs qui s’ouvraient et des couverts qui tintaient contre le marbre. En longeant les rangées des petits, il donna un léger coup à Alexandre, derrière lequel il passait. Revenu en chaire, il put jouir de la surprise qu’il avait provoquée. Les regards de l’enfant étaient pleins d’une joie mal contenue, mais les siens gardaient le plus possible de discrétion et de gravité : c’est qu’à la table des professeurs, du côté des grands, étaient assis le père Lauzon et le père de Trennes.
La Vie des Saints. La page désignée avait ce titre : « Saint Bernardin de Sienne. Fête, le 20 mai. » Le 20 mai n’était qu’après-demain ; on était en avance. Georges se rappela la citation du père de Trennes, tirée de la vie de ce saint et relative à la chasteté. On le poursuivait jusqu’ici avec la chasteté.
Lucien lui apporta, selon l’usage, sa timbale remplie. Georges la posa sur la tablette intérieure, entre le martyrologe et l’Imitation. Le martyrologe se lisait à midi, et l’Imitation le soir : à l’endroit qu’indiquait dans le livre une carte parfumée — les lecteurs aussi avaient leurs raffinements — un coup d’ongle soulignait le verset de la veille.
Le supérieur était gentil : il laissait au nouvel anagnoste le temps de se préparer, de parcourir ses textes. Georges en profitait pour regarder Alexandre à la dérobée. Il le voyait encore plus parfaitement que l’autre jour du haut de la tribune. L’enfant se servait à la soupière, et ce simple geste contenait tout son charme. Puis il fixa les yeux sur Georges, et, en approchant une cuillerée de sa bouche, il lui envoya un baiser.
Au moins, le père de Trennes ne pouvait voir Alexandre. Ainsi son attention ne troublerait pas le plaisir de l’enfant, même si elle troublait celui de Georges. Et Georges semblait élevé dans cette chaire par les regards de cet enfant et de ce prêtre. Il était entre l’esprit de la lumière et l’esprit des ténèbres, entre Ormuzd et Ahriman, comme le sectateur de ce Mithra dont il avait parlé à ses cousines.
Enfin, la sonnette. Le supérieur se décidait. Georges commença la lecture :
Saint Bernardin de Sienne, frère mineur de l’Observance, apôtre de l’Italie, fête le 20 mai. Bernardin naquit le 8 septembre 1380, le jour de la naissance de la Sainte Vierge, à Sienne, en Toscane, et non, comme d’aucuns l’on écrit, à Massa Carrara…
Suivaient les détails concernant sa famille, son enfance et ses études (à treize ans, il avait fini son cours de philosophie). Le supérieur avait rayé ces deux phrases : Il avait gardé intacte sa chasteté, malgré les dangers auxquels l’exposait la rare beauté de ses traits. Ses camarades n’osaient tenir, en sa présence, de propos dissolus, et lorsqu’ils le voyaient approcher, il disaient : « Ne parlons plus de cela, voici Bernardin. » Les garçons de Saint-Claude n’auraient pourtant pas été tellement étonnés d’apprendre que ceux du xive siècle avaient des conversations répréhensibles : ils savaient déjà, par l’anecdote de saint Edmond, souvenir de leur retraite, qu’au xiie siècle également, les propos des enfants n’étaient pas toujours modestes.
Le passage qu’avait cité le père de Trennes était rayé aussi : ce père savait choisir ses citations ; elles étaient prises dans les éditions complètes. Mais le supérieur avait laissé, sans doute à titre d’exemple, l’histoire que Georges débitait maintenant avec componction et que le père de Trennes aurait peut-être supprimée :
Un homme de qualité ayant fait une proposition déshonnête au milieu de plusieurs écoliers, Bernardin, l’enfant doux et aimable, transporté d’une sainte colère, lui ferma la bouche d’un coup de poing si violent que toute la place en retentit. Le noble libertin, devenu la risée des spectateurs, se retira confus, mais cette correction l’engagea à s’amender. Dans la suite, il rechercha toutes les occasions d’entendre prêcher saint Bernardin et fondait en larmes pendant ses sermons.
À chaque pause, et même parfois en lisant, Georges, comme au début, regardait un instant Alexandre. Par-dessus les professeurs et les élèves, malgré le père de Lauzon et le père de Trennes, il établissait un lien subtil avec cet enfant qu’il baignait dans le son de sa voix : Alexandre ne devait écouter que la voix et non la lecture. Georges aussi était récompensé : il découvrait des aspects nouveaux de celui qu’il connaissait pourtant si bien. Il avait déjà les images d’Alexandre à la chapelle, en étude, dans le couloir, en récréation, dans le train des vacances, sur la terrasse et dans la serre. Il aurait désormais celles d’Alexandre rompant le pain des deux mains, ou d’une seule en appuyant le morceau sur la table ; buvant à sa timbale jusqu’à la dernière goutte en montrant sa gorge claire, ou prenant au bord comme un oiseau ; s’essuyant les lèvres, tantôt furtivement, tantôt avec cérémonie ; dépêchant son supplément de viande (ils prenaient le même supplément) ; mangeant des cerises, dont la couleur se confondait avec celle de sa bouche. Le repas était terminé. Au signal, Georges se leva et lut les versets de l’Imitation. C’était la conclusion du chapitre sur les « Effets admirables de l’amour de Dieu ». Il fallait l’amour de Dieu pour couronner la soirée.
L’amour est circonspect, humble et droit. Il n’est ni lâche, ni léger, ni occupé de choses vaines, mais sobre, chaste, ferme, tranquille, attentif à la garde des sens… Celui qui n’est pas prêt à tout souffrir en vue de suivre la volonté de son Bien-Aimé, ne sait pas ce que c’est que d’aimer…
Georges attendit, avant de descendre, que le réfectoire se fût vidé, il suivait de l’œil Alexandre. À la sortie, l’enfant ne put se retourner, car le préfet de sa division surveillait le défilé, mais il leva la main droite, dernier salut adressé à son ami.
Georges prit place à table, et, dans cette grande salle déserte, aux lumières réduites, on lui servit le repas des professeurs. Il se souciait bien de cet avantage dont les lecteurs faisaient grand cas ! Le visage qu’il avait contemplé lui manquait. Et l’idée d’en être privé ici pour la première fois, lui faisait trouver presque odieux cet isolement. Il essayait de se représenter le dortoir où Alexandre, en train de se coucher, pensait aux paroles de l’Imitation.
Le domestique s’était retiré, en le priant d’éteindre quand il aurait fini. Maintenant, Georges était tout à fait seul. Les cerises de son dessert étaient magnifiques, beaucoup plus grosses que celles que l’on donnait aux élèves, et il y en avait deux poignées. Il en garnit le tiroir d’Alexandre.
L’odeur des lilas remplissait la cour intérieure. Georges se souvenait de ce qu’avait dit le père de Trennes, qu’elle troublait les élèves dans leur sommeil. Elle troublait Georges aussi dans la journée, mais c’est parce qu’elle lui parlait d’Alexandre : souvent, en effet, quand il était en étude, il contemplait, par la fenêtre ouverte, les lilas chargés de fleurs, et il se figurait que leur parfum lui apportait le souffle de l’enfant.
Le père de Trennes se tenait sur le seuil de l’antichambre, à l’entrée du dortoir. Il arrêta Georges au passage.
« Eh bien ! lui dit-il à voix basse, je pense que vous avez eu votre content : rendez-vous secret, lorgnades en public…
— Quel rendez-vous ? » répondit Georges d’un ton brusque.
Il tenait à rompre les chiens tout de suite, à faire savoir qu’il interdisait de chasser sur ses terres. Mais avant de le signifier expressément, il essayait de le donner à comprendre par le procédé de la dénégation. Cela lui était loisible, puisque, à vrai dire, il n’avait rien avoué. Il ne se souciait pas que, pour des yeux prévenus, son attitude au réfectoire eût déposé contre lui. Il n’avait à se justifier de quoi que ce fût devant un père de Trennes ; il n’avait aucun compte à lui rendre de quoi que ce fût.
Le père reprit, doucement, sans paraître piqué :
« Pendant la dernière récréation, M. le surveillant des petits est venu bavarder avec moi. Je lui avais demandé de consigner les sorties de ses élèves, classés par motifs, en vue d’une statistique comparée — j’aime les statistiques. Ce n’a été qu’un jeu pour moi de lui faire préciser que le bénéficiaire d’une visite au révérend père Lauzon s’appelait Alexandre Motier. Or, cette visite coïncide avec votre absence : c’est la preuve de ce que je soupçonnais. Vous auriez pu deviner, dès le premier soir, qu’avec moi, il ne fallait pas jouer au plus fin. Je serai votre ami ou votre ennemi : choisissez.
« Au cours de votre rencontre d’aujourd’hui, vous et votre camarade avez certainement épilogué sur une démarche que j’ai fait faire auprès de lui pour votre bien commun. Je voulais l’amener à être mon pénitent : cela aurait dû vous rassurer, puisque son âme, à défaut de la vôtre, eût été sous mon contrôle. Malgré son refus et votre méfiance, je vous ai ménagé à tous les deux une satisfaction inattendue : celle de vous prodiguer l’un à l’autre pendant le repas de ce soir. Je croyais ainsi vous inspirer tardivement un peu d’amitié ou de gratitude. Malheureusement, je me suis trompé, et le ton sur lequel vous venez de me répondre m’oblige à changer le mien : je ne suggère plus, j’ordonne.
« Demain, pendant la récréation d’une heure, vous irez chercher le jeune Motier, dont j’aurai averti le surveillant, et vous vous rendrez ensemble dans ma chambre. Vous me ferez une sorte de confession réciproque. Cela compensera la confession privée à laquelle vous vous êtes dérobé personnellement. Le pardon sera le prix de votre sincérité. »
Georges n’espérait pas s’endormir rapidement cette nuit, mais il ne songeait plus à pleurer, même de rage. Froidement, il venait de décider la perte de cet homme, comme il avait décidé celle d’André. Ce projet-là ne lui inspirait aucun scrupule. Il n’était pourtant pas sensible à l’idée d’accomplir une bonne œuvre en débarrassant le collège d’un tel homme, après l’avoir débarrassé d’un tel garçon. Il ne se souciait pas de l’intérêt général ; c’était le sien qui était en cause. Il avait hésité à l’égard d’André, qui ne lui avait rien fait ; il n’avait pas à hésiter à l’égard du père, qui lui voulait du mal. Celui-ci avait su parfois se montrer aimable, et il se montrait toujours intéressant, mais il était encore plus faux et encore plus fourbe : le pacte tacite était brisé.
Dès demain matin, Georges verrait avec Lucien ce qu’il y avait à faire. Ce dernier ne serait-il pas ravi de venger André au détriment d’un de leurs maîtres ? Évidemment, l’entreprise d’aujourd’hui était pleine de risques. Le père tenait en son pouvoir tous ses complices, qui s’accusaient en devenant ses accusateurs. Son prestige, son savoir-faire, la confiance du supérieur le protégeaient. Fallait-il définitivement reconnaître qu’il était le plus fort et passer par ses volontés ? Cette idée oppressait Georges comme un cauchemar. Pour appeler le sommeil, il restait immobile sur le dos.
Il entendit le père qui rentrait dans le dortoir. Ainsi qu’à l’ordinaire, le chapelet bruissait contre la soutane. Cet homme priait-il vraiment ou n’en faisait-il que le simulacre ? Comptait-il des indulgences, comme Lucien autrefois ? S’il était membre de la Confrérie du Rosaire, cela lui faisait deux mille vingt-cinq jours d’indulgence par grain. Ou comptait-il ses victoires, comme Charles-Quint ? Des victoires sur le péché ou les victoires du péché ? Il pouvait compter beaucoup de choses, puisqu’il aimait les statistiques : le nombre de ses citations, le nombre de ses élus, le nombre de ses neveux.
Georges eut le pressentiment que le père se dirigeait droit vers lui, peut-être en vue de rengager la conversation. Il fit semblant de dormir. On s’arrêta un moment devant son lit, puis on s’approcha de son chevet. Il sentit une haleine parfumée sur son visage. Il était ému au dernier point, mais parvenait à conserver les apparences du repos. Jamais il n’avait vécu de la sorte, en feignant de dormir, une scène qui le concernât. Aurait-il le jeu de la rose ou celui de la lampe électrique ? Il n’attendait que cela pour avoir l’air de se réveiller et demander au père très sérieusement de le laisser tranquille.
Mais celui-ci s’éloigna et fit deux ou trois fois le tour du dortoir. Il s’arrêta devant un autre lit et s’approcha de l’occupant, ainsi qu’il venait de le faire : c’était le lit de Maurice. Georges, avançant la tête jusqu’au bord du traversin, put mieux observer. Le père s’était assis sur la tablette et se penchait. Il complétait sans doute cette revue des visages, dont il avait parlé. Mais Maurice leva la tête : c’est qu’il y avait conversation. On n’entendait même pas le murmure des voix ; rien d’étonnant que ces entretiens n’eussent attiré l’attention de personne. Enfin le surveillant regagna sa chambre. Peu après, Maurice se levait, arrangeait ses couvertures avec précaution et s’éloignait discrètement. La porte du père de Trennes s’ouvrit devant lui.
Georges, palpitant, restait les yeux fixés sur le cadre d’ombre de l’entrée, et sur cette fenêtre intérieure non moins obscure, mais derrière laquelle le rideau avait dû être fort exactement tiré. Cela ne l’empêchait pas de voir la chambre aussi bien que s’il y fût — les biscuits et la bouteille de liqueur, le prie-Dieu, les flacons de toilette, le tub en caoutchouc — et au milieu, tout seul, Maurice.
Telle une flèche, l’idée lui vint que l’occasion d’en finir était trouvée. De nouveau, le miracle s’offrait à lui, comme au temps lointain d’André. Il ne savait qui remercier, des dieux ou des saints.
Certes, le sort du père était réglé. Le seul fait de recevoir un élève en tête à tête dans sa chambre, à cette heure indue, le condamnerait sans appel. Georges avait quelque regret que précisément ce fût Maurice qui se trouvât compromis. Mais il n’y pouvait rien. Il lui était indispensable d’agir sur l’heure. Demain, expirait l’ultimatum qu’il avait reçu au sujet d’Alexandre, et ce soir, le provocateur était à sa merci. Il avait fallu bien des choses pour renverser leurs positions. Est-ce qu’un tel avantage se représenterait ? Aujourd’hui, Georges avait le choix entre vaincre et être vaincu, entre tuer le diable ou que le diable le tuât. Cette réflexion lui fit réprimer son mouvement de sympathie en faveur de Maurice. D’ailleurs, n’était-ce pas Maurice qui avait été chargé de surveiller Alexandre pendant les vacances ? On allait montrer au père Lauzon ce que c’était que son surveillant, comme on allait montrer au supérieur ce que c’était que le sien. Et n’était-ce pas Maurice qui avait tenté d’intéresser Alexandre au père de Trennes et de l’emmener chez lui ? Il paierait tant de cynisme ou de naïveté. Il serait sacrifié pour sauver ce frère cadet qu’il avait voulu corrompre. C’était très édifiant.
Georges pensa à réveiller son voisin, afin de délibérer avec lui. Il était bien sûr que le père ne prêtait pas l’oreille derrière le rideau. Mais il se dit que Lucien, étant donné son sentiment sur le cafardage, risquait fort de ne pas être de son avis et le jugerait sévèrement de passer outre. Georges savait ce qu’il avait à faire. C’était d’Alexandre et de lui qu’il était question. Il n’avait pas plus à mettre Lucien au courant de sa conduite envers le père de Trennes que, sur les conseils de Lucien, il n’y avait mis Alexandre. Tout seul, il répondrait à la cafardise par le cafardage.
Il se leva, mit ses pantoufles, endossa son veston par-dessus son pyjama, arrangea le chevet de son lit de façon à dissimuler son absence, comme le père le lui avait appris. Puis, s’agenouillant, il détacha de son petit carnet un feuillet qu’il posa sur sa boîte de toilette, et, à la clarté diffuse de la veilleuse, il écrivit en lettres capitales : Allez donc à l’instant chez le père de Trennes. Il compta de ses doigts ; c’était un alexandrin — un alexandrin qui allait sauver Alexandre. Le supérieur serait ravi. Il sentirait que toute la pointe était dans ce « donc ». Il accourrait en scandant le vers, curieux de savoir quel commentaire il allait surprendre à l’admirable sermon que le père avait encore déclamé dimanche.
Georges se souvint que les tranches de son carnet étaient dorées, détail qui risquait de le faire découvrir si le surveillant voyait cette feuille. Il la mit dans sa poche et arracha une page à un cahier qui se trouvait dans son tiroir. Il refit l’inscription et la relut. Sa main, qui avait été si ferme en écrivant, tremblait ensuite en tenant le papier. C’était là de beau travail, encore plus beau que pour André. Ce n’était pas du cafardage, de l’ostracisme ; ce vers de douze pieds était une lettre anonyme. La honte d’une pareille infamie accabla Georges un instant. Invoquerait-il de nouveau les lois de la chevalerie ? « Nul chevalier sans prouesse » : une seule ne lui suffisait-elle pas ? Mais, mieux que n’avait pu faire en octobre l’image de Lucien, celle d’Alexandre lui commandait d’être impitoyable.
Il plia le papier, le prit d’une main, sa lampe électrique de l’autre, et s’avança tout doucement. Devant la chambre du père, l’odeur des cigarettes lui parvint. Ce devait être du tabac d’Égypte.
Le couloir était plongé dans les ténèbres. Georges alluma sa lampe. Il lui semblait être un voleur faisant un mauvais coup. Comparant, selon son habitude, le présent au passé, il se rappelait sa précédente sortie nocturne, après la saisie du billet d’Alexandre. Il s’était dévoué, ce soir-là, pour l’enfant qui avait été puni à cause de lui. Aujourd’hui, il allait livrer un de ses maîtres et un de ses camarades, mais c’était encore pour cet enfant.
Du bureau, aucune lumière ne filtrait. Cette fois, le supérieur était couché. Georges déplia le feuillet et l’introduisit sous la porte, tournant en haut le côté écrit. Puis il donna du poing dans le battant. Ah ! on allait le réveiller, M. le supérieur ! Il n’y eut aucun écho. Le supérieur avait-il un sommeil de plomb, à l’ombre des ailes de l’Aigle de Meaux ? Georges se posa cette question, mais ne s’inquiéta pas outre mesure : il arriverait bien à se faire entendre. Il ne craignait pas davantage que son billet ne parût une mystification : il craignait seulement que le lecteur n’arrivât trop tard. Si ce n’est en flagrant délit, comment convaincre le père de Trennes ? Il y avait déjà cinq bonnes minutes que Maurice était en visite, et Georges estimait qu’au-delà d’un quart d’heure, l’affaire était manquée. Furieux à l’idée d’un échec possible, il heurta avec plus de force. Enfin, la voix qu’il connaissait répondit de l’intérieur. Il heurta de nouveau, voulant confirmer qu’il y avait bien quelqu’un, et se jeta hors de la pièce. Il courut le long du couloir, frôlant la muraille pour se guider. Il toucha la porte du dortoir. Il était arrivé sans avoir allumé sa lampe. Il s’arrêta, effrayé à l’idée que le père l’attendît comme tantôt. Et le supérieur qui allait venir ! Le traître allait-il se trouver pris entre deux feux ? Réunissant trois gentilshommes, la scène n’aurait été que plus piquante.
Georges ôta ses pantoufles et, pieds nus, se glissa devant la chambre du surveillant. Il se baissa en passant dans l’allée. Près de son lit, il retira en hâte son veston, le mit à la même place, afin qu’aucun changement ne fût visible, et se faufila sous les draps qu’il avait laissés pendre. Il éprouvait une impression tout autre que le soir où il attendait en étude la catastrophe d’André. Il ne redoutait plus la suite des événements. Certes, il avait été ému par sa course ; il l’avait été déjà, lorsque le père s’était approché de son lit et qu’il avait vu Maurice quitter le sien, mais après tant d’agitation, il était calme. Il lui tardait seulement de contempler le spectacle organisé par lui et dont il serait le spectateur unique. C’était une façon d’œuvre littéraire, qui, en outre, préserverait son bonheur et exercerait sa vengeance.
On venait d’entrer dans le dortoir. On frappait chez le père. Georges se souleva légèrement. Il scrutait cette antichambre toujours aussi obscure, mais où il devinait une silhouette. Alors, soudain, son émotion fut intense : il comprit ce qu’il avait fait. Un bref dialogue s’était engagé, les voix étaient basses, puis celle du supérieur dit plus haut : « Ouvrez, je vous l’ordonne ! » C’était le tour du surveillant d’entendre ce mot.
Un flot de lumière jaillit : le père de Trennes et le supérieur étaient face à face. Georges, dans le tumulte de son cœur, ne pouvait plus écouter. Bientôt, Maurice apparut et regagna son lit, étouffant des sanglots. La porte de la chambre était restée grande ouverte : un instant, le père de Trennes prit un air de défi, mais sans que son visiteur, qui le regardait fixement, eût dit une parole, il inclina la tête peu à peu et tomba à genoux. Puis la porte s’était fermée sur les deux hommes.
Georges regardait les lits de ses camarades. Personne ne bougeait. Personne que lui n’avait assisté à ce dénouement. Personne ne saurait donc que le père de Trennes, malgré son orgueil, sa science, son ironie, ses perfidies, avait dû s’humilier devant le supérieur, qui n’était plus son ami, mais son juge et le représentant de son ordre. Le sommeil du dortoir n’avait pas été troublé par cette catastrophe, pas plus qu’il ne l’était par les larmes de Maurice. Seuls, veillaient ici les deux témoins de la dernière visite que le père aurait reçue.
Au milieu de ce silence et près de tant d’orages, Georges trouvait son lit plein de douceur. Ses remords cédaient peu à peu au plaisir d’avoir atteint son but. Sans doute, il avait pitié de Maurice, dont la détresse lui rappelait celle de Lucien, le soir du châtiment d’André. Sans doute même, avait-il pitié du père de Trennes qui allait subir mille avanies parmi les siens. Mais après tout, ils avaient l’un et l’autre ce qu’ils avaient cherché. Il ne leur restait qu’à se convertir, comme Lucien l’avait fait. Georges les avait remis sur la route du ciel. En vérité, quel convertisseur il était ! Ses amitiés ressemblaient à des dragonnades. Tant de gens travailleraient à son salut qu’il n’aurait plus à y songer.
En attendant, il s’était tiré d’embarras sur la terre. Il était libre. Il redevenait le maître de sa destinée. Mieux que l’autorité et la règle restaurées par le supérieur, c’était lui, en effet, qui continuait de triompher. Une fois de plus, et aux dépens de celui à qui il devait cette formule, il était le triomphateur secret. Il avait fait lever le supérieur, il avait fait agenouiller le surveillant et il n’était qu’un garçon de quatorze ans et dix mois, sur la version latine de qui, rendue ce jour-là, le professeur avait écrit en note : « Vous auriez pu mieux faire. » Ce qu’il avait fait ce soir n’était pas mal. La scène qu’il avait provoquée était peut-être encore plus suggestive pour un peintre que pour un écrivain. Elle méritait d’être proposée comme sujet de concours, non à l’Académie des Palinods, mais à l’Académie des Beaux-Arts. Ce serait dans le genre des grands tableaux de musées : « Théodose implorant saint Ambroise sous le porche de la cathédrale de Milan », « Louis le Débonnaire faisant pénitence devant les évêques à Attigny », « L’empereur Henri IV aux pieds de Grégoire VII à Canossa » — tout cela autrement dit : « Un barbier rase l’autre. »
Il y avait des chances qu’en ce moment, les deux héros de l’histoire présente, et dont l’un au moins était bien rasé, fussent à genoux côte à côte, priant à qui mieux mieux. Mais sûrement aussi que leurs pensées étaient ailleurs, comme celles des élèves pendant les prières. D’abord, le père de Trennes savait-il comment il se faisait que le supérieur se trouvât là ? Ce dernier, qui n’avait pas expliqué à André la découverte du poème, expliquerait-il au père la raison de sa visite ? Et celui-ci se croirait-il la victime du hasard, d’un confrère ou d’un élève ? S’il soupçonnait Georges, lui pardonnerait-il son coup de poing avec la même soumission que le gentilhomme de Sienne avait pardonné à saint Bernardin ? Il voyait bien qu’il avait poussé à bout ce garçon. Il avait abusé des droits que lui conféraient l’antiquité et la vie des saints. Ses appels en faveur de la pureté devenaient trop fiévreux, ses citations trop pressantes, et il avait oublié celle-ci, qui était pourtant de Musset et parlait des élus :
Vous les voulez trop purs, les élus que vous faites !
On demandait à respirer.
De son côté, le supérieur devait être assez intrigué par la façon dont il avait été averti. Il comprenait bien, évidemment, que c’était par quelqu’un du dortoir. Lui qui avait naguère repris Georges d’en être sorti sans permission, il était fondé à se dire que, ce soir, on n’avait pas eu le moyen de faire autrement, et qu’il y avait de très bonnes choses qu’on pouvait faire sans permission. De toute manière, il y verrait une preuve de vertu qui le rassurerait sur ses élèves, même s’il se montrait aussi inexorable avec Maurice qu’il l’avait été avec André.
Quelle qu’en fût la solution, Georges n’arrivait pas à s’alarmer de cette affaire. Maurice expulsé, certainement qu’Alexandre l’accompagnerait, l’an prochain, dans un autre collège, et Georges suivrait, comme il avait promis — et Lucien également, pourquoi pas ? Là, Georges s’emploierait à réparer ses torts envers Maurice, de même qu’il s’y était employé auprès de Lucien. Maurice n’aurait rien perdu au change. On lui trouverait un ami, quelque chose de bien. André les rejoindrait. À eux six, ils n’auraient plus à craindre le reproche d’avoir des amitiés particulières. C’est pour le coup que leur association s’appellerait Collegium Tarsicii.
D’ailleurs, Georges, Alexandre, Lucien, d’autres encore, ne seraient-ils pas contraints de quitter Saint-Claude, à titre de sanction ? Il suffisait que le surveillant, par scrupule ou par vindicte, racontât les petits secrets de la maison. Dans ce cas, la prescription serait presque générale. Elle était de ce fait, impossible. Le supérieur, tout le premier, se refuserait à croire que Saint-Claude fût un tel foyer d’abominations.
Les accusés eux-mêmes, s’ils voulaient, pouvaient ne pas se laisser faire. Ils avaient de quoi répondre aux médisances du père de Trennes. Georges pensait à la menace qu’avait faite Alexandre d’écrire au pape, lorsque son confesseur avait voulu le priver de la communion. Ici, on menacerait d’écrire au gouvernement. Ce serait une affaire à tout casser.
En attendant, le père de Trennes allait déloger. Où irait-il ? Pas dans un autre collège, comme ses collégiens. Il conserverait accès auprès de ses neveux ; il cultiverait en paix le népotisme. S’il s’était vraiment converti, il entrerait dans un couvent. Il pourrait y méditer à loisir le sermon classique Sur le petit nombre des élus et en tirer profit. À moins qu’il ne se contentât de changer d’ordre, au cas où ce serait chose faisable. Là, les renseignements de Georges étaient en défaut : il avait retenu seulement qu’il y avait environ cent cinquante ordres d’hommes. Par conséquent, dans la mesure du possible, le père de Trennes n’aurait que l’embarras du choix. Mais probablement qu’il se consolerait plutôt du côté de l’archéologie. Il repartirait pour le Proche-Orient, reverrait la Grèce. Les temples antiques lui serviraient d’asile, quoique les maximes des Templiers ne lui eussent pas servi de sauvegarde.
« Bon voyage, mon père ! se disait Georges. Excusez-moi de vous avoir chassé des remparts et de la ville. Peut-être nous retrouverons-nous un jour dans la patrie de Théognis.
« Et vous, monsieur le supérieur, qui priez dans cette chambre où Lucien et moi avons prié, excusez-moi aussi de vous faire suivre à la lettre le : « Priez et veillez ! » Cependant, il serait de votre intérêt, à l’avenir, de prier un peu moins et de veiller davantage. »
Quoi ! Maurice avait une nouvelle crise de larmes ! Voyons, cher confrère ! Vous qui êtes un homme avec les femmes, ne seriez-vous qu’un enfant avec les hommes ?
Georges se mit de côté et releva le drap sur son oreille, afin de ne plus entendre.
Au réveil, tous les regards se dirigèrent vers le préfet, qui récitait la prière : « Mon Dieu, c’est par un effet de votre bonté… » La plupart des élèves devaient supposer que le père de Trennes était souffrant. Maurice paraissait à son aise, ce matin. Il portait maintenant ses secrets avec la même insouciance que Georges. Ou bien il se résignait à son sort, ou bien, ayant réfléchi, il était sûr d’être épargné.
On descendit à la méditation. Le supérieur avait le visage empreint de fatigue. On devinait qu’il n’avait pas dormi. Il n’était pas rasé. Georges songea à la phrase du père de Trennes sur le « visage honorable de l’homme ». Aurait-il pu ne pas songer aussi à cette réunion d’un soir d’octobre, où l’expulsion d’André avait été annoncée officiellement ? Il se demandait quelles seraient les nouvelles de ce matin printanier, mais se rassurait d’avance quant à l’essentiel : il savait que son sort était lié à celui de ses amis.
Le supérieur lut, d’une voix sourde, un texte relatif aux mystères douloureux du rosaire, dont les fruits devaient être notamment le repentir, la mortification et le salut des âmes. Cela avait bien l’air d’une allusion, pour ceux qui étaient capables de comprendre. C’était comme la conférence du prédicateur, le jour où, en la personne d’André, avait été condamné le libertinage de l’esprit. Néanmoins, Georges s’étonnait que le supérieur n’en dît pas davantage : la disparition du plus remarquable de ses surveillants valait la peine d’être expliquée. Était-il gêné, ce supérieur, à l’idée qu’un élève, dont il revoyait les traits, avait été surpris par lui dans la chambre dudit surveillant, et qu’un autre, qui lui resterait inconnu, avait dénoncé ce scandale ? C’était, en effet, un scandale, qu’il hésitait peut-être à dénoncer de nouveau : la communication au public était plus délicate qu’à propos d’André. Il en rougissait et pour l’ordre et pour la maison. Mais il aurait pu se rappeler le proverbe que, « par la faute d’un moine, l’abbaye ne faut pas ».
Lorsque la cloche sonna, il ferma son livre sur les mystères et regarda toute l’étude. Georges, malgré lui, frémit un peu : le moment était arrivé. Lentement, le supérieur dit ces mots, d’un ton grave qu’on ne lui avait jamais entendu :
« Je vous demanderai de consacrer vos prières et vos communions de ce matin à M. de Trennes, qui nous a quittés. »
L’oraison funèbre du père de Trennes aurait été plus courte que celle de Nicolas Cornet.
Quel coup de théâtre dans la division ! Presque tous avaient une raison de s’émouvoir : les plus jeunes, parce que le père de Trennes s’intéressait à eux, les autres, parce qu’il les intéressait. Beaucoup prirent un air sérieux : ils se demandaient sans doute si cet événement n’aurait pas pour eux de fâcheuses conséquences. Comme Lucien l’avait pressenti, il y avait bonne chambrée. En si peu de semaines, le père de Trennes avait donc fait tant de ravages ? L’année se fermait sur une affaire encore plus passionnante que celle qui l’avait ouverte. Tandis qu’on allait à la chapelle, le souvenir d’André fut évoqué à travers les rangs. C’était par ceux qui cherchaient à se rasséréner, en disant qu’on n’avait signalé, parmi eux, aucune brebis galeuse. Après tout, n’avaient-ils pas raison ? Il ne fallait pas s’alarmer outre mesure. Cette fois, ce n’est pas du côté des garçons qu’il y avait eu de la mousse ; les pères se lavaient les mains entre eux.
Pendant l’office, Lucien demanda à Georges ses impressions personnelles.
« C’est Maurice qui s’est fait pincer, répondit Georges. Je lui trouve un curieux air. »
Lucien se retourna et jeta un coup d’œil vers le frère d’Alexandre.
« Il est plongé dans son livre, dit-il. Tout le monde est plongé dans les livres. Le père de Trennes sera content : il avait commencé par solliciter nos prières, à toi et à moi, et maintenant, la division entière prie pour lui, ou du moins en fait semblant. »
Georges aurait pu lui dire que le père de Trennes avait eu déjà cette nuit les prières du supérieur. Il aurait pu lui rappeler qu’André avait été recommandé également à celles de la division. Tout ici commençait et finissait par des prières. Pendant trois mois, Lucien avait prié pour Georges ; si peu que ce fût, Georges avait prié pour Lucien. De toute façon, à Saint-Claude comme dans les vers de Fersen, les cœurs étaient en prière, lorsque les âmes n’y étaient pas.
Maurice se rendit à la sainte table, avec une ferveur marquée — celle du Lucien de jadis, en état de grâce illuminative et purgative. Il n’y eut pas une seule abstention chez les grands : ce fut une communion unanime. On devait bien cela au supérieur, sinon au père de Trennes.
Durant le petit déjeuner, fait extraordinaire, le Deo gratias ne fut pas donné. Tant mieux : on aurait terminé plus tôt, la récréation serait plus longue. Georges avait reçu le sourire d’Alexandre : l’enfant, bien loin de ces révolutions dont il était la cause, venait de trouver sous sa serviette les cerises du dîner.
Dans la cour, on entoura le surveillant de naguère, qui avait repris ses fonctions. On lui demanda pourquoi le supérieur avait dit « M. de Trennes » et non « le père de Trennes », si cela signifiait que le père quittât les ordres en vue de se consacrer à ses travaux scientifiques. Mais le surveillant répondit que celui qui était prêtre le restait : « Tu es sacerdos in aeternum. » On affecta d’en conclure que l’expression du supérieur avait été un lapsus. Ce départ devait avoir les raisons les plus simples : suivant ceux-ci, le père avait un malade dans sa famille ; suivant ceux-là, il avait fait un héritage. Le surveillant se débarrassa de ces facétieux en les obligeant à jouer — il faudrait en reprendre l’habitude, mais on se réclama encore, pour aujourd’hui, des licences que donnait le père de Trennes.
Un groupe important, où toutes les classes étaient représentées, dissertait dans un coin. Georges et Lucien s’en approchèrent, voyant que Maurice s’y trouvait. Il s’agissait là, non de se moquer de l’actuel surveillant, mais de chercher la vérité sur l’ancien. La vérité ? C’était beaucoup dire : les orateurs semblaient vouloir se la masquer les uns aux autres, en usant des ressources de l’équivoque, chères à celui dont ils parlaient. Maurice suggéra que le père eût été compromis par une liaison féminine hors de l’établissement. Mais était-ce chose possible dans le village, où il n’y avait que des gardeuses de dindons, et dans la petite ville voisine, qui était à une heure de bicyclette ? Un jeune gaillard de quatrième présenta comme plus vraisemblable l’hypothèse d’une intrigue avec certains de ses camarades, pour qui le père avait eu des amabilités. On demanda lesquels, mais l’interpellé se refusa à les nommer. Lucien rappela que, si cela était vrai, les malheureux ne seraient déjà plus ici. Un autre revint à la charge et ne cacha pas qu’il avait toujours soupçonné quelque chose au dortoir : une nuit qu’il s’était réveillé, il avait vu le père de Trennes regarder certains des dormeurs avec une lampe électrique. Mais Georges interrompit les commentaires, en affirmant que le père lui avait confié qu’il récitait son chapelet pour ceux qui dormaient mal.
Un des grands déclara que ces histoires n’avaient pas le sens commun. Il estimait que le père de Trennes ne se souciait pas plus des dindonnières que des jeunes élèves ou du chapelet. C’était, déclara-t-il, un savant, un esprit large, un sceptique ; il était populaire ; il avait la sympathie des grands. Il n’en fallait pas davantage pour rendre jaloux les professeurs, qui avaient monté une cabale contre lui. Le coup était signé de ces messieurs.
Un philosophe approuva cette manière de voir, tout en estimant que la chose venait de plus haut. Le père de Trennes essuyait le courroux, non des professeurs de Saint-Claude, puisqu’il n’était pas appelé à rester parmi eux, mais d’autres membres de son ordre, auxquels sans doute il portait ombrage. Il allait avoir à rendre compte, Dieu savait de quoi ! On lui reprochait peut-être de relever des temples païens. Le philosophe rappela les différentes devises des ordres religieux : « Ad majorem Dei gloriam », « Ut in omnibus glorificetur Deus », etc. Toutes ces persécutions entre prêtres se faisaient au nom de Dieu. Autrefois, on aurait mis le père dans un in pace, il aurait été au pain et à l’eau. Heureusement au moins que l’Inquisition n’existait plus. Voltaire et les Droits de l’Homme avaient rendu service au clergé lui-même.
Pendant l’étude de dix heures, le préfet vint chercher Maurice. Lucien poussa Georges du coude, comme pour le féliciter de ne pas s’être trompé. D’après les regards qui s’échangèrent, l’opinion générale fut identique. Les discours tenus en récréation faisaient place aux réalités. On avait vite oublié le danger, mais il existait. C’était maintenant aux élèves à connaître l’épreuve : la décimation commençait. Maurice serait-il subtilisé, à la façon d’André ? Lucien n’était-il pas un peu inquiet ? Georges, penché sur sa version grecque, revoyait le père de Trennes, ce prêtre qui aimait tant le grec et qui, avant de partir, avait décidé de son destin. Enfin, la porte se rouvrit, et tout le monde leva la tête : Maurice rentrait. Il affectait un air goguenard. Au bout d’un moment, quand il n’y eut pas eu d’autre appel, l’étude parut allégée d’un poids. On revivait.
Son devoir recopié, Georges emprunta à la bibliothèque de l’étude, un petit précis de droit ecclésiastique. Tranquillisé pour lui-même, il était préoccupé de ce que le père de Trennes pouvait encourir du fait de son état. L’idée de l’in pace avait travaillé en lui. Il constata que le « délit » du père n’était pas au nombre des « cas réservés », et échappait, par conséquent, aux « peines médicinales, autrement dites censures » : l’excommunication, l’interdit et la suspense. Quant aux « peines vindicatives ou de satisfaction », elles ne risquaient de frapper le père qu’ « à titre temporaire » et non « perpétuel ». Restaient les « sanctions disciplinaires » : jeûnes spéciaux, aumônes, œuvres pénitentielles, exercices spirituels dans une maison religieuse. Partout et toujours, les exercices du père de Trennes seraient spirituels.
Après le repas de midi, comme on arrivait en récréation, Georges fut avisé par le surveillant que le supérieur désirait lui parler. On se montrait plus discret à son égard qu’avec Maurice, mais ce n’était peut-être que plus mauvais signe.
« Maintenant, ça y est, dit-il à Lucien : Ave, moriturus te salutat. »
Le supérieur n’était pas mal inspiré, touchant ainsi à la fois le complice du père et son dénonciateur. Déjà, avant le déjeuner, lorsque le préfet avait signalé à Georges qu’il ne ferait pas la lecture, celui-ci avait eu un premier pressentiment. On se débarrassait de lui bien vite. L’honneur qui lui avait été fait était assez indu, mais il l’avait bien porté : on aurait pu lui laisser lire la vie d’un saint de plus. À présent, il savait les raisons qui l’avaient rayé à jamais de la liste des lecteurs et inscrit sur une autre liste.
D’ailleurs, il s’en moquait. Ses velléités combatives de la nuit dernière s’étaient apaisées. Il jugeait toute défense inutile, et, du reste, il en avait assez de se défendre. Il ne ferait pas la moindre réponse, écouterait, sans broncher, l’annonce de son exclusion, s’étant assuré seulement qu’Alexandre aussi était exclu. Toutefois, avant de quitter le bureau, il tendrait au supérieur l’original du mystérieux message qui avait été glissé sous sa porte : il y aurait un homme bien embarrassé.
Georges entra, aussi tranquillement que si c’eût été à l’Hôtel de Rambouillet. Le supérieur était assis à contre-jour, près de la fenêtre ouverte, qui laissait pénétrer l’odeur des lilas. Pouvait-il se douter qu’elle rappelait à son visiteur les propos du père de Trennes et l’image du petit Motier, c’est-à-dire les deux personnages à cause de qui, sans doute, il le convoquait ? Il lui montra un siège.
« J’ai remarqué, dit-il, que vos places en composition sont moins bonnes, depuis les vacances de Pâques. »
Il se pencha afin de prendre un papier sur son bureau et, le consultant :
« Vous avez été quatrième en anglais, au lieu que vous étiez second au trimestre précédent et que vous aviez été d’abord premier. Vous êtes troisième en version latine, après avoir été deux fois premier. En thème grec, vous aviez été une fois troisième et une fois second, et vous saurez dimanche que le dernier résultat est moins satisfaisant. Bref, sauf en version grecque, vous avez décliné dans toutes les compositions qui ont eu lieu jusqu’ici. À quoi tient cela, mon enfant ? »
Georges répondit, en souriant, que ce devait être sans doute la mauvaise fortune, car il avait conscience de faire les mêmes efforts ce trimestre-ci, aiguillonné, en outre, par la perspective prochaine de la distribution des prix. Là où, néanmoins, il avait faibli, il comptait sur la dernière composition — la « composition secrète », celle dont les résultats n’étaient pas publiés — pour regagner le terrain perdu.
« Je craignais, dit le supérieur, que l’on ne vous eût distrait dans votre travail, dans vos pensées.
— Si l’on m’avait distrait, dit Georges, j’aurais aussi démérité en version grecque. »
Quand il avait songé à ne pas répondre, c’est qu’il se voyait déjà accablé, mais les événements prenaient une tournure plus favorable et qui ne laissait pas de le charmer.
« Il est vrai, reprit le supérieur, que je connais votre fréquentation des sacrements, votre piété, J’ai même su que vous aviez un culte à l’égard de saint Bernardin de Sienne, et je vous en félicite. »
Georges prit un air modeste, comme le jour où on l’avait félicité de s’intéresser à saint Tarsicius. Il était assez fier, au contraire, d’avoir deviné l’artifice par lequel on l’avait fait désigner hier au soir.
Le supérieur se pencha vers lui et saisit sa main.
« Mon enfant, regardez-moi bien en face. Vous êtes ici en pleine lumière, et je lis dans vos yeux comme si je lisais dans votre âme. »
Après une brève pause, il dit lentement :
« Vous avez été sous l’influence de M. de Trennes. »
Georges fit l’étonné :
« Moi ? pas du tout, monsieur le supérieur !
— Qui donc est intervenu pour la lecture au réfectoire ?
— Le père aimait à faire plaisir sans qu’on lui eût rien demandé. »
Georges avait employé, sur un ton différent, la même défaite qu’avec Alexandre à propos de la messe de saint Pancrace. Le supérieur n’avait pas besoin d’évoquer cet autre souvenir, d’une honorabilité incontestable.
« Votre réponse me touche, dit-il, à cause des sentiments qui me liaient à M. de Trennes, mais ma légitime curiosité doit aller plus loin. Il s’agit d’intérêts fort graves, qui m’obligent à vous parler clairement. Du moins, dans cette affaire, comme dans celle qui vous avait déjà conduit auprès de moi (comparaison n’est pas raison), je suis heureux, en quelque sorte, de rencontrer un garçon de qualité, d’honneur et de devoir tel que vous. Les circonstances vous ont élu pour m’éclairer, si ce n’est pour me rassurer. Je ne m’adresserai d’ailleurs qu’à vous seul. Je ne doute pas que vous ne compreniez la portée de mon interrogatoire, en même temps que la nécessité de garder envers les tiers un religieux silence sur tout ceci. J’ajoute que votre témoignage sera ignoré du principal intéressé, et qu’il n’aura aucune suite à l’égard de personne dans cette maison. Mais n’oubliez pas que vous engagez votre responsabilité — en dehors du plan surnaturel — d’abord devant moi, ensuite devant les enfants qu’au titre de prêtre, M. de Trennes peut avoir l’occasion d’approcher. Songez à la parole divine : « Malheur à l’homme qui scandalise un enfant ! »
« M. de Trennes a le don d’inspirer confiance, et, d’après ce qu’il m’a dit, beaucoup d’élèves lui demandaient des conseils de direction. Mais ce qu’il m’importe de savoir, c’est s’il n’y a pas eu, sous ce couvert, d’imprudences regrettables. Pour cela, je me bornerai à vous poser deux questions : vous êtes-vous jamais rendu dans la chambre de M. de Trennes la nuit ? Et avez-vous remarqué que d’autres s’y rendissent ? Je ne demande ni détails ni personnalités, mais un « oui » ou un « non » : cela me suffira. »
De nouveau, Georges avait paru étonné : c’était à l’énoncé de la première question. Puis, il avait voulu faire semblant de réfléchir à la seconde. Il était ému de se voir le juge de celui qu’il avait trahi. Cet homme avait prétendu lui arracher des aveux contre lui-même, et on prétendait lui en arracher maintenant contre cet homme. Mais non ! Après s’être sauvé de ses embûches, Georges allait le sauver du châtiment. Il lui rendrait intact son avenir, qu’il craignait d’avoir atteint. Il le laisserait libre de rester ce qu’il était, comme André l’était resté, comme, ici, chacun le restait.
L’argument de la responsabilité ne l’attendrissait guère. C’est d’abord au père de Trennes qu’il devait réparation : il corrigerait par le mensonge le mal qu’il lui avait causé en révélant ses mensonges. Quant aux enfants dont il fallait préserver l’innocence, ils s’en tireraient comme ils pourraient. Le supérieur n’avait qu’à lire saint Augustin, selon les références de M. de Trennes. Il en apprendrait plus à ce sujet, avec l’évêque d’Hippone qu’avec l’évêque de Meaux, et il ajouterait peut-être cette paraphrase à la malédiction prononcée contre les hommes qui scandalisent les enfants : « Mais combien d’enfants scandaliseraient les hommes ! »
En attendant, il devait être déjà à moitié satisfait par l’attitude de Georges, puisqu’il lui renouvela simplement la dernière question :
« Eh bien, dit-il, n’avez-vous rien observé ? »
Georges le regarda droit dans les yeux et répondit avec calme :
« Non, je n’ai jamais vu aller personne chez le père de Trennes, pas plus que je n’y suis allé. Il me semble également que, si quelqu’un y était allé, je l’aurais entendu dire. »
En sortant, il déchira le feuillet à tranches dorées qu’il avait dans sa poche, et l’insinua lestement sous le socle de saint Tarsicius. Il faisait ainsi, pour ce document, ce qu’il n’avait pas eu le temps de faire pour le poème d’André. Saint Tarsicius n’avait pas protégé l’ami de Lucien, mais il avait protégé Lucien et Maurice : il protégerait bien le père de Trennes. En tout cas, Georges était content d’avoir trompé le supérieur une fois de plus, de s’être vengé de celui qui était l’exécuteur de ses vengeances. Il lui en voulait de représenter des règles absurdes, un pouvoir aveugle. Étrange supérieur, dont les introductions oratoires étaient aussi enveloppées que celles du père de Trennes ! Son discours de chattemite sur les compositions, ses allusions à la piété de Georges étaient dignes des pieuses malices qu’il avait ourdies lors de l’affaire d’Alexandre. Pouvait-il se plaindre si, réclamant la vérité, il n’appelait que la contre-vérité, comme les curés de Polyeucte appelaient la contre-manifestation ?
Le père de Trennes ne s’était pas mal défendu : de toute évidence, il avait fait croire que la visite de cette nuit était une exception. André aussi avait été une exception : chacun était une exception, puisque chacun restait ce qu’il était. Et Georges également était resté envers le supérieur ce qu’il avait été avec le père de Trennes : si l’un et l’autre, selon leur mot, l’avaient élu (Que vous ai-je donc fait pour être votre élu ? leur disait-il de loin), il n’avait confirmé aucune de ces élections : ni celle du visage, ni celle de l’âme. Le choix du supérieur lui parut le moins flatteur des deux, et même l’irrita : s’était-on imaginé que lui, Georges de Sarre, fût un cafard ? Autant s’imaginer qu’il eût été le messager de la nuit dernière. Pour qui le prenait-on ?
L’étude étant déjà commencée, il coucha par écrit un résumé de son entretien, orné de quelques périodes du supérieur, et fit passer le papier à son voisin. Après la classe, les deux amis se partagèrent un goûter triomphal. Lucien avait à faire entendre, pour son compte, un récit assez curieux.
« Pendant que tu faisais au supérieur de fausses confidences, dit-il à Georges, Maurice nous racontait publiquement quoi ? son aventure avec le père de Trennes ! Quelques camarades s’étaient mis à le harceler sur sa sortie de ce matin, lui demandant s’il croyait toujours que le père fût victime d’une liaison féminine hors de l’établissement — on l’avait laissé tranquille à table, puisqu’il n’y a pas eu Deo gratias à midi. Il a résisté un peu, puis s’est décidé à avouer, et nous a fait tordre.
« Donc, il dormait à poings fermés, lorsque voilà le père de Trennes qui vient le réveiller (nous savons ça) et qui, après lui avoir parlé de la vie éternelle, l’engage à aller prendre un petit verre dans sa chambre — Maurice dit, naturellement, que c’était pour la première fois. Lorsqu’ils furent ensemble, le père commença un sermon sur saint Venant, martyrisé à quinze ans, le saint d’hier, comme tu sais — bref, une réédition de saint Pancrace, martyr à quatorze ans, de saint Nicolas de Tolentino, et des autres. Si le père était resté plus longtemps, chacun aurait eu bientôt sa petite soirée, avec petit saint de quatorze ou quinze ans.
« Cependant, ces messieurs buvaient sec et fumaient dru, quand tout à coup « toc toc » à la porte. Le père dit à Maurice :
« — Ne bougez pas, ce doit être un de vos camarades qui est malade, à moins qu’on ne m’appelle à un office. »
« Il réfléchit une seconde et ajouta :
« — Pourtant, il n’y a pas de nocturnes ces temps-ci. »
« En fait de nocturnes de Chopin, ce fut la voix du supérieur qui se fit entendre, et murmurant, s’il te plaît :
« — On m’appelle chez vous. »
« La plaisanterie était assez bonne, mais le père dut la trouver mauvaise. Il poussa Maurice sur le prie-Dieu et fit le geste de mettre son surplis, mais le supérieur s’impatientait. Le père n’eut que le temps d’ouvrir avant que l’autre enfonçât la porte. Maurice dit que c’était impayable, mais je suppose qu’il n’était pas très brave en entendant la petite conversation où il ne s’agissait que de lui — les goupillons se croisaient comme tes fleurets :
« — Que fait chez vous cet élève ?
« — Il m’a demandé de le confesser.
« — À cette heure-ci ? Mais c’est contraire au droit canon. »
« Il paraît que le père faisait sauter le droit canon. Mais il avait sans doute cette excuse d’avoir eu pitié d’un criminel qui ne pouvait dormir, troublé par sa conscience.
« Hélas ! trois fois hélas ! le supérieur, que Maurice observait du coin de l’œil, aperçoit sur la table la bouteille, les verres à moitié vides, et les cigarettes qui achevaient de se griller dans le cendrier. Il change de visage et regarde les deux compères avec l’œil de l’Aigle de Meaux prenant sur le fait le Cygne de Cambrai et Mme Guyon — scène presque mythologique. Il dit sèchement à Maurice :
« — On ne se confesse pas en pyjama. Retournez à votre lit. Je vous ferai appeler demain matin. »
« Et Maurice sortit. Le père avait l’air, non plus de Mme Guyon, mais de Mérope qui va déclamer : Barbare, il est mon fils !
« Aujourd’hui, le supérieur a essayé d’interroger notre pénitent de minuit, mais sans trop insister : il n’a consulté aucun dictionnaire, comme pour M. de Fersen. Probablement aussi que le père Lauzon était passé par là, avec le dévouement que tu lui connais à l’égard de toute la famille. Maurice, d’ailleurs, s’est retranché derrière les saintes espèces, en parlant de sa communion quotidienne, ainsi que nous avons fait à l’endroit du père de Trennes. Il dit qu’à cette réponse, le supérieur est resté un moment la tête entre les mains, se demandant où il en était. Et en effet, comment veux-tu qu’il s’y reconnaisse, le pauvre diable ? On se défend contre lui avec ses propres armes, on se déguise avec sa propre garde-robe. À ses yeux, tu étais protégé par le capuchon de saint Bernardin de Sienne, sous lequel tu venais d’être présenté à lui. Bref, en ce qui concerne Maurice, notre homme a dû conclure que la communion était une chose qui ne se discutait pas, et il l’a renvoyé, en l’invitant à communier plus que jamais, et à ne rien dire, bien entendu — la même consigne qu’à toi. Motus général pour le père de Trennes. Maurice également avait recommandé à Alexandre la discrétion du tombeau. Quoi qu’il en soit, lui aussi, comme toi, il a sauvé le père de Trennes et s’est moqué du supérieur.
« Une chose demeure obscure : par quel moyen le supérieur a été arraché de son lit. Dans ces histoires-là, il y a toujours un mystère. Nous n’avons jamais su où avait été déniché le poème d’André. Je vais finir par croire aux anges gardiens. »
Georges trouvait dans la légèreté des autres une sorte d’apaisement aux remords qui lui restaient. En même temps, il avait le cœur serré de voir changer en farce une tragédie. Jusqu’à Maurice qui en avait répudié le caractère ! Pour les maîtres, elle s’était heureusement terminée en faisant retentir, comme Polyeucte, « le nom de Dieu ».
À présent, on pouvait parler au dortoir, Lucien se pencha vers Georges :
« Je vais te dire un secret : le père de Trennes ne s’est pas converti. Il n’a pas même eu un mouvement de conversion, comme j’ai eu à dix heures trente-cinq, le soir du 6 octobre.
— Et d’où le sais-tu ?
— S’il avait renoncé à Satan, il aurait renoncé à nos pyjamas et les aurait déposés sous nos oreillers, avant de partir.
— Il n’en a peut-être pas eu le temps. Il les déposera aux pieds de l’Hermès d’Olympie.
— De plus, il n’a pas dit la vérité au supérieur.
— Oui, mais c’était à cause de Maurice et de nous tous.
— Il y en a qui regretteront les biscuits, les liqueurs.
— Je regrette plutôt de ne pas avoir davantage interrogé le bonhomme sur l’antiquité, le moyen âge et les temps modernes. Il avait une documentation intéressante. C’était quelque chose d’être réveillé au milieu de la nuit pour entendre parler incongrûment de la beauté…
— … et impurement de la pureté. »
| 1re partie | 2e partie | 3e partie |
| 4e partie | 5e partie |
Sources
- Les amitiés particulières : roman / Roger Peyrefitte. – Éd. définitive. – Paris : Librairie Générale Française, 1973 (La Flèche : impr. Brodard et Taupin). – 448 p. : couv. ill. en coul. ; 17 cm. – (Le livre de poche ; 3726). (fr)Rééditions en 1975 et 1978. – ISBN 2-253-00446-4 (broché)Texte de la troisième partie, p. 189-285.
- Les amitiés particulières : roman / Roger Peyrefitte ; avec, en frontispices, 2 lithographies originales de Valentine Hugo. – [Paris] : Jean Vigneau, 1946 (Paris : J. Dumoulin ; Desjobert, 4 décembre 1946). – 2 vol., [6]-184 p.-1 pl., [6]-184 p.-1 pl. : 2 lithographies, jaquettes ill. ; 28 × 19 cm. (fr)Tirage limité à 990 ex. numérotés sur vélin de Lana, dont 90 hors commerce.Un frontispice de Valentine Hugo, tiré du tome second.
- Les amitiés particulières : roman / Roger Peyrefitte ; lithographies de Goor. – [Paris] : Flammarion, 1953 (J. Dumoulin ; Marcel Manequin, 10 mai 1953). – 2 vol., [8]-184 p.-12 pl., [8]-184 p.-12 pl. : 24 lithographies ; 29 × 20 cm. (fr)Tirage limité à 740 ex. numérotés (10 ex. numérotés de 1 à 10 avec une suite des lithographies tirées en bleu sur vergé crème des Papeteries de Rives et une suite des gravures refusées ; 20 ex. numérotés de 11 à 30 avec une suite des lithographies tirées en bleu sur vergé crème des Papeteries de Rives ; 700 ex. numérotés de 31 à 730 ; 10 ex. numérotés de I à X).1 lithographie de Gaston Goor tirée du tome premier, 4 lithographies tirées du tome second.