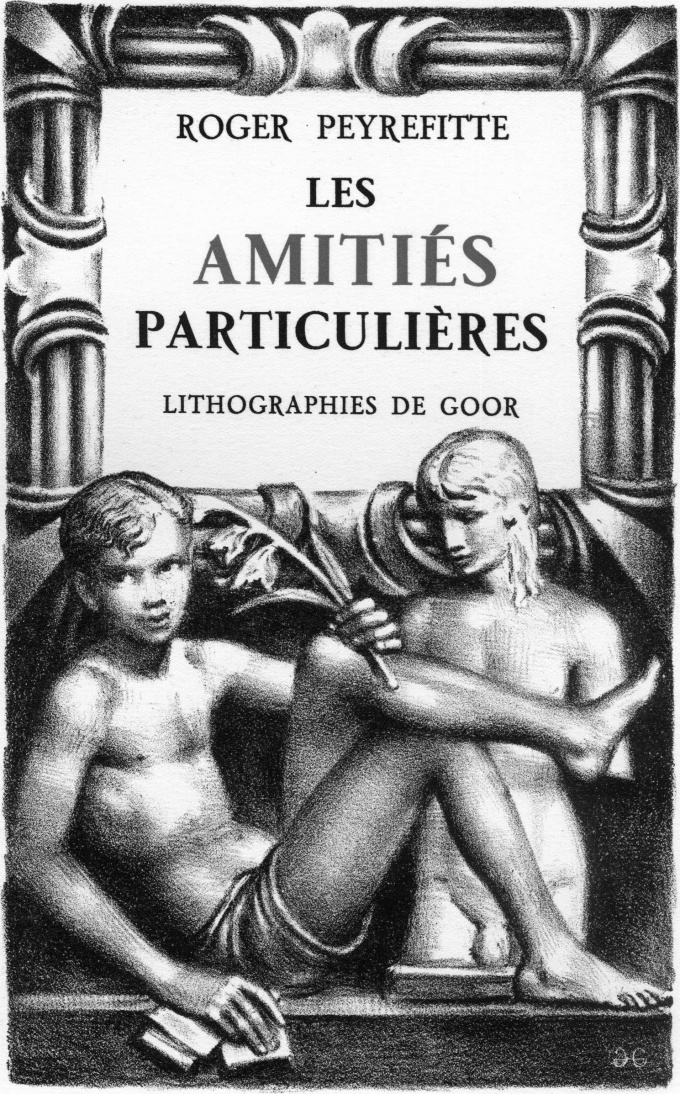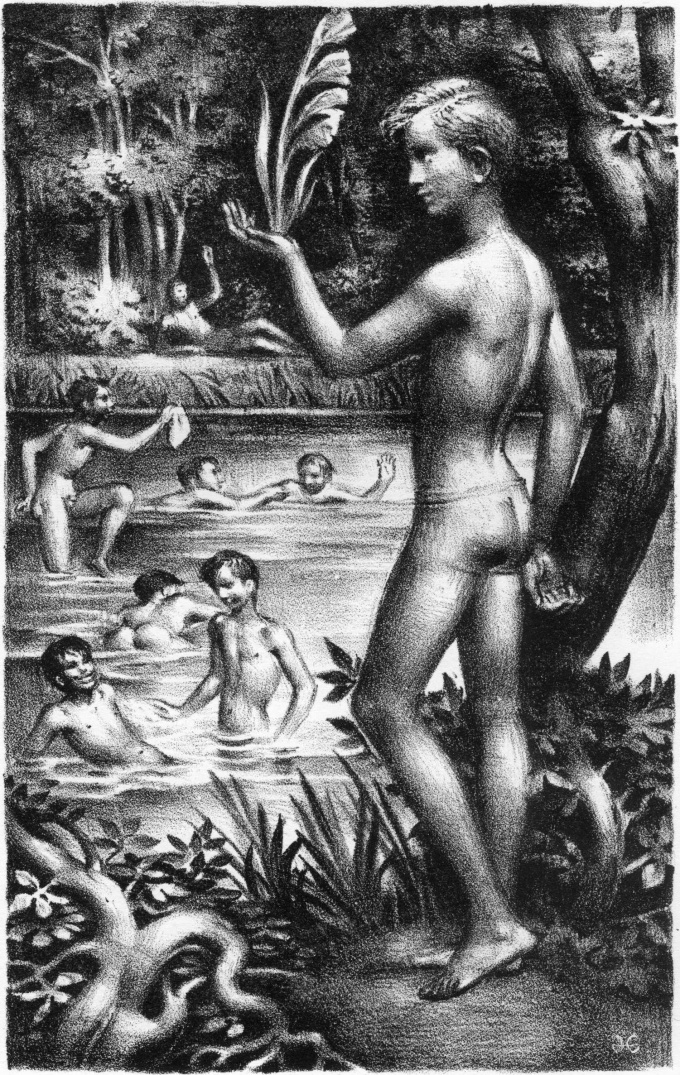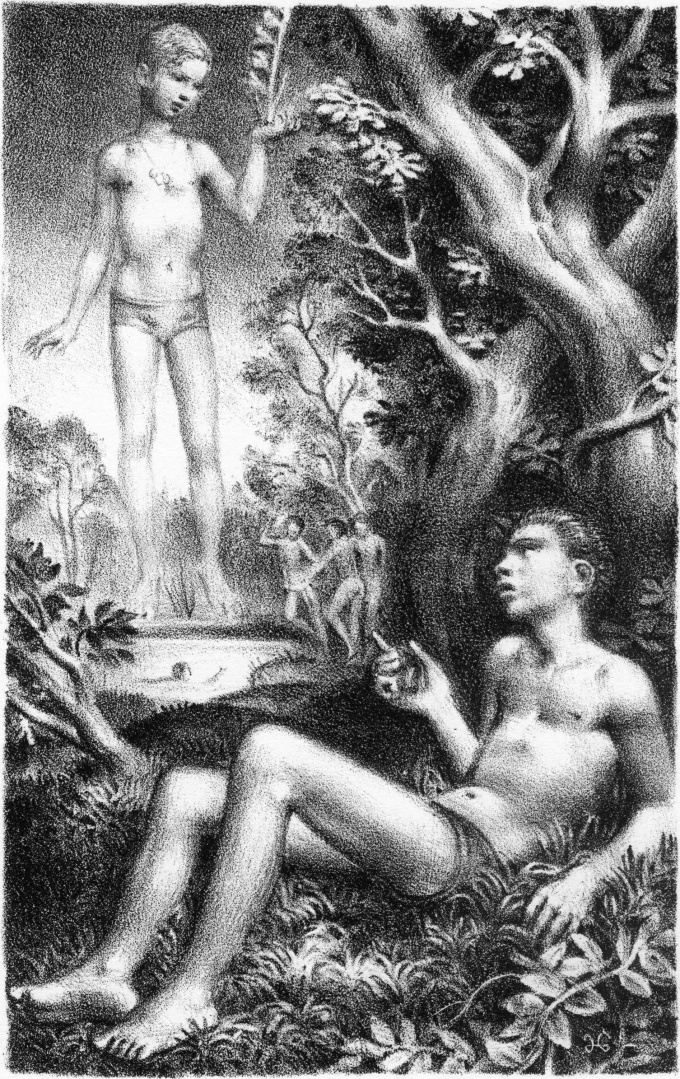Les amitiés particulières (texte intégral) – 4
La quatrième partie du roman de Roger Peyrefitte Les amitiés particulières raconte la fin du troisième trimestre de Georges de Sarre au collège Saint-Claude, du lundi 22 mai au mardi 11 juillet.
Ce lundi matin, avait lieu, avant la messe, la première procession des Rogations. Sur deux files, les petits passaient d’abord, les grands à leur suite. Alexandre et Georges s’étaient souvenus de l’occasion manquée à la procession des Rameaux, car l’un avait fait en sorte d’être dernier de sa division, et l’autre de se placer immédiatement après lui.
Depuis l’incident du mois de mars, ils n’avaient jamais été si proches dans une cérémonie religieuse. Jamais non plus ils n’avaient été réunis en plein air de si bon matin.
La campagne rayonnait au soleil. Les fleurs des fossés n’avaient pas encore perdu la rosée de la nuit. Jusqu’à présent, Georges ne connaissait les Rogations que par Le Génie du Christianisme, et c’est volontiers au génie du christianisme qu’il faisait honneur de cette procession poétique. Il ouvrit son missel afin de suivre les litanies des saints, et constata que ni saint Georges, ni saint Alexandre, ni saint Lucien ne figuraient dans la liste. Les litanies du Saint Nom de Jésus lui rappelaient au moins son projet de vacances pascales sur le Beau Nom d’Alexandre. En revanche, il apprit qu’il était en train de gagner trente ans et trente quarantaines d’indulgences.
Ensuite, il lut la notice historique relative aux Rogations : on y disait que, dans la Rome antique, il y avait, à la même époque, des processions en l’honneur des dieux champêtres. À l’instant, ces seuls mots changèrent le cours de ses idées. Il comprit pour quelle raison il était sensible au charme de cette pompe chrétienne. Son âme païenne ne devait rien à Chateaubriand. Il ferma son missel, comme il eût fermé Le Génie du Christianisme, et donna carrière à son imagination. Lui, il allait vivre la procession des Romains. Les hymnes qu’il entendait étaient ceux de la religion d’autrefois. Les saints qu’on invoquait étaient les divinités qu’il aimait. Les oiseaux qui volaient dans le ciel traçaient des augures. Les branches de chêne , qu’on avait mises aux croix des carrefours étaient de nouveau consacrées à Jupiter. Lorsque, aux stations, le prêtre, revêtu de la chape violette, aspergeait d’eau bénite les quatre points cardinaux, Georges admirait l’arvale appelant sur la future moisson les faveurs de Cérès.
Alexandre, qui marchait devant lui, ajoutait au rêve la réalité. Il portait au cou la chaînette d’or des jeunes patriciens, mais son petit costume beige remplaçait avantageusement la robe prétexte.
À la dernière bénédiction, l’endroit de la route où se trouvaient les deux amis faisait une courbe, et un mur les cachait. Ils étaient agenouillés côte à côte sur leurs livres de messe, semblant fouler un symbole. Georges laissait pendre sa main voisine de l’enfant : dans l’herbe, il avait le plaisir de lui toucher la jambe.
La seconde procession leur procura les mêmes places. On prenait une autre direction que la veille.
Georges avait décidé que, cette fois, le spectacle se déroulait aux beaux jours de la Grèce, une Grèce où il n’y avait pas le père de Trennes. Sa fantaisie lui avait déjà montré, dans des occasions précédentes, Alexandre revêtu d’un pyjama durant les vacances, Alexandre en jeune seigneur à l’Hôtel de Rambouillet, Alexandre en pape à la chapelle et, hier, en jeune Romain. Il pensait à ces fêtes de l’ancienne Athènes, auxquelles participaient des garçons pareils à ceux du collège, pareils à Alexandre, s’il en fut jamais de pareils à lui. Sur la frise du Parthénon, dont il avait vu les photographies, des éphèbes s’avançaient, la plupart voilés de la chlamyde, et quelques-uns sans chlamyde du tout. Ils se passaient aussi de chlamyde dans les gymnopédies en l’honneur d’Apollon et d’Hyacinthe. Ce n’était pas le soleil de l’Eucharistie que Georges voyait se lever sur la campagne : c’était Apollon qui venait réveiller Hyacinthe, le couvrir de ses rayons, mieux que d’une chlamyde. L’enfant jadis devenu fleur était aujourd’hui redevenu enfant, mais le parfum des fleurs l’imprégnait toujours. Il exhalait celui de la lavande, plus suave que la jacinthe au lever du soleil.
Pour cette troisième et dernière promenade dans la limpidité du matin, Georges et Alexandre étaient séparés. La surveillance avait été exacte, il n’avait pas été possible de changer l’ordre des places. Ce n’est plus à travers l’histoire, mais à travers La Belle Hélène que Georges, à présent, évoquait l’Olympe. Il avait vu jouer cette opérette dans un casino et se rappela ce refrain, aussi gai que celui de la Saint-Pancrace :
Oïa képhalé ! képhalé ! Oh ! la ! la !
Oïa képhalé ! képhalé ! Oïa !
Il chantonna ces paroles pendant un instant, mais l’accompagnement des litanies et l’allure de la procession transformaient son rythme en marche funèbre. D’ailleurs, la Belle Hélène l’intéressait aussi peu que l’eussent intéressé à cette heure les ambarvales et les gymnopédies. Rien ne lui paraissait préférable au fait d’être de son temps et de son pays. Il s’abandonnait à la caresse de l’air, aux odeurs de la terre. Il aurait voulu prendre Alexandre par la main, et courir avec lui à travers champs.
L’après-midi, le coiffeur tint séance. C’était la première fois depuis la rentrée de Pâques. Georges, qui attendait son tour, se demandait pourquoi cet homme ne disait jamais rien, et si même on ne l’avait pas choisi muet, comme jadis les barbiers des prisons. Il est vrai que celui-là n’avait rien à demander ni à répondre. L’opération ne comportait ni friction, ni lotion, ni shampooing. Il n’y avait ici que les ciseaux, le peigne et la tondeuse. Chacun se contentait, en s’asseyant, de donner une brève indication sur le genre de coupe désiré. Et, sans dire un mot, l’homme se mettait à l’ouvrage. Était-il tellement maussade parce qu’il trouvait que l’économe ne le payait pas assez, ou parce qu’il n’aimait pas plus les enfants que les curés ? Peut-être aussi se taisait-il parce qu’un curé était là en permanence. On craignait qu’il ne fît des commissions — il pourrait jeter des lettres, apporter du tabac — ou qu’il ne discourût contre « la foi et les mœurs », ce qui était défendu par le règlement. En somme, on était moins sûr du coiffeur que de la maîtresse de piano, seule à venir du dehors, comme lui, mais qui pratiquait son art sans témoins. Il est vrai qu’elle avait largement dépassé l’âge canonique et faisait partie du tiers ordre de saint François.
« Assez longs », dit Georges en prenant place : certes, il n’était pas médiocrement fier des beaux cheveux que lui avait donnés la nature et qu’il peignait avec soin chaque matin. Le grignotement de la tondeuse accompagnait le bruit des pas du surveillant et le tintement léger de ses médailles. Le chapelet du père de Trennes tintait de même à travers le dortoir. Le père ici présent possédait-il Notre-Dame-des-Ermites, qui avait fait le principal ornement du chandail de Lucien ? Il y avait des gens qui portaient des médailles quelques mois, et il y en avait d’autres qui les portaient toute leur vie. Quant au chapelet, il ne sert en Orient qu’à rafraîchir les doigts.
Les yeux de Georges se baissèrent vers le peignoir : la mèche blonde, tranchée tout entière, venait de tomber sous les ciseaux. Cela lui donna un coup au cœur. Le coiffeur de Saint-Claude avait détruit l’œuvre due au coiffeur des vacances. Pour quel motif et de quel droit avait-il sacrifié ces cheveux ? Était-ce par méchanceté ou par négligence, selon qu’il y avait vu une fraude ou un accident ? De toute manière, n’eût été la présence du surveillant, Georges aurait houspillé ce perruquier de malheur. Il avait recueilli la mèche dans le creux de sa main, comme si c’était la boucle d’Alexandre. Il pensait au père de Trennes, qu’il avait fait chasser du collège pour défendre le secret de ces cheveux blonds.
Dans la serre, l’enfant remarqua, au-dessus du front de son ami, la petite place blanche, semblable à une cicatrice, que le coiffeur avait faite. Georges avait bien songé à se décolorer un autre pinceau de cheveux, mais il avait craint que cela ne le trahît et il ne tenait pas à se rendre ridicule.
« Voici un hommage que je te devais », dit-il à Alexandre en lui tendant la mèche coupée.
L’enfant regardait ces cheveux clairs auxquels étaient mêlés des cheveux châtains, les cheveux naturels de Georges.
« C’est toi et moi », dit-il.
Il lui demanda ensuite ce qui avait provoqué le départ du père de Trennes. Cet événement avait rendu aux petits leur surveillant de naguère — même effet que chez les grands — mais Alexandre n’avait pas encore eu à s’en plaindre, ayant obtenu sans difficulté la permission de sortir. Georges raconta que, d’après ce que l’on supposait, le père de Trennes avait dû plier bagage après s’être disputé avec le supérieur.
« Je suis maintenant plus tranquille pour toi, dit Alexandre. Moi, je ne craignais rien. »
Georges se mit à rire :
« Tu devrais d’abord être plus tranquille pour ton frère : il avait à craindre pas mal de choses. »
L’enfant appuya la tête contre l’épaule de Georges qui était assis auprès de lui :
« Est-ce à mon frère que j’ai écrit : « Je pense à toi tout le temps » ?
Les éphémérides signalaient que la retraite de première communion s’ouvrait cette semaine. Elle ne regardait, évidemment, que certains élèves de la division des petits, à qui elle était prêchée par leur préfet. Mais Georges songeait à Alexandre, qui en avait les échos. L’enfant était-il attendri par le souvenir de sa première communion ? On disait, à Saint-Claude, que ce jour-là était le plus beau de la vie ; le père de Trennes prétendait, de même, que, pour Georges et pour Lucien, la communion de la Saint-Pancrace fût la plus belle de toutes.
Tandis que l’on préparait les petits à recevoir ce sacrement, on avançait, chez les grands, les répétitions des Plaideurs. Dans la querelle du xviie siècle relative au théâtre, le supérieur ne suivait pas les errements de Bossuet, puisqu’il estimait conciliables la comédie et la piété. Au fond, il admettait des contradictions plus frappantes que celle-là : la lecture publique de Tartarin de Tarascon et celle de La Vie des Saints, la mi-carême et l’oraison funèbre, le renvoi du père de Trennes et le maintien de Maurice.
À la séance académique de ce dernier dimanche de mai, il avait commémoré l’anniversaire de l’ancien élève qui avait été membre de l’Académie des Sciences, section de zoologie. Il lut, à cette occasion, la liste de ses œuvres complètes, où l’on voyait conciliées aussi les grandes choses et les petites — il y avait, à côté des travaux les plus importants : Un cas de ruse chez la taupe.
Juin commençait à merveille. Ce jeudi, premier jour du mois et premier rendez-vous du mois, Georges offrit à Alexandre une des cigarettes du père de Trennes (il dit que c’était un cadeau de Lucien). Jusqu’ici, il avait hésité à les fumer, par une sorte de pudeur. Il lui avait semblé également qu’elles risquaient de lui porter malchance. Mais, se reprochant d’être superstitieux, il s’était décidé pour aujourd’hui. Il souhaita d’associer l’enfant à cet acte : après tout, ce serait donner satisfaction au père de Trennes.
Alexandre laissa brûler l’allumette entre ses doigts, aussi longtemps qu’il put la tenir.
« Tu vois, fit-il, c’est un bon signe, lorsqu’elle flambe jusqu’au bout sans se casser. »
On eût dit qu’il avait deviné ce qu’avait pensé Georges et qu’il voulait le rassurer par un présage. Il avait été content de fumer, mais s’en dégoûta vite. Il toussota. La cigarette du père de Trennes fut jetée au pied d’un oranger. Georges se rappelait avoir senti l’odeur de ce tabac, un soir, en passant près de la porte de ce père, porte qui s’était ouverte pour le frère d’Alexandre et devait s’ouvrir ensuite pour le supérieur. Sa philosophie ne l’empêcha pas de trouver ces souvenirs désagréables. S’il n’eût craint de paraître petit garçon, il aurait imité Alexandre en jetant sa propre cigarette. Il lui fallait penser à autre chose : il retira de son portefeuille l’image de Thespies et la présenta à l’enfant, qui ne l’avait pas encore vue. Celui-ci la contempla longuement, l’appuya à sa joue, lui fit un baiser. Il la plaça ensuite contre l’oranger devant lequel se consumait sa cigarette. La fumée d’Égypte montait vers l’Amour comme un encens.
Ce dimanche était intéressant à plusieurs titres : la Pentecôte, la communion solennelle et la sortie du mois le signalaient. C’était aussi le premier dimanche où les ornements fussent rouges. De même qu’à la messe de la rentrée d’octobre, la couleur qui triomphait n’était pas celle du martyre, mais du Saint-Esprit. Georges, dès cette époque, s’était amusé à y voir un symbole différent, et, désormais, il pouvait se dire qu’il ne s’était pas trompé.
À la grand-messe, il aperçut ses parents au second banc de la nef. Il était satisfait de les voir si bien placés et de les comparer à d’autres. Il savait que ceux d’Alexandre étaient présents, mais ne les connaissait pas. Ses jours de sortie se passaient à la ville voisine, où on l’emmenait déjeuner, et il ne rentrait en voiture qu’après le départ des familles venues par le train. Cette fois, il resterait dehors moins longtemps, étant obligé d’assister aux vêpres.
Il cherchait en vain une ressemblance avec Alexandre dans les physionomies des assistants. Lequel de ces hommes avait l’aspect d’un médecin. Mais qu’importaient les pères, spirituels et temporels ! Alexandre se suffisait à lui-même. « Il était », comme le dieu en l’honneur de qui on avait gravé sur le temple de Delphes : « Il est. »
L’officiant du jour était un évêque in partibus, évêque de Pergame. Le nom de la cité des Attales et des Eumènes évoquait, jusqu’ici, dans l’esprit de Georges non un évêque, mais un impur et charmant éphèbe, héros d’une piquante histoire du Satiricon de Pétrone.
Autant le cardinal était simple et menu, autant l’évêque de Pergame était majestueux et gras. Il avait fait ses études à Saint-Claude, puis il y avait été professeur. Il était heureux sans doute de trôner dans cette maison. Avec quel orgueil il portait la mitre ! il ne la portait pas à la gloire de Dieu, il l’offrait à l’admiration de ses confrères et des élèves. Néanmoins, quand il restait un moment la tête découverte, c’est d’un air plein de bonhomie qu’il caressait son crâne chauve, peut-être afin d’attendrir ses anciens confrères et les élèves.
La messe terminée, Georges alla au parloir, où ses parents devisaient avec ceux de Lucien. Il regarda, dans la vaste salle pleine de monde, si Alexandre n’y était pas. Il l’aperçut en compagnie de son frère, près d’un monsieur et d’une dame qui lui parurent fort bien. Il fut troublé de voir ces gens à qui il avait enlevé leur enfant. La mère avait posé une main sur le cou d’Alexandre, épanoui dans l’échancrure de la chemise, et elle jouait avec la chaînette que Georges avait baisée à leur premier rendez-vous.
Fiasco lamentable aux vêpres. Le prédicateur, venu de M…, où Georges l’avait vu, mais jamais entendu, à la cathédrale, n’avait pas fait sa rhétorique à Pergame. Pauvre chanoine-doyen, qui agitait, dans ses pieux élans, son beau rochet de dentelles, sa croix pectorale, son ruban jaune et blanc et son camail bordé d’hermine ! Il fit sauter son lorgnon, mais le rattrapa au vol. Dans une apostrophe, il s’écria si fort : « Ô Marie ! » que les communiants eux-mêmes perdirent leur sérieux. À propos du Saint-Esprit, il cita saint Bernard qui a dit : « Le Saint-Esprit est le baiser de Dieu. » Ce baiser était à ajouter aux saints baisers du père Lauzon.
Enfin, par contraste avec les célestes douceurs de ce jour, le chanoine-doyen amena une description effrayante du péché et de l’enfer. Cela rappelait la conférence de la retraite, inspirée par les malheurs d’André et illustrée par ceux de l’homme des Balmes. « Feu devant, feu derrière, feu dessus, feu dessous, feu à droite, feu à gauche, feu partout, voilà l’enfer ! s’écria l’orateur. Et de ce brasier terrible, celui qui est mort dans le péché ne sortira jamais, jamais, jamais ! »
« Attention aux sarments de ton blason, dit Lucien à Georges, qui riait sous cape : que le feu ne s’y mette ! »
Le supérieur semblait consterné : on était loin de Bossuet, on était dans des recettes de soufflé, avec tant de feu. Il devait avoir honte, à cause des étrangers. Qui sait s’il ne regrettait pas, au risque de quelques soirées de plus, que le père de Trennes ne fût pas resté pour prêcher en ce moment ? Avait-il oublié que le choix d’un bon prédicateur est aussi difficile que le choix d’un ami ?
Le lendemain, lundi de Pentecôte, il y avait promenade. Cette promenade-là était pleine d’attrait : on allait se baigner à la rivière.
Trois élèves de première, les meilleurs de la classe, se trouvaient derrière Georges et Lucien qui avaient en tiers Maurice — en promenade, on marchait par trois. Les rhétoriciens parlaient de flirt et de surprises-parties. L’un d’eux, qui venait de dire : « Je ne vis que pour la danse », apprenait à un autre l’art de danser dans un salon.
« Tu as eu tort, à Pâques, disait-il, de garder la même danseuse toute la soirée. Je ne m’étonne pas que vous vous soyez fait attraper par vos parents. Il faut danser tour à tour avec plusieurs filles, et, de temps en temps, avec les mères. »
Cela fit rire Georges et Lucien.
« Ici, dit Maurice, c’est plutôt les pères que l’on fait valser. »
Et il fit tourner, au bout de son bras, la ceinture à laquelle il avait attaché, comme une réduction du père de Trennes, son maillot et sa serviette.
À cet endroit de l’étroite vallée, la rivière, jusque-là presque torrentueuse, s’élargissait au milieu des prairies et formait une sorte de lac bordé de saules et de noisetiers. On se récria sur les glaïeuls qui, des deux côtés de l’eau, dressaient leurs hautes fleurs, rouges ou blanches.
« Il faudra, dit le surveillant, rapporter des bouquets pour l’autel de la sainte Vierge. Composez-les de glaïeuls blancs. Le mois de Marie est fini, mais les fleurs de toute l’année sont dues en hommage à celle qui est non seulement la reine du ciel, mais la reine des fleurs : la « Rose mystique ».
Ces dernières métaphores unissaient, sur les lèvres du surveillant, le langage du père Lauzon et celui du père de Trennes.
Les élèves se dispersèrent derrière les arbres, afin de se déshabiller. Bientôt, ils apparurent, l’un après l’autre, en caleçon de bains. Georges les regardait avec surprise. Il les reconnaissait à peine, ne les ayant jamais vus ainsi, puisque les douches se prenaient dans des cabines individuelles et que la tenue générale était fort modeste au dortoir. Ici, les malingres même n’étaient pas dépourvus de grâce : ils semblaient vouloir se donner une prestance, pour honorer le soleil et leurs beaux compagnons. Celui-ci, qui avait l’air si effroyablement bête, était transfiguré. Celui-là, d’ordinaire si gauche dans ses habits, foulait l’herbe rêche avec élégance. Et tous accouraient, heureux d’avoir quitté leurs défroques, libres, fiers, insolents. Ils semblaient retarder à plaisir le moment où le bain allait les cacher. Ils sautaient, trépignaient, faisaient des pirouettes, des cabrioles, se culbutaient, se roulaient sur cette palestre improvisée. Enfin, d’un bond, ils s’étaient jetés à l’eau en même temps : ce fut une gerbe d’écume. Lucien les avait rejoints, mais Georges s’était assis près de la rive, les jambes croisées : il était le scribe qui allait prendre note de leurs jeux. Les voilà, les gymnopédies.
Le surveillant, lui aussi sans doute, ne reconnaissait plus ses élèves : il se jugeait privé d’autorité sur ces êtres débridés et nus. Il cueillait des fleurs et affectait de ne rien voir. Puis il s’installa au pied d’un arbre, s’en remettant au Bon Dieu. Après s’être signé, il lut ses prières, tel un saint transporté par les démons au milieu d’une bacchanale.
Ce qui s’accomplissait était pourtant un rite éternel, comme les processions de l’autre semaine : le rite de la baignade. Ce n’était plus en vue de demander les fruits de la terre, mais d’exposer les fruits des corps. Ces garçons étaient rentrés dans la nature, leur élément.
Les plongeurs, rassemblés sur un rocher, levaient le bras pour une invocation et tombaient religieusement à tour de rôle. Ceux-ci nageaient à contre-sens, ceux-là faisaient la course. Quelques-uns glissaient entre deux eaux — parfois surgissaient leurs derrière luisants. Certains se laissaient couler, et brusquement ressortaient, jeunes tritons, lançant de l’eau par la bouche. D’autres, pour narguer l’abbé qui n’avait pas plus, d’yeux que d’oreilles, retiraient un instant leurs caleçons et criaient qu’ils les avaient perdus. Lucien, saisi de la folie collective, gambadait dans la rivière, la frappait de ses mains, se renversait, batifolait, ivre d’exister. Aujourd’hui également, Georges aimait le collège, qui avait de telles heures.
Il ne savait pas très bien nager et ne voulait pas être moqué, même s’il eût fait admirer son caleçon marron, orné de belles initiales. Il se rappelait le proverbe latin, que le comble de l’ignorance est de ne savoir « ni lire ni nager ». Il se sentait un illettré ; à présent, il était le dernier de sa classe. Il s’écarta, pour se baigner plus discrètement. Lorsqu’il eut assez répété les leçons prises à la piscine pendant les vacances, il resta allongé dans l’eau, la tête contre le rivage, sous un noisetier chargé de chatons. On ne pouvait l’apercevoir ni de loin ni d’en face. Quelle agréable cachette ! C’était dommage d’y être seul.
À gauche, sur l’autre bord, un bruit tumultueux se rapprochait : c’était la division des petits qui arrivait. Le surveillant des grands s’arracha à sa lecture et rassembla ses troupes vers la partie supérieure du miroir d’eau. Le bréviaire dans une main, le bouquet de la Sainte Vierge dans l’autre, le chapeau en bataille, il faisait de grands gestes, heureux probablement d’avoir un prétexte pour reprendre un peu d’autorité.
Georges n’avait pas à bouger. Il affina vainement son regard, cherchant à distinguer Alexandre. Il n’avait qu’à attendre : l’enfant viendrait nécessairement à lui, comme au génie de la rivière.
Avec quelle fébrilité, hâtée par la vue des grands, se déshabillaient les nouveaux baigneurs ! Déjà, les premiers prêts accouraient, mais leur ardeur hésita : ils frissonnaient sous la brise, tâtaient l’eau du bout du pied, se baissaient pour se mouiller les mains, puis les bras et le buste. D’autres vinrent, plus hardis, et plongèrent sans hésiter, éclaboussant les timides. Comme leurs aînés, une sorte de délire les saisit tous bientôt. Leurs ébats les éloignèrent.
Georges n’avait pas été moins surpris par ce spectacle que par le précédent. Aurait-il jamais cru que, de chacun de ces chétifs écoliers, la vie émanait avec tant de douceur et de force ? Mais il sentait aussi ce que ces nudités avaient de trompeur. Ces garçons, petits ou grands, n’avaient pas rejeté tous leurs voiles. Ces corps, qu’ils étalaient impudemment, demeuraient leur mystère. Dans ce collège, où des prêtres leur parlaient sans cesse de Dieu, chacun était son propre prêtre, sinon son propre dieu, pour sa religion à lui, digne continuateur de ces sacerdoces que les Grecs confiaient à des enfants.
Soudain, il n’y eut plus de spectacles, plus de pensées : il n’y eut qu’un personnage. Sur la prairie, entre les saules, Alexandre avançait, vêtu d’un petit caleçon bleu. Il avait cueilli un glaïeul écarlate, et s’amusait, en marchant, à le faire tenir droit sur la paume d’une main. Sa fine chaîne d’or dansait autour de son cou. Les rayons du soleil le portaient, l’herbe pliait à peine sous ses pas. Georges n’avait jamais rêvé de plus délicieuse vision. « Je me rappellerai toute ma vie, murmura-t-il, que j’ai vu cela, que cela fut. »
Alexandre, qui était seul, s’était approché des arbres, en face de ceux qui abritaient Georges. C’était comme pour se retrouver qu’ils avaient choisi cet endroit. Leurs chemins ne pouvaient plus que les conduire l’un vers l’autre. L’enfant fixait ses regards sur la division des grands, dans l’espoir sans doute de découvrir son ami. Mais Georges préféra ne pas se montrer encore, afin de mieux se rassasier la vue. L’idée l’enivrait qu’à cet instant même, son image fût présente dans cette tête blonde et qu’un tel garçon souhaitât l’apercevoir et être aperçu de lui. La fête d’aujourd’hui était véritable. Elle effaçait la fête imaginaire placée, le second jour des Rogations, sous le ciel d’Hyacinthe.
Maintenant, Alexandre avait tourné les yeux du côté de ses camarades. Son bras droit était levé le long d’un arbre, la main étendue à plat fermant la bouche à l’hamadryade, l’autre laissant pendre le glaïeul jusqu’à ses pieds. « Dans ta splendeur et ta beauté, viens, triomphe et règne » : le texte liturgique avait prévu cette minute de gloire. Mais ce que Georges admirait ici, ce n’était pas seulement, comme chez les autres — mille fois plus que chez les autres — de séduisantes apparences ; ce n’était plus l’Amour de Thespies : c’était la divine incarnation d’une âme divine, un esprit au-dessus de son âge, un cœur plein de force et de droiture, plein d’amitié.
Le sifflet du surveillant annonçait à la première division la fin de la baignade. L’enfant, dont l’attention fut attirée par ce signal, regarda de nouveau vers les grands. Il fit quelques pas dans la rivière, une main au-dessus des yeux, les abritant du soleil. Alors Georges lui cria : « Ohé ! ohé ! » Alexandre tourna la tête et rougit vivement. D’un trait, il plongea, semblant punir ainsi l’admiration indiscrète dont il avait été l’objet. À sa place, surnageait le glaïeul, qu’on eût pris pour sa métamorphose au temps des fables. Il ressortit tout ruisselant, tout riant, et rejeta ses cheveux en arrière. Deux gouttes d’eau perlaient au bas de ses oreilles. Il lança le glaïeul à son ami. Le plus beau des rendez-vous était déjà terminé.
Georges partit, la longue tige de la fleur reposant sur son épaule comme une gerbe. C’est Alexandre maintenant qu’il devait regarder. Le caleçon marron lui plaisait-il ? Ah ! le surveillant venait justement à la traverse, occupé à compléter son bouquet de jeune fille ; il allait faire une semonce qu’on se fût éloigné et mis en retard. Une gentillesse l’amadouerait : Georges lui donna pour la sainte Vierge le glaïeul d’Alexandre — un peu de rouge ferait mieux ressortir la blancheur du reste.
Le mois de juin était un mois de liesse. Les éphémérides marquaient en grosses lettres : « 6, mardi : solennité de saint Claude. » L’évêque était resté, depuis dimanche, en vue de présider la cérémonie.
Gorges s’était senti flatté, lorsque, au retour de la baignade, le préfet l’avait nommé parmi les enfants de chœur qui serviraient à la grand-messe. Et le lendemain matin, en allant à la chapelle, il regrettait que ses parents ne fussent pas là de nouveau. Il regrettait davantage qu’Alexandre se trouvât au dernier banc. Il aurait paradé devant lui, en robe et camail de pourpre, comme hier en caleçon de bain.
Il fut frappé par le parfum des fleurs dont on venait, à profusion, d’orner les autels. Il croyait pénétrer dans une serre, plus odorante encore que celle de là-haut. Et celle-là même, il la voyait représentée par les plantes vertes disposées autour du chœur. Ces plantes avaient figuré maintes fois dans cette enceinte, mais aujourd’hui elles lui faisaient une autre impression : il s’imaginait arriver à un autre rendez-vous. Il ouvrit la porte de la sacristie et aperçut Alexandre parmi les acolytes occupés à s’habiller.
André et Lucien avaient été réunis devant l’autel par le prédicateur de la rentrée ; Georges et Alexandre le seraient par l’évêque de Pergame. Ni l’un ni l’autre ne portaient l’encensoir, mais il semblait à Georges que tous les honneurs de la cérémonie leur fussent adressés : à Alexandre mieux que le jour de l’agneau, à lui-même mieux que le dimanche de l’encensement. C’était pour signaler leur victoire que le fastueux monseigneur revêtait la tunique, la dalmatique et la chasuble dorées. Ils n’étaient plus les triomphateurs secrets, ils triomphaient publiquement. La messe du père de Trennes n’était rien auprès de celle-ci. Avant de sortir, Georges eut la hardiesse d’arranger rapidement le petit capuchon d’Alexandre. Dans la sacristie, il n’y avait personne à craindre.
Pourtant, il y avait quelqu’un à ménager, au moins dans la chapelle ; le père Lauzon était toujours à Saint-Claude, professeur de mathématiques, directeur de la congrégation, confesseur de Georges, d’Alexandre, de Lucien e tutti quanti. Présentement, que devait-il penser des deux premiers ? Déplorait-il leur rapprochement ou était-il édifié par leur tenue ? Se disait-il, comme le père de Trennes, que l’on était parfois bien naïf ici, et qu’on aurait dû le consulter ? Ou plutôt ne se disait-il pas que l’on avait bien fait de choisir, pour la plus grande solennité du collège, deux garçons de si bonne mine ? Peut-être leur confirmerait-il sa promesse de refaire leur amitié. Le soleil, en traversant le vitrail, les couronnait de pierres précieuses : une fois de plus, les paroles liturgiques n’avaient pas menti. Aux pieds de la Sainte Vierge, se dressaient les glaïeuls rapportés de la promenade. Il n’y avait qu’une fleur rouge.
Aux vêpres, le panégyrique de saint Claude fut suivi d’une procession jusqu’à la grotte où s’élevait sa statue. On faisait retentir le cantique de la journée :
Salut à toi, digne et vénéré père !
Sur tes enfants, Claude, jette les yeux !…
Le cortège s’arrêta devant l’esplanade de la serre, au-dessous de laquelle cette grotte était creusée. Alexandre, d’un coup d’œil, avait montré à Georges les orangers qui ornaient la terrasse — on avait profité de la circonstance pour les mettre à l’air. L’évêque de Pergame s’avança avec les diacres, puis, levant la tête comme s’il regardait la terrasse, il bénit ces lieux révérés. Probablement que, l’année dernière, André et Lucien avaient eu le même spectacle.
Le surlendemain, Georges et Alexandre étaient dans la serre. Ils évoquèrent leurs deux dernières rencontres fortuites. L’enfant semblait un peu songeur. Il ouvrit la paume de sa main gauche, et la considéra avec attention.
« Tu crois aux lignes de la main ? demanda-t-il à Georges.
— Oui, si elles annoncent de bonnes choses.
— Cet après-midi, pendant la promenade, un camarade qui s’y connaît a lu les miennes et m’a prédit que je mourrais jeune.
— L’imbécile ! Sans doute est-il jaloux de toi et il aura voulu t’inquiéter. Ne pense plus à ces sottises. On avait prophétisé à Voltaire qu’il mourrait jeune et il est mort octogénaire. »
Il prit les petites mains, et, se penchant comme s’il allait les examiner, il les baisa.
« Voilà, dit-il : j’ai conjuré le destin. »
C’est presque ainsi qu’Alexandre avait parlé, l’autre jour, à propos de l’allumette. Sa gaieté lui revint et il apprit à Georges qu’il jouerait un rôle de page dans Richard Cœur de Lion : c’était la courte pièce, mêlée de chants, par laquelle sa division contribuait aux réjouissances de la distribution des prix. Ils se félicitèrent de cette nouvelle faveur de la destinée. Cela leur procurerait des occasions de se revoir par-ci par-là, au cours de répétitions simultanées ou dans les coulisses. Ils se sentaient protégés par leurs propres personnes. Ils étaient indispensables au décorum de la maison. Il n’y avait plus de fête sans eux. Si le père Lauzon n’était pas encore gagné à leur cause, il s’estimerait dépassé par les événements. Il conclurait d’ailleurs que, les vacances étant proches, on pouvait leur laisser renouer quelques liens, puisque, à la rentrée, ils se retrouveraient d’une façon définitive.
Alexandre avait déjà vu son costume : pourpoint rouge, culotte blanche, toque emplumée. Il était content du pourpoint rouge. Il l’aimait mieux que la robe d’acolyte.
« Je porterai notre couleur, dit-il, ou plutôt ta couleur. Je suis ton page, du moment que tu es noble ! Tiens ! Je n’avais jamais pensé à ta noblesse depuis que je te connais — depuis que tu n’es plus pour moi « de Sarre », mais « Georges ». Il est beau d’être noble.
— Moins que d’être beau, mon beau page.
— Tu dois avoir des armoiries, comme Richard Cœur de Lion.
— Oh ! les miennes sont certainement moins intimidantes : un pauvre petit feu de bois sec. »
Il ne voulait pas dire « sarment », de crainte que, dans l’esprit de l’enfant, son nom ne fût allié à l’idée de « mensonge », même si cette plaisanterie n’était qu’héraldique.
« Du bois sec ! s’écria Alexandre. Eh bien, c’est moi qui nourrirai ton feu : « il n’est feu que de bois vert. »
— Tu parles du feu comme une salamandre. Tu vis dans le feu à ton insu, mais cela est une autre histoire.
— Il y a aussi une autre histoire de feu. On nous l’a apprise, l’autre jour, en classe de grec : celle d’un enfant d’Éleusis, qu’une déesse plongeait dans le feu pour le rendre immortel. »
L’après-midi de ce dimanche, 11 juin — exactement à un mois des vacances — eut lieu la première répétition des Plaideurs. Rhétoriciens et philosophes étaient absorbés par la préparation de leurs examens, et c’est principalement chez les élèves de seconde et de troisième que s’étaient recrutés les acteurs. Georges incarnait Léandre, et Lucien Isabelle. L’attribution de ce dernier rôle avait été une victoire de Georges. Pour lui, il avait acquiescé dès qu’on l’avait pressenti, mais ensuite avait été inquiet : on ne savait encore qui ferait Isabelle. Il y avait, en quatrième, d’assez jolies frimousses entre lesquelles hésitait le préfet, organisateur de la représentation. Georges avait demandé à Lucien de se proposer lui-même, et Lucien avait été agréé. Léandre n’aurait pas voulu débiter des gentillesses, même au nom de Racine, à un travesti dont Alexandre aurait pu être tant soit peu jaloux. Avec Lucien, la chose ne tirait pas à conséquence. Ce ne serait qu’une farce de plus. Le préfet pouvait bénir ce couple de théâtre, si l’évêque avait béni celui de la serre.
Les religieuses étaient venues se rendre compte des retouches à faire aux costumes et aux divers atours qu’on essayait. Georges était aussi content de son habit blanc et or qu’Alexandre l’avait été du pourpoint rouge. Il choisit la perruque la plus blonde possible, et, contre toutes les traditions, fit prendre à Isabelle une perruque châtain. Il songeait à l’enfant qui, pendant ce temps-là, se baignait dans la rivière, mais il ne regrettait pas d’avoir été retenu ici. Maintenant que les douches étaient supprimées, on avait édicté, en effet, après la confusion du lundi de Pentecôte, que les grands iraient se baigner le jeudi et les petits le dimanche. Georges et Alexandre s’étaient promis de prendre toujours leur bain à l’endroit où ils s’étaient vus.
Au rendez-vous de jeudi, ils parlèrent des vacances. Ils entendaient ne pas laisser passer ces trois mois sans se rencontrer. Ils avaient appris que leurs familles respectives se proposaient de se rendre au bord de la mer, à partir de fin juillet, mais ils ignoraient encore quels lieux de séjour avaient été choisis. Il leur faudrait s’en enquérir au plus tôt. Georges répondait d’avance de faire aller ses parents où il voudrait. Si, l’été dernier, Lucien et André avaient mené à bien un projet semblable, il en ferait tout autant. Pourrait-on lui refuser quelque chose, attendu tous les prix qu’il aurait ? Il s’imaginait déjà au milieu des vagues près d’Alexandre.
« Alors, dit-il, je saurai nager — toi, tu sais — et nous irons loin dans la mer. Puis, nous resterons longtemps allongés sur le sable, au soleil.
— Oui, dit Alexandre d’une voix étrange. Et nous échangerons nos maillots. »
Cette phrase, par laquelle s’était terminé leur entretien, avait frappé Georges. Il ne l’avait pas relevée, mais il y pensa encore le soir dans son lit. Il y avait là un point de départ, non pas vers la mer amicale, mais vers la « mer dangereuse » de la carte du Tendre. Il se rappelait le père de Trennes lui suggérant un échange de pyjamas avec Lucien. Et cet enfant qui n’avait pas treize ans concevait une idée du même ordre ! Étaient-ce les souvenirs de la baignade qui avaient agi sur son imagination et provoqué ce petit accès de fièvre ? Ou bien cela tenait-il à l’atmosphère, véritablement de serre chaude, dans laquelle se développait cette intrigue ? Le père Lauzon ne se trompait pas : ce qui est clandestin risque de devenir fâcheux.
Pour la procession de la Fête-Dieu, les deux amis n’étaient plus enfants de chœur ni même voisins. Que de processions ! Du moins celle-ci était-elle enrichie d’indulgences, comme celle des Rogations — celle de la Saint-Claude n’avait eu que ses propres mérites.
On traversa le village. La route était jonchée de fleurs de genêt, et Georges avait plaisir à se dire qu’Alexandre marchait sur ce tapis odorant. Plusieurs reposoirs avaient été préparés devant des maisons. Des portes étaient masquées par des branches de cerisier ou des fougères, au travers desquelles on voyait clouées des peaux de lapins. À l’aspersion, des paysans s’avancèrent, afin de recevoir sur les mains une goutte d’eau bénite, et la baisèrent pieusement. De vieilles femmes étaient agenouillées sur leurs fichus. Un gros homme, debout, les mains derrière le dos, regardait tout ça d’un air hébété.
Au retour, éclata le plus beau charivari que Georges eût encore entendu : le surveillant des petits leur avait fait entonner le Sacris solemniis, et, au même moment, celui des grands donnait le signal du Lauda Sion, tandis que la maîtrise commençait le Pange lingua. Après un moment de cacophonie, les petits se rallièrent et reprirent le Lauda Sion, juste alors que les grands venaient de changer de prose, les choristes continuant la leur. Naturellement, ils firent tous durer l’équivoque le plus possible : tandis que le maître de chapelle courait des petits aux grands pour faire l’unanimité sur son hymne, la maîtrise s’était partagée en faveur des deux autres.
Le jeudi, comme l’avant-dernière fois, l’enfant était rêveur. Georges lui demanda s’il pensait encore aux lignes de sa main.
« J’ai honte de ce que je t’ai dit avant que nous nous séparions, fit Alexandre. En vacances, nous n’échangerons pas nos maillots. »
Georges sourit. Il était charmé que l’enfant eût su se reprendre.
« Comme je t’aime ! dit-il. Je t’avoue que j’avais été assez choqué par ta proposition, mais je me doutais que tu n’en avais pas compris le sens. »
Alexandre aussi semblait tout heureux. Naguère, la conversation sur les choses qu’il ne faut pas savoir, ou du moins qu’il ne faut pas faire, l’avait rassuré à l’égard de Georges, et maintenant il s’était rassuré sur lui-même. Rien ne pouvait ternir leur amitié.
« J’ai songé à une compensation, reprit l’enfant : c’est que nous achetions des maillots rouges. Nous distinguerions chacun le nôtre par un signe — une fleur brodée, par exemple — ou par des initiales, comme au tien.
— Bravo pour le maillot rouge ! C’est l’uniforme des lutteurs. Mais j’admire que tu aies remarqué les initiales dont tu parles et qui sont ton sur ton.
— Chez toi, je remarque tout. Avant chaque rendez-vous, je m’amuse à parier si tu porteras, avec ta cravate rouge, une chemise bleue, ou une blanche, ou une beige, ou une rose, ou une grise — je les connais par cœur. Je préfère tes chemises bleues : ce sont celles qui te vont le mieux.
— Et à toi également, dit Georges, rien ne te va si bien que ton petit caleçon bleu. »
Alexandre mit un doigt sur ses lèvres pour faire le geste du silence :
« Chut ! » dit-il.
Ce dimanche, il y avait nouveau cumul : on célébrait à la fois la fête du supérieur et celle du Sacré-Cœur. Cette occurrence était le résultat d’un carambolage : le supérieur s’appelait Jean, sa fête était donc le 24, qui tombait le samedi, mais on l’avait reportée au lendemain, avec la solennité du Sacré-Cœur, qui tombait le vendredi ; d’autre part, on avait remis à jeudi prochain la grande promenade, qui était la consécration traditionnelle de la fête du supérieur. Avec le supérieur, un peu de complication s’imposait.
Dans l’étude des grands, un philosophe lui présenta les vœux prévus par le règlement, comme ceux de la nouvelle année. Il y répondit en souhaitant aux élèves la flamme et la lumière intérieures, dont la nativité du Précurseur est le symbole. Puis il alla chez les petits écouter et dire probablement les mêmes choses.
Georges pensait au cours d’astronomie religieuse que le supérieur avait fait hier matin, pour la Saint-Jean proprement dite : cette fête marque le point culminant de la course annuelle du soleil qui, à partir de cette date, se remet à descendre ; de même, saint Jean avait dit, en parlant du Sauveur : « Il faut qu’il croisse et que je diminue. » En effet, la nativité de Jésus, dont celle de ce saint est le prélude, ouvre l’époque où le soleil recommence à monter.
« Mon soleil, mon sauveur à moi, se disait Georges, a paru aussi sur mon horizon au temps de Noël, mais il ne déclinera jamais. »
Pendant la procession du Sacré-Cœur, il lut dans son livre, parmi les versets de l’antienne, ces mots qui appartenaient à son histoire : « Place-moi tel un cachet sur ton cœur, tel un cachet sur ton bras. »
L’enfant et lui avaient scellé un cachet infrangible. Ce n’était pas celui du poème du Bien-Aimé : c’était la petite blessure qu’ils s’étaient faite au bras, afin d’échanger leurs âmes avec quelques gouttes de sang.
Tout paraissait facile à Georges. Il ne croyait plus à aucun danger. La perspective des vacances et la plénitude de son cœur lui rendaient les obstacles méprisables. En allant à l’académie, il longea l’étude des petits et fit exprès de s’arrêter devant certaine fenêtre ouverte. Il regardait Alexandre, que la présence du surveillant empêchait de sourire, comme Georges en avait été empêché, du haut de la chaire, à cause du père Lauzon et surtout du père de Trennes. Un rayon traversait l’étude et posait sa caresse sur ces cheveux blonds. Ce n’était plus le temps où Georges contemplait l’enfant à la dérobée, derrière les vitres embuées des soirées d’hiver, ni celui où, venant de recevoir son premier billet, il décrivait avec lyrisme, dans sa lettre hebdomadaire, le rayon qui traversait sa propre étude. Maintenant, au collège même, il se jugeait aussi libre qu’il l’était chez lui, où il lisait sans se cacher les billets d’Alexandre. C’est le pâle soleil de février qui avait éclairé leur amitié à ses débuts, mais elle était dorée comme un fruit mûr par le premier dimanche de l’été.
À la congrégation, Georges ne se départit pas de son audace. Il se sentait encore plus ardent qu’après les cinq actes de Polyeucte, et sa victoire sur le père de Trennes lui faisait juger de haut le père Lauzon. Au lieu de rester à sa place habituelle, il se mit avec les congréganistes de quatrième, immédiatement derrière Alexandre. En ouvrant son livre pendant qu’on était agenouillé, il fit tomber une image sur les jambes de l’enfant. Celui-ci se retourna, mais, ayant vu Georges, n’osa la ramasser. Le courage changeait de camp. Georges, en se baissant, pinça le mollet qu’il avait caressé aux Rogations.
La grande promenade était digne de ce nom. Elle durait une journée entière, pendant laquelle les deux divisions se réunissaient. On quittait le collège de bon matin, en emportant le repas de midi et le goûter, et l’on ne rentrait qu’à la nuit tombante. De même que l’an dernier, on devait aller à quelques kilomètres de Saint-Claude, dans la propriété que possédait la famille d’un élève de seconde, le Dandin des Plaideurs. Lucien disait avoir extrêmement apprécié l’hospitalité qu’il y avait reçue, mais ce n’était ni pour le parc ni pour le château, c’était pour la cabane du jardinier, où il était resté avec André une heure entière. D’ailleurs, il avait été malade, parce qu’il avait fumé un peu trop.
« Là-bas, dit-il à Georges, la surveillance n’est pas facile. À ton tour d’en profiter. Tu renoueras la tradition dans la cabane, après l’avoir renouée dans la serre. »
Les grands et les petits se croisèrent à la sortie, prenant des routes différentes. Georges et Alexandre se firent un signe joyeux, qui était l’annonce de leur rendez-vous. Quelle radieuse journée ! Elle serait complète. Georges marchait avec allégresse. Il lui semblait que personne n’avait aussi heureusement que lui posé le pied sur la terre.
Puis les élèves se mirent à la file, dans un étroit sentier qui escaladait la montagne. Au sommet, d’où jaillissaient les tourbillons d’une cascade, la poussière d’eau les rafraîchit. Jamais encore Georges n’était venu dans ces parages. Tout l’enchantait. Plus loin, de vastes dalles, vestiges d’une voie romaine, menaient à la grand-route par où les petits devaient arriver plus uniment. Georges pensait à ceux qui, dans les siècles antiques, avaient parcouru ce chemin, à tel d’entre eux qui lui avait peut-être ressemblé, ami rejoignant son ami qui l’attendait, comme celui dont Pompéi a conservé l’inscription impatiente. Cette voie lui paraissait destinée depuis l’antiquité à le porter vers Alexandre. Des champs de coton la bordaient, culture singulière pour le pays, et qui était innovée par les châtelains chez qui l’on se rendait. On marchait sur des coques floconneuses poussées par le vent.
« Après Rome, voici l’Égypte, dit Georges à Lucien. Nous voyageons beaucoup.
— N’as-tu pas oublié tes égyptiennes ?
— Non. Je fumerai dans la cabane, mais sans être malade, j’espère. »
Ils arrivèrent enfin à une allée de chênes, au bout de laquelle se dressait le château qui était le terme de la promenade. Cette vaste construction, que Georges estima banale, ne lui rappelait guère celle où il allait passer une partie de ses vacances. « Il y a châteaux et châteaux, se disait-il, comme il y a baisers et baisers, etc. » Beaucoup de fenêtres étaient murées ; c’était, disait-on, en vue de diminuer les impôts. La division, rassemblée devant le perron, assista aux congratulations du supérieur et de ses hôtes. Auprès d’eux, le fils de la maison se rengorgeait.
Lucien emmena Georges, afin de lui montrer au loin, dans un bouquet de pins, la fameuse cabane.
« Voilà ! » dit-il.
Et le geste pompeux dont il accompagna ce mot les fit rire l’un et l’autre.
Quelques minutes plus tard, les petits étaient là. Les chefs de rang des deux divisions, entourés de leurs camarades, s’abouchèrent aussitôt pour établir le programme des diverses compétitions. Tandis que l’on écoutait leur conférence sur les courses en sacs, courses à l’œuf, courses aux ciseaux et autres, Georges s’était glissé à côté d’Alexandre, et lui serrait la main doucement. Dans le tumulte des discussions, il lui dit à l’oreille :
« Ne participe à aucun concours. Tu me suivras à distance, après le repas, quand les jeux commenceront. »
Il lui tardait que le déjeuner finît, et l’on ne finissait jamais. Les châtelains avaient eu la gentillesse de faire distribuer du café glacé. Cela les obligerait peut-être à murer une fenêtre de plus. Au milieu d’un groupe, l’économe donnait la statistique de tout ce qui avait été mangé cette année à Saint-Claude : tant de tonnes de ceci et de cela… Cependant, on prenait place le long d’une grande avenue.
Georges fit signe à Alexandre. Il avança rapidement droit devant lui, puis s’arrêta, caché par un arbre, et regarda avec précaution. Lorsque l’enfant eut approché, il lui cria : « À la cabane ! » Il reprit sa fuite d’arbre en arbre, et pénétra dans la maisonnette. Un instant après, Alexandre faisait irruption. Georges ne l’avait pas même entendu venir ; les aiguilles de pin qui couvraient le sol avaient feutré le bruit des pas.
Ils examinèrent leur domaine, qu’éclairait une petite fenêtre sans volets. Un baquet retourné tenait lieu de siège ; ils le poussèrent le long du mur avec les instruments de jardinage, et s’étendirent côte à côte sur un lit de paille qui semblait destiné à les recevoir. Ils avaient retiré leurs vestons. L’enfant, qui avait une chemisette aux manches courtes, montra à Georges la petite cicatrice de leur cérémonie d’avril. Il fut très fier d’avoir gardé cette marque, disparue chez son ami.
« L’idée de nos vacances me préoccupe, dit Georges. Pour que nous puissions nous retrouver, il faut que nous puissions correspondre. J’ai beaucoup réfléchi à cela et ne vois que deux moyens : le premier, c’est le système de la poste restante. »
Alexandre demanda si, à son âge, on était autorisé à recevoir du courrier poste restante. Georges l’ignorait. D’ailleurs, l’enfant avoua qu’il aurait honte d’aller réclamer des lettres. Enfin, ces choses-là n’étaient-elles pas surveillées par la police ?
« L’autre biais est plus sûr, dit Georges, et nous permet de demeurer en famille : il consiste à faire entrer Maurice dans le complot, afin qu’il me permette de t’écrire sous son nom.
« Que veux-tu ? Notre amitié va cesser d’être secrète. Au retour des vacances, elle sera un fait public. Pourquoi ne pas nous confier déjà à quelqu’un qui nous sera fort utile ? Rassure-toi, je sais ce que je dois dire à Maurice, comme je savais ce que je pouvais dire à Lucien. Quant à mes lettres, elles seront sous double enveloppe, et, de plus, je demanderai à ton frère sa parole d’honneur de ne jamais les ouvrir. Il ne peut rien me refuser. J’ai barres sur lui pour de petites histoires de classe — oh ! rien de grave, mais enfin, je le tiens. »
Alexandre, en se laissant convaincre, ne manifesta aucune curiosité à l’égard de ces histoires. Georges s’en félicita. Il aurait regretté d’évoquer ici davantage le père de Trennes, même à travers un récit fictif.
Les projets de vacances de leurs parents, tels que les deux amis les avaient fait préciser par leur dernière lettre, ne concordaient malheureusement pas : la famille d’Alexandre choisissait la Côte d’Azur et celle de Georges la Côte basque. Mais Georges ne s’en inquiétait pas outre mesure.
« Je ferai le diable à quatre pour changer de Côte, dit-il. Maurice nous sera plus précieux que jamais. Je dirai qu’il m’attend, avec d’autres camarades, et que c’est une réunion patronnée par le collège.
« Tu sauras sans doute, le jour de la distribution des prix, dans quelle station tes parents ont décidé d’aller. Si, par extraordinaire, ils n’étaient pas encore fixés, tu me renseignerais par lettre le plus tôt possible, et je tiendrais les miens en suspens jusque-là.
— J’aurai certainement quelque chose à te dire, la veille du 16 juillet. Devines-tu pourquoi ?
— Tu es un ange — l’ange du collège — de penser déjà à mon anniversaire. Je n’oublierai pas non plus le 11 septembre, fête de saint Hyacinthe. Toi au moins, tu es bien né. Je suis venu au monde vingt-quatre heures trop tôt. Le 16 juillet, je n’ai le choix, suivant les divers calendriers, sacrés ou profanes, qu’entre saint Hélier, saint Hilarion, saint Alain, sainte Estelle, sainte Reinelde, sainte Marie-Madeleine Postel et la commémoration de Notre-Dame du mont Carmel — tu vois que j’ai étudié mon cas. Et avec tant de saints, j’ai raté saint Alexis qui est le lendemain. Quel dommage ! Alexis et Hyacinthe n’étaient-ils pas faits pour s’entendre ? »
L’enfant pria Georges de répéter le premier de la kyrielle de noms qu’il avait cités, puis il dit :
« Je n’ai pas à t’apprendre que, suivant l’étymologie, Hélier, c’est le soleil. Et tu m’as appris que le soleil était l’ami d’Hyacinthe. »
Ils gardèrent un moment le silence. Georges goûtait avec délices la présence de cet enfant couché près de lui et qu’il ne voyait pas. Ils étaient restés sur le dos, tournés vers la fenêtre qui découpait le ciel. Les branches de pin tissaient leur réseau délicat sur ce morceau d’azur. Les cris des jeux officiels, qui s’entendaient au loin, semblaient rendre plus douce cette solitude. La voix d’Alexandre s’éleva de nouveau, fluide et suave :
« Le soir, dans mon lit, j’aperçois les étoiles par la fenêtre ouverte. Je leur parle de toi. »
Georges tardait à répondre, voulant prolonger la résonance de ces mots. Il dit enfin :
« Je n’irai pas en vacances sans avoir connu ta place au dortoir : elle doit faire partie de mes souvenirs de cette année. »
Alexandre indiqua la rangée, le numéro des serviettes, la couleur du couvre-pieds.
« As-tu songé, reprit Georges, que, l’an prochain, nous aurons le même dortoir ? Il n’y a aucune chance que nous soyons voisins, puisqu’on est rangé par classes, mais je t’apercevrai te coucher. Nous nous sourirons, au moment où s’éteindra la lumière. Quand tu te réveilleras, les cheveux embroussaillés, tes yeux me chercheront tout de suite. En étude, tu seras devant moi, élève de quatrième. Tu éclaireras mon travail. Pour que ton écriture se confonde avec la mienne, tu me donneras les buvards dont tu te seras servi.
« Les récréations ne nous permettront pas de nous parler beaucoup — nous devrons être des amis discrets — aussi aurons-nous une correspondance quotidienne. Je t’enverrai un billet le matin et tu m’en enverras un le soir. À la chapelle, nous ne serons pas très éloignés, si l’on groupe les voix. Au réfectoire, tu n’auras qu’à me faire signe, quand tu voudras que je te garde mon dessert, même quand il ne sera pas celui des professeurs. Je te donnerai de mon goûter.
« En cette saison, nous nous baignerons ensemble les jours de promenade, ainsi que nous aurons fait ces vacances. Le collège sera pour nous de perpétuelles vacances. Il sera le paradis de tes treize ans, de mes quinze ans. »
Alexandre dit dans un murmure :
« Je t’aime plus que ma vie. »
Croyait-il encore, ce jeune garçon, ne parler que le langage de l’amitié ? Georges se tourna vers lui. L’enfant, qui avait fermé les yeux, les rouvrit tout grands, comme s’il sortait d’un rêve, et se redressa.
« Fumons une cigarette, dit-il.
— Tu veux achever de me griser ?
— Je veux me dégriser. »
Georges prit dans la poche de sa veste le paquet égyptien. Il alluma les deux cigarettes, et, au bout d’un instant, en proposa l’échange. Alexandre accepta en souriant.
« Pas mal ! » fit-il.
Il s’amusa à lancer des bouffées de tabac sur Georges, qui le lui rendit. Chacun cherchait à éviter la fumée que l’autre lui soufflait. Ils riaient de leur jeu, qui se changeait en mêlée sur la paille.
Tout à coup, une ombre intercepta la lumière de la fenêtre : c’était le visage du père Lauzon. Quelques secondes après, ce dernier poussait la porte et entrait dans la cabane. Georges, d’un bond, fut debout. Alexandre se leva lentement.
La physionomie du prêtre ne trahissait pas la colère, mais la douleur et le dégoût. Il tenait à la main son bréviaire — il y gardait un doigt pour marquer la page. Il contemplait la paille, où les deux corps avaient laissé leurs empreintes. Il éteignit du pied les cigarettes qui grésillaient dans un coin — les cigarettes du père de Trennes, pareilles à celles que le supérieur avait vues chez ce père, la nuit où Maurice était son hôte. L’arrivée du père Lauzon dans la cabane répondait à celle du supérieur dans la chambre de l’ancien surveillant.
Et maintenant, le père allait-il ramener Alexandre et Georges devant lui, honteusement, tels deux voleurs poussés par un gendarme ? Les mettrait-il à genoux contre un arbre, en présence de tout le collège ? Peut-être se croirait-il permis de commencer par leur donner un soufflet. Mais il ne fit que prononcer ces mots avec tristesse :
« Malheureux enfants ! »
Alexandre, indifférent jusqu’ici, sourit avec impertinence. Georges s’empressa d’intervenir, comme il l’avait fait le jour de leur confrontation.
« Je m’excuse », dit-il…
D’un geste, le père l’interrompit :
« Allez, rejoignez l’un et l’autre vos camarades. »
Ils endossèrent leurs vestons. Georges, à son poignet, regarda machinalement sa montre : trois heures et demie. C’était une heure dont il se souviendrait. Le paquet de cigarettes tomba de sa poche. Il n’osa le ramasser.
L’enfant étant parti d’un pas rapide, il cru convenable de se laisser distancer. Il jeta un coup d’œil, afin de voir si le père les suivait. Il l’aperçut dans l’embrasure de la porte, figé, semblable à la statue de sel.
Alexandre attendait Georges non loin des élèves. Il lui dit d’un air fier :
« Pour nous, tout ça ne compte pas. »
Mais Georges avait le pressentiment qu’ils avaient désormais à compter avec quelqu’un et que c’étaient les jours de leur bonheur qui étaient comptés.
Ils rallièrent les groupes sans se faire remarquer. Lucien eut vite perdu le sourire malicieux avec lequel il avait accueilli Georges. Il l’écouta d’un air accablé, mais se reprit bientôt.
« Évidemment, dit-il, c’est une sale affaire. Mais vous avez encore une chance, le petit et toi : c’est d’avoir été surpris justement par Lauzon, qui est votre confesseur à tous deux et l’ami des Motier, père et fils. Il vous a déjà sauvés une fois ; il a récemment sauvé Maurice, qui était dans une situation plus critique. Il mérite la médaille de sauvetage, plus encore qu’aucun d’entre nous n’a mérité celle de la congrégation. Il a ses habitudes avec vous. Note qu’il ne vous a pas infligé de punition. Cela se réglera par de grands mea culpa devant L’adoration de l’Agneau. »
Le père approchait, lisant son bréviaire ; probablement, la vie des apôtres Pierre et Paul. Georges se rappelait les premiers mots qu’il avait lus ce matin dans l’office de ces apôtres, et il n’en avait pas lu davantage : « … Vous m’avez éprouvé, Seigneur, et vous me connaissez. Vous savez ce que je suis, assis et debout. »
Triste retour de la grande promenade. Georges ne voyait plus dans ce nom qu’une ironie amère : la grande promenade aurait été la plus funeste de toutes les promenades de sa vie.
On avait troqué les itinéraires. C’était à Alexandre à suivre la voie romaine entre les champs de coton. Les rangs n’étant pas fidèlement observés, peut-être allait-il seul, tout à ses pensées, puisqu’il n’avait pas de confident pour tenter de se distraire, et peut-être comprenait-il enfin que l’événement d’aujourd’hui était grave. L’amitié que Georges et lui avaient cru éternelle, comme Rome ou Athènes, devenait le jouet des vents, simple touffe de coton.
Derrière Georges et Lucien, Maurice plaisantait en joyeuse compagnie. Il avait plus et moins de raisons qu’il ne croyait d’être gai : celui qui avait failli le faire renvoyer avec le père de Trennes se trouvait lui-même dans le cas d’être renvoyé, mais avec son frère. Soupçonnant peu de tels problèmes, Maurice se faisait répéter un air de valse :
Blonde rêveuse,
Douce charmeuse,
Dans l’air tu fais flotter
Le parfum du baiser…
Quand il eut bien retenu ces paroles et l’air approprié :
« Dire, s’écria-t-il, qu’on nous fait apprendre par cœur des imbécillités et qu’il existe de si jolies choses ! C’est moins beau que du Richepin, mais il y a la musique. Je me ferai donner des leçons de valse, cet été. Ce seront mes devoirs de vacances.
— Tu te rappelles, dit Georges à Lucien, sa réflexion de l’autre jour sur les pères qu’on fait valser ? Moi aussi, j’entre dans la danse.
— Mon petit Sardinet, dit affectueusement Lucien, je suis bourrelé de remords envers toi. Si je ne t’avais indiqué cette maudite cabane, tous ces malheurs ne seraient pas arrivés.
— Mais non, voyons ! C’est la faute du jardinier qui n’a pas balayé les aiguilles de pin. D’ailleurs, je te dois également les rendez-vous de la serre, qui n’ont jamais été surpris. »
Il ne pouvait dire à Lucien que ses scrupules étaient superflus, puisqu’il avait été la cause de la disgrâce d’André. Ils étaient quittes.
Près de Saint-Claude, Georges remarqua les feuillages coupés qui étaient sur le bord du chemin, souvenir de la Fête-Dieu. On était déjà passé par là ce matin, mais il n’avait pas vu ces branches mortes : alors, il levait les yeux vers la montagne.
Dans cette maison qu’il avait quittée triomphant, il reparaissait vaincu. Il lui semblait que tout y était changé, que la vie s’en était retirée, qu’il ne restait plus que des pierres. Le collège avait cessé d’être un jardin enchanté et ne serait jamais le paradis qu’il avait promis à Alexandre. Il aurait aimé voir ces murailles en ruine, comme il aurait voulu que les cigarettes eussent mis le feu à la cabane.
Le dîner fut plein d’animation. Même le supérieur qui, la chevelure en désordre, avait l’air émerillonné ! Georges avait encore moins faim que le soir du renvoi d’André. Il devait être, avec Alexandre, le seul à qui la grande promenade n’eût pas donné de l’appétit.
Il regardait, à une des tables voisines, l’élève dont le domaine avait servi de cadre à cette journée, et qui était son père dans Les Plaideurs. Celui-là était revenu grandi par des tourelles, des futaies, du café glacé et des champs de coton. Et dans la cabane de son jardinier, la plus belle amitié du collège avait péri.
Au dortoir, Lucien chercha de nouveau à réconforter Georges.
« Je me demande, disait-il, comment tu peux t’inquiéter. Tu oublies donc qui tu es ? Songe qu’à douze jours d’ici, tu cueilles les prix d’excellence, de diligence et cœtera pantoufle. Les pères sont enchantés d’avoir un nom comme le tien en tête du palmarès. Toute l’année, on t’aura vu briller partout : à l’académie, à la congrégation, dans le chœur à la Saint-Claude, en chaire au réfectoire et en os sur la scène. On ne demande qu’à te conserver, qu’à te laisser faire ce que tu voudras. Mais c’est à toi de savoir t’y prendre, de tirer parti de tes avantages. Tu te figures qu’on va te ficher à la porte. À ta place, au contraire, je poserais mes conditions pour rester.
« Quant à Alexandre, le père Lauzon doit tenir à le conserver aussi précieusement. Il y est même obligé, après avoir répondu de lui au supérieur, voici trois mois. D’autre part, n’avait-il pas arrangé les choses auprès de la famille, pendant les dernières vacances ? Eh bien ! là non plus, il ne peut rien, mon vieux ! Ce serait avouer qu’il est une oie. Mettons qu’il ne craigne pas de se déjuger aux yeux du supérieur et fasse prendre une sanction : les parents ne comprendraient jamais qu’il eût tout arrangé à Pâques et tout bousculé à la Trinité.
« Non, je te le répète, l’histoire d’aujourd’hui, à l’image et à la ressemblance de la précédente, ne donnera lieu qu’à des parlotes. Alexandre et toi, vous sortirez reblanchis par un bain d’eau bénite. La partie sera plus serrée l’année prochaine, mais ce sera pour votre bien. Votre amitié se serait endormie dans les délices de Capoue. Vous serez obligés d’être constamment en éveil. Vous vous croirez toujours à vos débuts. Ma séparation avec André a eu le même effet : le ciel a voulu nous préserver tous de la facilité. »
Le père Lauzon désigna à Georges un siège en face de lui. Il avait encore des égards, mais, cette fois, Alexandre n’avait pas été convoqué. Le père était assis sur une chaise. D’ordinaire, il était dans le fauteuil.
Il observa quelques instant de silence. Évoquait-il le jour où, après leur premier esclandre, Georges et Alexandre avaient comparu devant lui ?
« Je ne sais, dit-il enfin, si ce qui domine en vous est la dépravation ou l’inconscience. La petite fête que j’ai interrompue hier ne m’avait guère préparé à vous voir faire, ce matin, la sainte communion. Je remercie la Providence, qui m’a permis de surprendre ce sacrilège, pour qu’il ne se renouvelle plus, entendez-vous ? »
Sa voix s’était élevée et était devenue impérieuse. Il regardait Georges fixement, la tête droite. Les mots du début et le ton altier de la fin donnèrent un instant à celui-ci l’envie de se montrer insolent. Mais il calma son amour-propre, moins inflammable que celui d’Alexandre : il le plaçait ailleurs que dans les sentiments d’un père Lauzon. Il s’était répété, en se rendant à l’assignation : « Ruser encore, ruser toujours, mieux qu’une taupe. » Il se souvint de la réponse par laquelle il s’était dérobé aux entreprises du père de Trennes, la même qui avait soustrait Maurice à l’enquête du supérieur, la réponse de la maison.
« Je communie chaque jour, dit-il, et n’ai jamais communié sans être en état de grâce. Ce n’est pas sur de simples apparences que vous devez douter de moi.
— Je ne doute plus de vous à présent. Je sais de source certaine, hélas ! que les choses sacrées n’ont jamais eu de sens pour vous. C’est votre piété qui n’a été qu’une simple apparence. « En état de grâce ! » osez-vous dire. Cessez de profaner de pareilles expressions. La vie secrète que vous avez menée est un déni de la foi.
— Je vous jure, dit Georges d’un ton ferme, que c’était hier ma première rencontre de ce trimestre avec Alexandre Motier.
— C’est dommage qu’Alexandre Motier m’ait dit tantôt que vous et lui sauriez vous retrouver sans moi, ainsi que vous aviez toujours fait. Le seul moyen qui vous reste d’éviter les faux serments est de n’en faire aucun, comme celui de révérer les sacrements est de vous en abstenir désormais, après les avoir odieusement pratiqués.
« Vous vous dispenserez de vous représenter à mon confessionnal. Ce subterfuge criminel a fait long feu. Je vous rends la direction de votre conscience, si tant est que je l’aie jamais eue. Croyez que c’est avec tristesse que je vous abandonne à un destin qui m’effraie, mais on ne me trompe qu’une fois. En vous laissant aux mains de Dieu, je continuerai de Le prier qu’il vous éclaire et vous sauve à votre heure, d’après les voies qu’il a choisies.
« Du reste, ne vous inquiétez pas outre mesure, temporellement : je ne dirai rien à M. le supérieur ni à personne. Mais il va de soi que je me verrais obligé d’avertir vos familles à l’un et à l’autre, si le petit Motier et vous essayiez, de quelque manière que ce fût, de rentrer en relations. Cela étant posé, je ne vous demande qu’une chose : ne pas revenir ici l’an prochain. »
En dépit des réflexions de Lucien, Georges avait prévu un tel arrêt, qui lui paraissait inéluctable. Son cas était de même nature que celui du père de Trennes. Le supérieur n’avait pas écouté son amitié pour quelqu’un qui abusait sa confiance et qui dérogeait aux principes. Le père Lauzon n’aurait pas plus de pitié : lui aussi, il se vengeait et vengeait Dieu. Sans le savoir, il vengeait par surcroît le père de Trennes.
Maintenant, Georges n’était qu’un garçon qu’on met à la porte du collège : c’était autre chose de l’avoir imaginé et d’être devant le fait. Il s’étonnait de ne pas pleurer. Mais sa lucidité n’était pas amoindrie par son trouble : elle lui inspira l’idée d’une suprême tentative d’attendrissement. Il tira son mouchoir, qu’il avait parfumé ce matin, et avec ostentation s’en couvrit les yeux.
« Je vous en prie, dit le père, n’essayez pas de la comédie des larmes ; elles sont fausses, comme vos paroles. Il n’y a de vrai chez vous que le parfum. Là-haut, vous m’avez ouvert une fenêtre sur votre cœur. Je vois l’orgueil, l’hypocrisie et un vice encore plus grave. Pauvre futur marquis de Sarre ! »
Georges fit semblant de s’essuyer, puis, froidement, remit le mouchoir dans sa poche. Le père continua :
« Il me reste à vous signifier les dispositions que j’ai arrêtées pour ces derniers jours. À la fin du dernier trimestre, j’en avais déjà pris à l’égard de votre respectable compagnon ; il est inutile de vous dire que l’application de celles-ci sera plus exacte. Je les résume ainsi : vous ne vous absenterez jamais de la communauté. Pendant les récréations, vous voudrez bien ne pas aller au piano — vous pouvez bien faire le sacrifice de quelques moments d’harmonie. Durant les études, pas de visites aux professeurs : si vous avez quelque chose à leur demander, que ce soit après les classes. Aux répétitions des Plaideurs, vous ne quitterez pas vos camarades.
« Votre surveillant a reçu les instructions de ne plus vous laisser sortir seul. Afin de ménager votre amour-propre, et un peu le mien, je lui ai dit que vous m’aviez prié de vous imposer cette règle par mortification. Je vous demande pardon, comme à lui, de la dérision de ce terme, digne de celle que, tantôt, j’ai relevée chez vous, mais j’ai ajouté que c’était dans le dessein de vous empêcher de fumer, ce qui est une demi-vérité, n’est-ce pas ?
« J’ai eu l’air de vous dire que, hors votre renvoi, je ne vous infligerais pas de sanctions. Il en est une, pourtant, dont je ne puis vous exempter ; elle est, en quelque sorte, morale. Je ne parle pas, naturellement, de celle qui consiste à vous radier de la congrégation, où j’espère que vous auriez eu la pudeur de ne pas reparaître. L’autre vous touchera davantage : elle concerne un de vos prix. Il est des lauriers que je ne vous permettrai pas de cueillir : ceux de l’instruction religieuse, auxquels vous étiez en droit de prétendre, à ce que l’on m’a dit. Avouez que la bouffonnerie serait un peu forte. Bien plus : ce serait une manière de sacrilège et je dois prévenir également celui-là. Or, il se trouve que la composition secrète en instruction religieuse a lieu après-demain. Cela nous fournira le moyen de remettre les choses en ordre, sans mêler des tiers à cette triste histoire : vous n’aurez qu’à faire un travail médiocre — sans trop d’affectation — de manière à ne pas avoir le prix. Si vous avez un accessit, ce n’est pas la même chose : il sera la récompense de votre mémoire, de votre fantaisie, de votre ironie — je ne redirai certes pas : de votre mortification.
« Je vérifierai la façon dont vous vous serez acquitté. Dans le cas où vous m’auriez désobéi, je me verrais forcé de recourir à M. le supérieur : vous seriez, sur-le-champ, exclu du collège et effacé du palmarès. Choisissez : de perdre un prix ou de les perdre tous. Ou plutôt, évitez de provoquer un nouveau scandale. De même, évitez de me braver en revenant à la rentrée : ce serait faire un déplacement inutile. Imaginez, à votre tour, quelque prétexte honorable à l’égard de vos parents. Je n’ai pas besoin d’ajouter que je me tiens à leur disposition, si vous vous jugez incapable de mentir de nouveau. Mais j’aime à croire que ceci aura été notre dernier entretien. Nous nous sommes tout dit.
« Un mot encore. Vous vous amusiez, dans le passé, à prendre auprès de moi quelques conseils de lecture. Je vous recommande un petit traité de M. Hamon, intitulé : Les vingt-trois motifs d’être humble. »
Le père se leva, et, se dirigeant vers la porte, l’ouvrit devant son visiteur.
Georges savait à présent ce que ses anciennes victimes avaient ressenti, lorsque pareille condamnation leur avait été signifiée, même sans conseils de lecture. L’infortune d’André l’avait bouleversé, mais c’est parce que Lucien et lui-même risquaient d’en être atteints. Il ne s’était guère soucié de ce qu’éprouvait le principal intéressé, et guère plus, ensuite, de ce qu’avaient éprouvé Maurice et le père de Trennes. Et voici qu’il les rejoignait tous. Il était le petit Robespierre de Saint-Claude : il avait commencé par faire exécuter son rival, puis ses complices, et sa propre exécution était venue.
Il gagna le dortoir désert et se jeta sur son lit. Rien ne troublait ses pensées ; le collège était silencieux. Le dernier moment de liberté dont il profitait avant de connaître ses entraves, ne lui servait qu’à mesurer son désastre.
Le père Lauzon n’avait rien dit du sort qu’il réservait à Alexandre. Ayant à faire un choix, il n’avait pu hésiter. Comme Lucien avait dit, il garderait son ancien protégé — il le garderait pour le réconcilier avec Dieu. Il avait réussi à séparer irrémédiablement les deux amis. Tout en croyant que le soleil se levait le samedi en l’honneur de la sainte Vierge, il avait vu enfin aussi clair que le père de Trennes dans le dédale de leurs roueries. Le lauréat de l’Académie des Palinods venait de clore un poème vivant et merveilleux, celui de Georges et d’Alexandre. Son énergie et son autorité s’étaient révélées autrement que dans le fait de commencer par un « Je » les paragraphes de ses lettres. Ce prêtre aux yeux candides, ce benoît confesseur avait réagi en homme qui se voit joué par des enfants, en prêtre qui se voit bafoué par des impies.
Les vacances, qui avaient été si riches en promesses, seraient solitaires. À la rentrée, l’enfant ne verrait pas Georges dans ce dortoir, où ils auraient dû se retrouver. Qu’importaient à celui-ci le renvoi de la congrégation, la perte d’un prix, les raisons à donner à ses parents pour ne pas revenir au collège ? Il lui semblait que tout avait cessé d’exister. Au plus grand bonheur du monde, n’aurait manqué qu’un peu de chance.
Georges se sentit gagné par le désespoir et ses yeux s’emplirent de larmes. À présent, il ne simulait pas : c’était l’heure de la vérité. Il avait pleuré, quand son amitié avait été menacée par le père de Trennes. Il pouvait bien pleurer, maintenant qu’elle était anéantie. Il était seul, et cependant il étouffait ses sanglots, comme si le dortoir avait été plein de monde : c’est ainsi que Lucien et Maurice avaient pleuré. Il prit son mouchoir, puis le jeta, irrité par l’odeur de la lavande.
Une vingtaine de minutes avant la fin de l’étude, il se décida à descendre. Ce fut le regard de Lucien qu’il rencontra tout de suite. Ce regard lui fit du bien. Il remarqua ensuite que le surveillant lui souriait avec gentillesse. Sûrement, l’abbé pensait aux mortifications de cet élève modèle, qui s’interdisait désormais de quitter cette étude, pour se priver du plaisir innocent de fumer. Georges fut réconforté aussi par ce sourire. Quelqu’un encore était sa dupe. Il songeait au père de Trennes, qui imposait également des mensonges en guise de mortification, dans des histoires de pyjamas.
Lucien lui glissa son devoir pour qu’il le recopiât au plus vite. C’était la première fois que le major de la classe allait copier une version latine. Mais ayant été appelé au début de l’étude, il n’aurait jamais eu le temps de traduire, dans le quart d’heure qui restait. Il transcrivit rapidement, en changeant quelques mots de-çà et de-là. Lucien avait pu se passer de ses services : le passage de l’Énéide, d’où était tirée cette version, se trouvait traduit entre les lignes, dans un ouvrage qu’André lui avait donné. Le soir où Georges se préparait à trahir ce dernier, il avait copié le devoir de mathématiques de Lucien. Maintenant qu’il avait payé cette vilenie, il lui était bien permis de copier sur André lui-même.
La cloche sonna avant qu’il eût fait les scansions qui devaient terminer ce travail. On ramassait les feuilles. Georges écrivit en tête de la sienne : « J’ai été retenu hors de l’étude par mon directeur de conscience et je n’ai pu scander. »
Lucien fut outré de ce que Georges lui apprit au dortoir. Il ne pouvait admettre qu’on se laissât expulser par le père Lauzon. Il fallait de nouveau se dénoncer au supérieur pour voir ce que ça donnerait. En tout cas, c’est à celui-là seul qu’il appartenait de prendre une décision radicale. Et qui sait ce qu’il dirait, si Georges lui demandait des nouvelles du père de Trennes ? Il se calmerait peut-être du côté du père Lauzon. Le moment était venu d’invoquer cette protection spéciale, qui serait peut-être plus efficace de loin qu’elle ne l’avait été de près.
« C’est dommage que le père de Trennes n’ait pas été ici au mois d’octobre, dit Lucien. Je te jure qu’André serait encore parmi nous. Un professeur ami des Grecs est la Providence d’un collège, je veux dire : des élèves. Il suffit d’être dans le secret pour que ses excellents confrères ne puissent plus rien contre vous. Notre Maurice nous le prouve. André m’avait raconté une histoire de ce genre, qui est arrivée je ne sais où.
« L’essentiel est de ne pas se laisser décourager par un échec, intimider par des menaces. Il ne faut jamais abandonner la partie. Rappelle-toi cette phrase de notre dernière version d’Hérodote : « Ce n’est qu’à force de tentatives qu’on réussit. » C’est à force de vouloir que tu as conquis l’amitié d’Alexandre, comme André avait conquis mon amitié. Une fois qu’on a un vrai ami, on peut affronter n’importe qui, n’importe quoi. On peut être chassé du collège. On peut attendre une année entière, et même davantage, le moment de se retrouver. Aux vacances de Pâques, André m’a envoyé une poésie là-dessus. »
Georges était reconnaissant à Lucien de lutter contre l’évidence, mais sa conviction était faite. Ses craintes d’hier au soir s’étaient vérifiées aujourd’hui. L’enfant, au réfectoire, avait eu un regard aussi radieux que de coutume, mais c’est le cœur serré que Georges lui avait répondu par le même sourire : il était sûr qu’entre eux, tout était fini.
S’il se jugeait plus perspicace qu’Alexandre, il se jugeait également plus intelligent que Lucien. Les conseils amicaux de celui-ci ne valaient pas les conseils de lecture du père Lauzon : les motifs d’être optimiste étaient moins nombreux que ceux d’être humble. En premier lieu, Georges n’était pas qualifié pour discuter du père de Trennes avec le supérieur. Après avoir parlé en faveur de l’ancien surveillant, pouvait-il, sans désemparer, déposer contre lui ? Quelle grâce espérer de tant de contradictions, de noirceurs, de faussetés ? Ce n’est pas un chantage qui rétablirait les affaires.
Ensuite, Georges ne voyait aucune comparaison entre sa situation par rapport à Alexandre et celle de Lucien par rapport à André. Hors du collège, André et Lucien étaient libres de se revoir, puisque leurs familles se connaissaient et qu’ils avaient déjà passé ensemble une année scolaire et des vacances. Enfin, le départ d’André n’avait pas visé leurs relations.
Georges et Alexandre étaient compromis l’un par l’autre. Séparés, ils n’auraient aucun intermédiaire. Malgré ses roulades, Maurice serait au pouvoir du père Lauzon. Depuis son ambigu nocturne chez le père de Trennes. il était certainement très suspect, quoi qu’il eût dit. Sa correspondance serait épiée, autant que celle de son frère. Les mesures qui venaient d’être prescrites montraient que rien n’était laissé à l’imprévu. Georges avait enfin trouvé plus fort que lui.
« 1er juillet — Fête du Très Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Double de deuxième classe. Ornements rouges. » Pour Georges également, un sang précieux avait coulé et était passé en lui, qui avait donné de son sang en échange. Et il ne lui resterait que le souvenir de cette union mystique, comme de la procession du Sacré-Cœur où il l’avait déjà évoquée, comme de la Confrérie du Précieux Sang à laquelle Lucien l’avait inscrit.
Plus loin, il trouva cette phrase : « Le sang de l’Agneau vous servira de marque. » D’autres souvenirs lui revinrent à l’esprit : celui de cette prière où il était question du sang de l’Agneau, et que le père de Trennes avait dite en revêtant ses ornements, celui de cette gravure qui était chez le père Lauzon, celui de l’agneau de Noël.
Dans la tribune, au-dessus d’Alexandre et faisant face à Georges, le redresseur de leurs torts était en prières. Il avait fini sa messe plus tôt que d’habitude : il surveillait sans doute si son ex-pénitent oserait s’approcher de la sainte table. Georges ne bougea pas. Alexandre devait avoir reçu les mêmes injonctions, car il ne bougea pas davantage. Se souciait-il encore d’écrire au pape afin de protester ? Suivant son mot, tout ça ne comptait pas pour lui.
Pendant la dernière étude, comme chaque samedi, Georges se rendit à confesse. Il avait décidé à l’instant de tenter sa chance, de tenter Dieu. Il exploitait hardiment l’idée que Lucien lui avait suggérée aussitôt après l’incident de la cabane. Lucien lui-même s’était bien converti le 6 octobre, à dix heures trente-cinq du soir ; Georges se serait converti le 29 juin, à trois heures trente de l’après-midi. Alexandre lui-même n’avait-il pas raconté au père Lauzon, un jour des vacances pascales, que la grâce venait soudain de l’illuminer ? À chacun son tour de passer par l’illuminatif et le purgatif. Si l’on n’était pas en état de grâce, on allait s’y mettre. Georges chanterait la palinodie à l’homme des Palinods. Sur un terrain qui lui était interdit, il se mesurerait une dernière fois avec ce prêtre. L’amitié qu’il avait nouée avec Alexandre grâce aux communions, dépendrait irrévocablement d’une confession : les sacrements venaient encore au secours des enfants traqués.
Georges était fort ému en s’agenouillant dans le confessionnal. Il dit d’une voix pénétrée : « Mon père, écoutez-moi, je vous en prie. »
Son attitude contrite montrait qu’il ne s’agissait pas d’une bravade. Il annonça qu’il souhaitait réparer des omissions volontaires de ses confessions passées.
Il commença par des aveux qu’il n’avait pas renouvelés depuis le premier jour. Enchérissant, il se peignit comme l’être le plus corrompu. Mais le malheur lui avait révélé sa honte, qu’il n’avait d’ailleurs jamais fait partager à un autre — il parlait de la même façon qu’André avait parlé au supérieur. Ce qu’il avait demandé à l’amitié, c’était précisément de pouvoir lui faire oublier son abjection, c’était de la pureté, de la lumière. Le remords qu’il témoignait de ces péchés imaginaires sur lesquels il s’étendit, prouvait qu’il était désormais incapable de mensonge.
En somme, il faisait au père Lauzon la confession qu’avait attendue le père de Trennes. Il ne lui était permis de passer pour sincère qu’en s’avouant coupable. Tant pis si cette comédie était indigne ; ce n’est pas lui qui l’aurait voulue. Mais il ne la regrettait pas : il ressentait une joie cynique d’obliger cet homme à écouter, de chercher à l’émouvoir dans son âme de prêtre, de lui inspirer une pitié qui n’était pas méritée. Il se trouvait allégé, comme un véritable pénitent, par sa nouvelle fourbe : il avait déjà l’impression de remonter la pente au bas de laquelle il s’était vu précipité. Il se plaisait à se salir, afin de sauver sa pure amitié ; il s’abaissait, afin de s’élever : c’était le précepte évangélique. Son orgueil, qu’il semblait humilier, n’avait jamais été plus triomphant.
Il s’attendait à des avis circonstanciés, à une exhortation pathétique. Mais le père se contenta de lui dire lentement :
« Pour pénitence, vous méditerez un quart d’heure cette parole : « Je crois en la vie éternelle. »
Puis il fit sur lui le signe de l’absolution.
Le lendemain, à la classe d’instruction religieuse, le professeur dicta ce sujet de composition : « Le paradis terrestre. » Il verrait bien, dit-il en souriant, si les élèves avaient suivi les leçons du début. Il devait penser qu’il leur avait joué un bon tour. Il était enchanté, il se frottait les mains. Mais tout le monde souriait également, parce que tout le monde se rappelait au moins l’histoire du bananier à gros fruits.
Georges était furieux de ne pouvoir traiter un si beau sujet, qu’il connaissait à merveille, indépendamment du bananier. Quelle impertinence de l’avoir obligé à faire le cancre ! On lui imposait une peine sans rapport avec sa faute. S’il était indigne de rester à Saint-Claude, qu’on le renvoyât ; sinon, qu’on lui laissât son dû dans le domaine des études. Il pensait à ce qu’avait dit un jour Alexandre : « Ces hommes que nous payons… » Il payait pour être instruit et pour être récompensé de son travail, que le succès fût celui de la mémoire, de l’ironie ou de saint Expédit. Le confesseur se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Il abusait de son rôle. Se croyait-il au temps du père La Chaise et du père Daubenton, qui gouvernaient leurs rois ? Les élèves de philosophie avaient bien raison de soutenir M. de Trennes. On exagérait, en faisant tout au nom de Dieu. Les anciens Juifs avaient ceci de bon, qu’ils défendaient de prononcer hors du temple le nom de Jéhovah.
Devant la feuille blanche, Georges songeait, la tête entre ses mains. Il était chassé de ce paradis terrestre, après l’avoir été du sien. Les images du jardin biblique se mêlaient dans sa mémoire à celles d’une cabane de jardinier. Le professeur devait s’étonner de le voir immobile, déconcerté, le seul à n’avoir encore rien écrit. Le camarade qui avait été deuxième la fois précédente, se réjouissait probablement.
Dans un élan de révolte, Georges résolut de faire une excellente composition, en dépit de ce qui avait été exigé. Il serait premier à celle-ci, qui était la dernière de l’année, de même qu’il l’avait été à la première. Il tiendrait le pari qu’il avait fait avec Lucien et défierait jusqu’ici le père Lauzon : il aurait ce prix d’instruction religieuse ou il n’en aurait aucun. Il mit en tête de sa composition deux vers d’Anatole France, sous forme d’épigramme anonyme :
Heureux qui, comme Adam entre les quatre fleuves,
Sut nommer par leur nom les choses qu’il put voir !
Cela fait, il s’arrêta d’écrire et, de nouveau, réfléchit. Il lui fallait bien préciser, avant d’aller plus loin, s’il luttait pour un prix ou pour Alexandre. La victoire qu’il souhaitait remporter ne serait que d’un jour et compromettrait irrémédiablement l’avenir. Il y sacrifierait l’avantage que sa confession de la veille lui avait acquis. Ce matin, sa tenue à la chapelle avait été exemplaire et il avait communié sans scandaliser personne. Ici, sur cette feuille, en noir et blanc, l’humilité ne pouvait plus être feinte, mais c’était peut-être la condition du pardon définitif. D’ailleurs, Georges trouvait une sorte de revanche dans cet opprobre même : en l’accusant de fausseté, on lui avait ordonné de commettre un faux.
Eh bien, puisqu’il était condamné à être médiocre, il dépasserait toutes les espérances. Avec joie, savamment, sauvagement, il allait bouleverser le paradis de fond en comble et refaire, comme Garo, l’œuvre de Dieu.
Il laissa en tête la citation et ajouta au-dessous : « Le Franc de Pompignan » — l’auteur des Poésies sacrées remplacerait celui des Poèmes dorés. Quant aux fleuves, il songeait à parler au moins du Tigre et de l’Euphrate, qui faisaient partie de l’histoire d’Alexandre le Grand en même temps que de la géographie du paradis terrestre. Mais cela lui suggéra de prendre des noms uniquement dans cette histoire. Se rappelant que certains exégètes identifiaient avec le Nil et avec le Gange les deux autres fleuves désignés par la Bible, il se donna semblable liberté pour tous les quatre : il choisit le Granique, l’Hydaspe, l’Oxus et l’Indus. Le professeur, frappé par l’équivoque, serait obligé de penser à Alexandre, de se dire le nom, illustre et charmant, qui était le secret de cette farce.
Georges fit ensuite du paradis terrestre le pays où se trouvent l’or, l’encens et la myrrhe, et non celui « où se trouvent l’or, l’escarboucle et l’onyx ». Il le plaça à l’Occident et non à l’Orient. À propos des diverses localisations envisagées, il cita le désert de Gobi au lieu du plateau de Pamir, le Japon au lieu de la Chine, Madagascar au lieu de Ceylan, l’Abyssinie au lieu de la Mésopotamie, le Mexique au lieu du Pérou. N’ayant pas oublié qu’un astronome allemand optait à ce sujet pour le pôle Nord, il le fit opter pour le pôle Sud. Il attribua enfin à saint Pierre le texte de saint Paul dont s’inspirent les pères de l’Église qui voient dans le paradis terrestre une simple allégorie, et mit au compte de Philippe-Égalité le mémoire de son érudit grand-père concernant l’ensemble de la question. Bref, il n’omit rien, mais montra tout à l’envers.
Restait l’arbre de la science du bien et du mal. Sur le cahier de brouillon, Georges s’amusait à tracer : Musa Paradisiaca. Il fit une grande accolade et inscrivit, l’un au-dessous de l’autre, les noms d’arbres plus ou moins bizarres dont il avait connaissance : l’arbre à suif, l’arbre à pain, l’arbre à beurre, l’arbre à cire, l’arbre dentelle, le chou-palmiste, le quercitron, le sassafras, le cocotier, enfin, qui était un arbre à gros fruits — fruits d’une écorce, il est vrai, un peu trop dure pour qu’Adam l’eût croquée. Georges dessina un cocotier où s’enroulait un serpent. Il aurait voulu faire de cet arbre-là celui de la séduction, mais la plaisanterie lui sembla téméraire. Laissant les espèces exotiques, il imagina un instant de choisir le néflier. Il y renonça également : les nèfles ne sont pas de gros fruits, et d’ailleurs, elles ne mûrissent que sur la paille. Il ne parla d’aucun arbre ; ce serait encore mieux.
Maintenant, il était certain d’avoir un zéro, et un tel résultat l’enchantait d’avance, presque autant que s’il se fût assuré la note la plus brillante. Il regrettait que les résultats de la composition ne dussent pas être proclamés. Il aurait eu plaisir à s’entendre décerner la dernière place, à terminer l’année publiquement sur cette chute. Il aurait aimé aussi qu’on lût son texte en classe ; cela aurait amusé la galerie.
Il désirait moins que le père Lauzon se le fît communiquer : celui-ci n’estimerait-il pas qu’il y avait vraiment dans ces erreurs un peu trop d’affectation ? Ma foi, arriverait ce qui arriverait. Mais il était peu probable et que le père demandât à lire la copie — il lui suffirait de savoir qu’elle était manquée — et que, s’il la lisait, il y trouvât le sel que Georges y avait répandu. Il ne connaissait pas toute l’histoire de Georges et d’Alexandre. Les allusions à Alexandre le Grand ne lui apprendraient rien sur l’autre Alexandre. Il passerait le Granique à pied sec.
Pendant la récréation, Georges raconta à ses camarades qu’il avait fait exprès de remettre une composition absurde, parce que ce prix d’instruction religieuse le dégoûtait. C’était bon pour un futur séminariste ; ses amis du lycée se moqueraient de lui éperdument, s’il revenait orné d’une pareille couronne : ce n’était pas une couronne, c’était une tonsure. Il aurait d’ailleurs assez de prix sans celui-là. À la manière du roi-soleil, il supprimait les magots de sa collection. On l’admira. Lucien lui-même le jugea très fort.
« Te voilà magnifié aux yeux des autres, lui dit-il. C’est comme l’interdiction de sortir de l’étude, qui édifie le surveillant. En somme, le père Lauzon et toi, vous devez avoir les mêmes signes d’horoscope dans la Maison des Amis.
— Hélas ! pas dans la cabane des amis. En tout cas, depuis que je n’ai pas été bouté hors du confessionnal tel un anathème, j’incline à penser que tu n’avais pas tort. Qu’il est doux de rentrer dans le giron ! Et pourquoi Alexandre n’a-t-il pas suivi ma tactique ? Puisqu’il continue de s’abstenir de la communion, c’est qu’il se refuse à passer par la confession. Probablement qu’il ne veut pas, cette fois non plus, s’accuser de péchés qu’il n’a pas commis. S’il était moins scrupuleux, tout serait peut-être déjà réglé. Mais qui sait ? Sa résistance rend notre cas plus intéressant. Dans la parabole que nous représentons, il y a deux enfants prodigues, et jusqu’ici un seul est revenu. »
L’académie tenait ce jour-là sa dernière séance. (En effet, le dimanche d’après, avant-veille des vacances, la courte retraite de fin d’année devait s’ouvrir le soir, prêchée par le supérieur.) Philosophes et rhétoriciens passaient leur baccalauréat, recommandés aux prières de la communauté. Grâce à leur absence, Georges s’était arrogé l’honneur suprême d’un fauteuil à ressorts. Le supérieur déclara qu’il avait réservé une surprise : des vers de Bossuet consacrés à la communion, car Bossuet avait été poète, comme il l’était lui-même, Dieu merci. Il se proposait d’en citer quelques extraits dans un rapport qu’il préparait pour le Congrès Eucharistique International, qui se tiendrait au cours des vacances. À cette occasion, il exhorta les académiciens à observer, mieux que quiconque, leurs devoirs eucharistiques jusqu’à la rentrée.
Ces mots de « vacances » et de « rentrée » semblaient à Georges singuliers : il ne savait encore ce qu’ils signifiaient à son endroit. Il voulait espérer que, touché par sa repentance, la père Lauzon lui réservait également une surprise. Il aurait été navré de dire adieu à l’académie de Saint-Claude, le premier jour qu’il y était bien assis. Il retint une stance de Bossuet, en se demandant si elle figurerait dans le rapport du supérieur :
De son chaste baiser, mes lèvres enflammées,
D’un beau feu consumées,
Portent rapidement dans mon cœur entamé
Le trait du Bien-Aimé…
C’était aussi une surprise de revoir le Bien-Aimé au milieu de ce pathos.
Lorsque le père Lauzon vint chercher les congréganistes, il fit signe à Georges de les suivre. Celui-ci eut un véritable transport. Il oubliait ses craintes. Mais, en arrivant à la chapelle, il s’aperçut, du premier coup d’œil, que l’enfant n’y était pas.
Le père Lauzon exposa aux congréganistes quels étaient leurs devoirs pendant les vacances. Toujours des devoirs, comme pour les académiciens. Georges fixait les yeux sur le père, qui semblait éviter de le regarder. Malgré la rémission de fait qu’il en avait reçu, il détestait cet homme. Même si les deux amis reparaissaient l’an prochain à Saint-Claude, quelles difficultés n’annonçaient pas les rigueurs de ces derniers temps ! L’unique obstacle à une vie de délices était cet homme-là. Georges aurait voulu le voir englouti par un abîme : ce prodige aurait été certainement plus utile que celui qu’il imaginait pendant la messe du père de Trennes. Alexandre et lui seraient libres. Ce prêtre aurait emporté leur secret. Et tout aurait été au mieux : il irait dans son paradis céleste et les laisserait dans leur paradis terrestre. Mais il était bien vivant, bien campé, ange au surplis de travers, tenant son mouchoir en guise d’épée flamboyante. Georges trouvait son visage commun, sa voix capucinale, la simplicité même de ses gestes factice. Son éloquence ne brillait que dans le tête-à-tête ; en public, elle était celle de Calino, des Palinods. Le père de Trennes avait un ton mieux soutenu, un visage plus honorable.
Le lendemain, pendant l’étude du soir, Georges avait été appelé chez le père Lauzon.
« L’autre jour, lui dit celui-ci, j’ai été avec vous extrêmement dur : d’abord, vous le méritiez ; ensuite, il fallait vous soumettre à une épreuve. Votre confession a été accablante pour votre amour-propre, mais, en même temps, de quel poids votre âme a-t-elle été soulagée ! Vous ne m’avez prouvé que trop combien mes graves reproches n’étaient pas excessifs. Du moins, en vous obligeant à le reconnaître, ai-je eu le bonheur de vous amender.
« J’ai été édifié par le zèle avec lequel vous avez repris vos pratiques religieuses, malgré l’annonce de votre renvoi. Je ne pouvais croire en vous que le jour où, n’ayant plus rien à ménager, vous n’auriez plus intérêt à me mentir. Si le mal avait été irréparable, vous auriez montré le front d’un fanfaron de l’impiété, en perdant le masque de l’hypocrisie. Dieu a voulu que, dans cette première tempête des passions, vous ne soyez pas de ceux qui périssent.
— C’est à vous aussi que je l’ai dû, mon père, dit Georges.
— En dépit des apparences, il me semblait impossible qu’une âme telle que la vôtre fût tout à fait pervertie, et qu’il n’y eût pas plus de légèreté que de scélératesse dans vos divers comportements. La foi est, quoi qu’on dise, une question d’intelligence : vous ne pouviez donc l’avoir perdue. Si j’ai affecté de désespérer de vous, c’est que j’avais encore quelque espoir. Je vous connais peut-être mieux que vous ne vous connaissez. »
Georges crut le moment propice pour déclarer qu’il s’était rendu, non sans combattre, à l’ordre de manquer sciemment la composition d’hier.
« La peine que vous avez subie là, dit le père, sera le seul souvenir du passé. Puisque vous êtes entièrement venu à résipiscence, je considère comme réglées les questions qui nous divisaient. Je rapporte, par conséquent, la décision que j’avais prise au sujet de votre retour à Saint-Claude. Mais, si vous le voulez bien, je laisserai néanmoins subsister, pour la semaine qui nous reste, les ordres donnés à M. le surveillant : ce sera la justification des motifs louables qui lui furent allégués. Bref, il ne tiendra qu’à vous d’être, ici, le meilleur élève de seconde, après avoir été le meilleur élève de troisième. »
Georges remercia. La joie l’enivrait. Elle était certainement mieux fondée qu’à l’heure où il s’était vu réintégrer dans la congrégation : il savait enfin qu’il pourrait revenir et il n’avait jamais douté qu’Alexandre ne revînt. Ce dernier avait dû capituler aujourd’hui, permettant de conclure enfin la paix générale. Il ne restait plus qu’à en entendre les conditions.
« J’ai autre chose à vous dire, reprit le père. Celui qui vous a suivi dans l’erreur ne vous a pas suivi dans le repentir. Je le recommande à vos ferventes prières, de même que je lui consacre les miennes. L’idée m’accable que, de ce collège où il ne reviendra plus, cet enfant s’en aille, si différent, hélas ! de ce qu’il était quand il y est entré. »
Georges fut frappé en plein cœur. Cependant, il fit appel à son sang-froid et demanda :
« Mon père, n’ai-je pas à me faire de reproches que mon petit camarade soit renvoyé pour la faute qui m’est remise ?
— Je suis sensible à vos scrupules, mais qu’ils ne cachent pas le moindre regret ! Vous n’avez pas lieu de regretter un pareil petit camarade. La résistance qu’il oppose à l’œuvre de salut risquerait de vous mettre en péril vous-même. C’est pourquoi je n’hésite pas à le sacrifier. Entre vous deux, l’amitié n’est plus possible. Elle n’était déjà que trop vive et exigeait de grandes précautions. Les circonstances dans lesquelles vous l’avez entretenue l’ont dénaturée à tout jamais. Laissez-en la dépouille au fond du cloaque d’où vous avez su remonter. »
Pour marquer, apparemment, que l’entrevue était finie, le père Lauzon se leva, mais Georges restait sur son siège, muet, abattu. Le père voulut-il excuser sa douleur ou la purifier ? Il se pencha vers lui et baisa doucement ses cheveux. C’était un baiser de paix et de pardon, digne de celui qui avait clos l’affaire du billet. La clôture définitive aurait eu aussi un saint baiser.
Au dîner, Georges trouva dans son tiroir un long message de l’enfant. Il lui tardait d’être au dortoir pour le lire avec sa lampe électrique. Ce serait la première fois de ce trimestre qu’il lirait ainsi. Enfin, caché sous les draps, il se régala de ces lignes :
Georges,
C’est comme aux vacances de Pâques : je me suis juré de t’écrire et je t’écris. Mais ce n’est pas facile. Nous sommes tellement surveillés !
D’une manière ou d’une autre, il faut tenir bon jusqu’au bout. Toi, tu as imité de nouveau le roseau — et d’ailleurs, je t’admire, je n’arriverais pas à faire ce que tu fais — mais tu peux être sûr que je résisterai mieux que le chêne. Lauzon s’imagine me faire plier, en m’annonçant que je ne reviendrai pas à Saint-Claude par suite d’une histoire qui est arrivée à Maurice — sans doute celle dont tu voulais parler — et, de plus, il m’a retiré mon rôle de page dans la pièce. Bientôt, nous lui jouerons notre pièce à nous, qui le délivrera de nos histoires. Il sait beaucoup de choses — je peux enfin le braver loyalement — mais il ne sait pas que nous avons fait le serment de ne jamais nous quitter. L’heure est venue de le lui apprendre. Puisqu’on a résolu de nous séparer, nous allons nous rejoindre pour toujours en nous échappant. Que c’est beau : pour toujours ! Pour toujours, loin de tous ces gens-là. Pour toujours unis par notre sang. Pour toujours te redire :
Toujours.
P.-S. — Il nous sera plus facile de nous échapper de chez nous que d’ici.
Georges était ébloui. À présent, il n’avait pas à douter de sa félicité. Il baisa ce billet, plus ardemment qu’il n’avait baisé le premier après l’avoir lu dans son Virgile. Il sortit de dessous les draps.
Il regrettait que Lucien se fût endormi : comme le surveillant s’était attardé à l’entrée du dortoir, le cher voisin s’était laissé gagner par le sommeil.
Georges aurait voulu lui dire la bonne nouvelle. C’était bien, en effet, la bonne nouvelle, l’évangile de sa religion revivifiée. Celui qui, une fois de plus, était son sauveur, lui criait le mot de la libération : « Il faut tout quitter pour me suivre. » N’était-ce pas le précepte que Georges avait lu en chaire au réfectoire : tout souffrir, en vue de plaire au Bien-Aimé ? Et Lucien n’avait-il pas dit également qu’avec un vrai ami, on pouvait tout affronter ?
Certes, depuis le jour où, à cause d’André, il avait songé à s’enfuir, Georges n’avait pas eu d’idée pareille, et encore était-il question alors de s’enfuir chez lui et non de chez lui. Il reconnaissait que l’affaire était grave, mais le choix de cette solution ne lui était-il pas imposé, ainsi qu’à Alexandre ?
Par ce message, bien autrement que par sa confession, il se sentait soulagé d’un grand poids. Il n’était plus seul devant l’inconnu, l’avenir lui souriait. Il se trouvait avec Alexandre. Chaleureusement, il se ralliait à ses vues. Les difficultés matérielles lui semblaient secondaires. En reprenant l’initiative, l’enfant rappelait la chance de leur côté. Sa décision annulait celle du père. L’homme qui avait prétendu naguère bien connaître Alexandre, et, ce soir, bien connaître Georges, recevrait la digne récompense de sa perspicacité.
C’est plutôt sa duplicité qui méritait cette récompense : ses discours comportaient des sous-entendus. Il pratiquait la restriction mentale, et, somme toute, n’était pas plus franc que le supérieur. Oui, était-il sincère quand il avait prié Georges de ne pas revenir, et ensuite quand il avait paru lui faire le sacrifice du retour d’Alexandre ? Il savait bien qu’Alexandre s’en irait, du moment que son frère était chassé. Mais afin d’empêcher la réunion des deux amis dans un nouveau collège, il cherchait à retenir Georges dans celui-ci. Il aurait inventé quelque autre moyen de les séparer, si l’un des rebelles rie s’était rendu. Il poursuivait ses plans, aussi méthodiquement que le père de Trennes avait poursuivi les siens. Le dépit devait l’enflammer, en même temps que le zèle. Contraint de se priver d’un enfant qui lui était cher, il tenait à avoir un compagnon d’infortune. Alexandre l’avait bien jugé, en disant qu’il était jaloux. André répéterait la fable du « renard ayant la queue coupée ».
La mesure qui frappait Maurice ne laissait pas d’étonner Georges. Il y voyait une manifestation des principes habiles, mais implacables, qui guidaient les intérêts de cette maison. On n’avait épargné le complice du père de Trennes qu’à titre provisoire, pour diminuer le scandale, autant que pour acheter son silence, et, de fait, il n’avait peut-être dit à personne toute la vérité. Il n’en était pas moins mis à la porte, lui aussi, mais à retardement. On aurait vu bien des systèmes d’expulsion. Quel plaisir de répliquer !
L’enthousiasme de Georges n’avait pas diminué le lendemain, et, dès la première récréation, il tenta de le faire partager à Lucien. Il regardait, à travers les branches, la fenêtre du père Lauzon. Que penserait de cette fuite l’implacable directeur ? Il en mourrait, s’il était logique. Lucien avait écouté en silence, puis prenant son air sérieux :
« Est-ce que par hasard, dit-il, tu es devenu « dingo » ? Quand cesseras-tu de te laisser dicter ta conduite par le père, le fils et le Saint-Esprit ? Ce petit t’aurait demandé d’aller te pendre avec lui, tu irais ? Tiens ! tu me fais aimer le père Lauzon. Il ne se trompe pas en disant qu’il vous connaît, le bonhomme, et je comprends qu’il soit inquiet. Je le mettrai au nombre des pères de l’Église, fléaux de l’hérésie. »
Puis, continuant du ton plus gai que méritait cette remarque :
« D’ailleurs, ce que tu viens de me raconter, ce sont des choses que l’on imagine, mais que l’on ne fait pas. Il y a aussi les choses pour lesquelles on n’est pas fait. Ma conversion me l’a appris.
« Suppose, cependant, que vous réussissiez à vous enfuir, je veux dire : que vous n’ayez pas été rattrapés le lendemain par les gendarmes. Que deviendrez-vous, quand vous n’aurez plus d’argent, plus à vendre de cravates rouges et de chaînette d’or avec médaille ? J’oubliais que vous aurez d’autres ressources : vous louer dans une ferme ou accompagner une roulotte, en chantant le refrain :
Nous sommes les deux gosses
Qui s’aimeront toujours.
« Mon pauvre Georges, tu as cultivé jusqu’ici le genre noble. Prends garde, tu tombes maintenant dans le mélodrame. »
Le collège entier semblait appuyer ce langage. Jamais on n’avait été plus joyeux. Mais Georges, par réaction, s’ancrait dans la résolution contraire, en décidant de la garder par devers lui. Il croyait être déjà près d’Alexandre, et y être pour toujours, selon le mot de l’enfant et de la chanson. Il n’allait pas le sacrifier à des raisonnements ou à des plaisanteries. Georges trouvait Lucien pot-au-feu, terre à terre, bourgeois. Alexandre avait pensé noblement. Ce n’est pas Georges qui le décevrait. Il répondit pour couper court :
« Tu as raison, je vais lui écrire un billet sédatif. »
Si le professeur était content du travail de l’année, il remplaçait les leçons de la dernière classe par une lecture récréative. Ce mercredi, avait lieu la dernière classe d’histoire.
On interrogea le père sur la composition d’instruction religieuse, mais il dit qu’il ne pouvait être à tout et n’avait examiné encore que quelques copies, assez satisfaisantes. Il en parlerait dimanche, du moins dans une certaine mesure, puisqu’il s’agissait d’une composition secrète : aujourd’hui, il n’était question que de se divertir.
« J’ai choisi un texte, dit-il, qui pourra vous inspirer le goût des saines distractions pendant les vacances : une Étude sur les mœurs des lézards, par M. de Quatrefages. »
Ce nom, accouplé aux mœurs des lézards, et que Georges savait déjà étroitement uni à celles des vers à soie, fit le bonheur des élèves. On devinait quelque chose comme l’histoire du bananier. Les lézards faisaient partie du paradis terrestre.
Georges demanda si le Cas de ruse chez la taupe n’était pas plus intéressant. Il se devait, en qualité d’académicien, de rappeler une œuvre qu’il avait cherchée vainement dans la bibliothèque de l’étude, et dont l’auteur était une des gloires du collège. Mais le père répondit que ce cas de ruse concernait des mystères de la nature que l’on ne pouvait évoquer ici. Où la ruse se nichait-elle ?
M. de Quatrefages allait triompher. Un sourire plein de finesse couvrit le visage du vieux père. Il ajusta ses lorgnons, qui pendaient à son oreille par une chaînette. Mais au lieu de lire, il renversa la tête en arrière, heureux d’imposer encore un dernier délai. Il imaginait d’autres horizons que ceux de cette classe. Il était déjà lui-même en vacances, au milieu des champs, sa souris blanche dans une cage — c’est ainsi qu’il l’emportait. Les lézards le chatouillaient. Des deux mains, il prit sur le pupitre un grand ouvrage à reliure romantique et le souleva aussi fièrement que l’évêque de Pergame soulevait sa mitre. Enfin il posa le livre, chercha la page et commença, dans un silence absolu :
— « Les anciens naturalistes, égarés par les changements que l’âge fait subir aux couleurs des lézards, avaient multiplié bien au-delà de la vérité les espèces indigènes de ce genre de reptiles. »
Après cette phrase, le père s’arrêta et regarda l’assistance comme pour juger de l’effet, puis il revint à sa lecture, en la commentant à l’occasion. On apprit qu’il n’y avait réellement en France que les lézards des espèces suivantes : l’ocellé (Lacerta ocellata), le vert (Viridis), le véloce (Velox), celui des murailles (Muralis) et celui des souches (Stirpium).
Les observations de M. de Quatrefages ont porté principalement sur un lézard vert, qu’il a eu pendant huit mois en sa possession. Il le gardait le jour sous sa chemise, et la nuit l’emmaillotait dans du coton.
— « Mon Viridis, écrit-il, aimait surtout le miel, les confitures et le lait, mais il quittait tout pour une mouche. Il avait le goût de la musique. Lorsque j’entrais dans une salle où l’on jouait de quelque instrument, il s’agitait sur-le-champ et venait montrer sa jolie tête au-dessus de ma cravate. Si je le posais à terre, il se dirigeait vers le point d’où arrivait le son. La flûte et le flageolet paraissaient lui plaire. Le bruissement des cymbales, le tintement du chapeau chinois le faisaient tressaillir, tandis qu’il demeurait insensible au bruit de la grosse caisse… »
Les espoirs de la classe étaient remplis. On pouvait ne pas se soucier des détails que le père disait omettre par discrétion, comme s’il s’agissait des taupes. Le Viridis rentra brusquement dans sa cachette : les rires qui se contraignaient depuis le début avaient fini par éclater. On avait fait effort toute l’année pour ne pas rire en instruction religieuse, mais il était permis de rire des mœurs des lézards en classe d’histoire, à la veille des vacances. Le bon père sut le comprendre sans doute, et le bruit calmé, il continua placidement la lecture. Mais chaque fois que reparaissait le mot de Viridis, il jetait un coup d’œil par-dessus son pince-nez et s’arrêtait, en manière d’avis. On le sentait chagriné qu’on ne prît pas davantage au sérieux les saines distractions.
L’étude libre de jeudi matin devait être consacrée à la répétition des Plaideurs. Georges comptait bien que cette sortie lui permettrait de porter un billet dans le tiroir d’Alexandre. En disant à Lucien qu’il allait calmer l’enfant par des arguments personnels, il avait écrit ces mots :
Alexandre,
Je t’aime plus que jamais. Ton courage m’a rendu le mien. Je renonce à tout pour toi, comme tu renonces à tout pour moi. Sitôt en vacances, tu me fixeras le rendez-vous de notre départ. Nous aurons perdu quelques jours, mais nous aurons gagné toute la vie.
Par ce billet, il consacrait son adhésion spontanée, il affermissait la volonté d’Alexandre. Mais, la plume posée, il se demanda si ces beaux projets ne resteraient pas chimériques. Un peu de réflexion l’avait obligé à reconnaître que Lucien ne les avait pas mal jugés. Néanmoins, son imagination tenait toujours à s’y complaire. Tel autrefois un cadet de sa maison partant pour l’aventure, il partirait à travers le monde avec celui qui s’était appelé son page. De plus, il était flatté, dans son amour-propre, d’avoir inspiré une passion si exclusive à un être aussi beau. Aurait-il jamais une meilleure occasion de montrer qu’il avait, autant que les Grecs, le culte de la beauté ?
À la faveur d’un entracte, il s’éclipsa — le père Lauzon ne surveillait pas en personne l’exécution de ses ordres. La chance voulut qu’aucun domestique ne se trouvât au réfectoire. En déposant le billet sous la timbale d’Alexandre, Georges pensait à ce qu’il avait déjà mis dans ce tiroir : un flacon de lavande, des cerises, deux billets. Leur amitié n’avait été faite que de choses aussi simples, qu’on avait prises pour des crimes, et c’est ce qui les forçait, comme des criminels, à se mettre au ban de la société.
Pendant la baignade de l’après-midi, Georges se rendit seul à la même place que la première fois. Lorsqu’il fut sorti de l’eau, il s’allongea au soleil. L’herbe cachait quelques petits cailloux qui s’enfonçaient dans sa peau, mais cette sensation ne lui était pas désagréable : elle était un mélange de piquant et de douceur, pareille aux souvenirs qu’il emporterait du collège.
C’était sa dernière promenade, puisque, dimanche prochain, la répétition aurait lieu à ce moment-là. Il se figurait revoir Alexandre en maillot bleu. Où se baigneraient-ils ensemble, désormais ? Dans quelles mers ou dans quels fleuves ? Les fleuves du paradis terrestre et ceux de l’empire du Macédonien, la mer et les rivières de la carte du Tendre, tout cela resterait dans les livres et les papiers du collège. Georges leva les bras, semblant appeler la bénédiction du soleil sur son corps et sur celui d’Alexandre qu’il évoquait, puis il les abaissa, dans un mouvement rythmique, et appuya les mains à ses épaules. Il resta ainsi plusieurs minutes, les yeux fermés, s’offrant à l’avenir.
Le coup de sifflet indiqua bientôt la fin des ébats nautiques et des rêveries bocagères. Georges jeta un long regard sur l’autre rive. En revenant vers ses camarades, il écrasa les glaïeuls qu’il rencontrait devant ses pas. Aucune fleur ne devrait pousser ici l’année prochaine.
Samedi : « Réunion des anciens élèves. Messe à la mémoire des membres défunts de l’Association. » L’évêque chauve n’était pas revenu : il s’était assez prodigué. Le supérieur prononça le sermon de circonstance : Ecce quam bonum… qu’il est bon… et quam jucundum… et qu’il est doux… habitare fratres in unum !… d’habiter avec ses frères !… Était-ce en mémoire du père de Trennes qu’il citait — certes, dans un sens louable — la maxime des Templiers ?
Cette pieuse assemblée, dit l’orateur, offrait un spectacle réconfortant au milieu de l’agitation fébrile du siècle : elle marquait ce qui reste, à côté de ce qui passe. Il fit ensuite l’éloge des anciens élèves disparus — la transition était un peu brusque — mais bientôt il revint sur le bonheur de ceux qui étaient présents.
« Vous vous souvenez, dit-il, de cette place à la chapelle, où vous avez prié, où vous vous êtes recueillis, après vos communions si fréquentes. Vous vous souvenez de cette place en étude, où, sous le regard de surveillants que vous avez parfois jugés sévères, vous avez vécu des heures si fécondes. Vous vous souvenez de cette cour de récréation, où l’on guidait vers des jeux harmonieux votre exubérance ou votre nonchaloir. Vous vous souvenez de vos amitiés loyales et candides, premiers élans de vos cœurs généreux. Vous vous souvenez, enfin, de vos visites à vos professeurs et à vos directeurs de conscience, pères de vos jeunes âmes et de vos jeunes esprits, qui, avec douceur et fermeté, éclairaient vos vertus et vos travaux.
— Que de « vos » ! », dit Lucien.
Georges songeait à son année de collège. Il revoyait ce qu’avaient été sa chapelle, son étude, ses récréations, son directeur, ses surveillants. Ni Alexandre ni lui ne reviendraient en qualité d’anciens élèves, pas plus que le père de Trennes ne reviendrait en qualité d’ancien surveillant. Pour Georges aussi, il avait été doux d’habiter avec son frère, et c’est parce qu’on voulait l’en empêcher qu’il s’en irait comme lui.
Il observait les hommes réunis dans la nef. Pensaient-ils, les uns et les autres, que le supérieur avait raison ? En fait, même si elles n’avaient eu rien de candide, leurs amitiés avaient bien tourné, puisqu’ils étaient ici. Cependant, quelques-uns avaient connu, sans doute, les mêmes joies que Georges, éloignées du mal, tout inspirées par le beau. Et aujourd’hui, on ne lisait sur leurs physionomies que béat contentement, intérêts sordides, vanité bouffonne, gloire d’être décorés, condescendance méprisante envers les nouvelles générations.
Ces hommes n’avaient qu’un témoignage en leur faveur et ils l’avaient probablement oublié : c’étaient leurs photographies d’autrefois, encadrées dans le couloir du premier étage. Georges se rappelait tel minois ébouriffé sur un grand col rabattu, tel autre si gentil, si délicat, tel autre, au contraire, si effronté, et celui-là, qui avait un regard mystérieux. Ces garçons n’existaient plus. Leurs visages avaient été remplacés par ces visages d’hommes, sur lesquels la vie, la laideur, l’uniformité, le rasoir étaient passés. Georges comprenait à présent ce que le père de Trennes avait dit du visage de l’homme, et il se sentait amoureux de son propre visage, des visages de tous ses camarades, qui l’entouraient dans leur intégrité, leur pureté. Il les aimait, comme des reflets du visage d’Alexandre.
À la classe d’instruction religieuse, le père déclara qu’une des copies de dimanche dernier lui avait réservé une pénible surprise.
« Oui, mes enfants, dit-il, un de vous accomplira le proverbe : entrer pape au conclave et en sortir cardinal. »
Il regarda Georges en prononçant cette sentence et se contenta d’ajouter qu’il s’en expliquerait avec l’intéressé, après la classe.
Certains réclamèrent lecture de la copie, espérant une drôlerie aussi divertissante que celle des lézards. Mais Georges, qui l’avait d’abord souhaité, sut gré au père de se déclarer tenu par le secret. De même, au premier trimestre, il avait été heureux que le Tatou ne fît pas rire de son « Portrait d’ami ». Mais alors, c’est parce qu’il craignait qu’on ne reconnût Lucien. Cette fois, ses camarades n’auraient pas saisi la plupart de ses finesses alambiquées, et, faute d’avoir la clef de l’énigme, auraient cru qu’il s’était moqué de tout le monde.
À la sortie, le père appela Georges. Les curieux firent cercle autour de la chaire, mais il les éloigna. Il demanda à Georges ce qui lui avait passé par la tête pour sa composition.
« Je n’étais pas très bien ce matin-là, fit Georges.
— Vous deviez même être très mal, car votre composition est un tissu d’inepties. On dirait une gageure. »
Georges fut surpris de ce mot : tous les pères avaient leur moment de lucidité. Il avait d’abord songé à dire qu’il avait fait exprès de manquer son travail par mortification — la mortification, c’était ici la « tarte à la crème ». Il se représentait le bonhomme attendri devant tant de vertu, comme devant une souris blanche. Ce vaudeville offrait quelque danger : une réponse aussi édifiante risquait de revenir jusqu’au supérieur et de paraître d’une qualité douteuse au père Lauzon. Il fallait laisser la mortification avec le cocotier et le néflier. Le professeur reprit :
« Vous aviez débuté brillamment par une citation, d’ailleurs plus ou moins de circonstance, mais la suite l’a rendue assez ironique à votre égard. En effet, vous n’avez guère « appelé les choses par leur nom », comme dit votre poète. Non seulement vous avez eu des oublis inexplicables, mais, par un curieux phénomène, tout ce que vous avez écrit est une sorte de transposition de la vérité. Vous avez imité ces religieux dans la règle de qui était noté qu’ils seraient vêtus de noir, et ils mirent dans la marge : « c’est-à-dire de blanc ».
— Je suis confus, mon père. Je ne sais comment j’ai fait.
— Vous avez simplement négligé de repasser vos premiers cours. J’avais bien prévu que j’attraperais quelqu’un, mais je ne croyais pas que ce fût vous.
« Je ne vous cacherai pas que vous en porterez les conséquences : vous aurez un prix de moins. Je le regrette, autant que votre directeur, avec qui j’en ai parlé. Mais enfin, lui et moi, nous consulterons M. le supérieur et peut-être sauverons-nous une feuille de vos lauriers. »
L’après-midi, la dernière répétition des Plaideurs devait se faire en costumes. On alla s’habiller à la lingerie. La troupe de Richard Cœur de Lion en sortait, remplissant l’austère couloir de pages et de guerriers. Les pages avaient tous une tenue différente et Georges avait reconnu sur l’un d’eux celle qu’Alexandre lui avait décrite. Il se réjouit que le successeur de l’enfant parût fagoté dans son pourpoint rouge et sa culotte blanche. Le collège aurait le page qu’il méritait.
Les bonnes sœurs ajustaient les costumes. Cela les amusait. Elles faisaient des rires discrets, se moquant des acteurs. Dans un coin, le préfet rembourrait lui-même la gorge de Lucien et citait un vers de La Fontaine :
Même encore un garçon fait la fille au collège.
Près de lui, la comtesse de Pimbêche, le corsage entrouvert, attendait son tour.
Quand la répétition fut terminée et que chacun eut remis ses vêtements ordinaires, Lucien questionna le préfet sur la Champmeslé. Georges en profita pour faire un saut jusqu’au dortoir d’Alexandre. Il riait à l’idée qu’il avait failli s’y rendre en habit de brocart, perruque blonde et talons rouges.
Il n’y avait personne. Georges s’avança vers le lit indiqué. Des images nouvelles s’inscrivaient dans sa mémoire. Ce lit, cette table, cette caissette, ce tapis ressemblaient à ceux des autres, mais n’auraient pu être ceux d’un autre. Ils étaient marqués d’un signe, comme étaient marqués d’un numéro les deux serviettes étendues sur le fer du lit. Au chevet, un pyjama rose était plié. Aujourd’hui, c’est Georges qui avait les idées du père de Trennes : il aurait voulu prendre ce pyjama charmant et se borna à l’embrasser.
Les acteurs avaient été invités à goûter au réfectoire. En rejoignant leurs camarades, ils apprirent qu’on venait de rassembler les deux divisions pour la photographie collective de l’année. On avait oublié la troupe qui, d’ailleurs, avait droit à un cliché spécial le jour de la représentation. Ainsi, à cause des Plaideurs, Georges ne figurerait pas sur la même photographie qu’Alexandre. Le père Lauzon aurait au moins cette satisfaction-là, ou plutôt il n’aurait pas ensuite celle de les brûler en effigie.
Georges n’était pas revenu dans la salle des petits, depuis la courte réunion de janvier. Cette retraite de fin d’année, qui l’y ramenait ce soir, était pour lui une retraite de fin d’études.
Suivant l’usage, les petits avaient été groupés aux premiers rangs, mais Alexandre, qui se trouvait à l’extrémité du quatrième, n’avait pas quitté sa place. C’est là que l’enfant avait écrit à Georges son premier billet entouré de guirlandes et le dernier, signal de la révolte et du départ. À cette chaire, du haut de laquelle le supérieur parlait des vertus cardinales, il avait obtenu la permission d’aller à ses rendez-vous. Les murs de cette étude, il les avait remplis de l’image de Georges. Et maintenant, au-delà de cet horizon, apparaissait le monde ; au-delà des vertus cardinales, la vie.
Georges pensait à la retraite de la rentrée, qu’il avait entendu prêcher ici même. À cette époque, il n’était occupé que de Lucien ; aujourd’hui, il sacrifiait ce Lucien à quelqu’un qui lui demanderait des sacrifices encore plus grands. La première conférence de l’année, où il avait été question des amitiés particulières, avait singulièrement porté ses fruits. Et pourtant, le prédicateur aurait-il été en droit de se plaindre ? Sans doute, Alexandre avait inscrit un autre nom que celui des jeunes martyrs sur le fronton de cette salle ; sans doute, Georges avait pris d’autres voies que celle de saint Placide ; et le Bien-Aimé de leurs cœurs n’avait pas été celui de l’Imitation. Mais, de Lucien à Alexandre, les amitiés de Georges s’étaient élevées : ainsi qu’il l’avait dit au père Lauzon, il était monté vers la pureté, vers la lumière. Le père Lauzon et lui n’y étaient pour rien.
Au cours de la matinée du lendemain, il y eut « instruction en commun », de nouveau chez les petits. Ce n’était plus l’instruction de la retraite d’octobre, qui se faisait séparément dans chaque division : M. le supérieur n’avait pas le don d’ubiquité. Allait-il parler aujourd’hui des vertus théologales, des vertus civiques, de vertubleu ou vertuchou ? « des Trônes, des Vertus et des Dominations » ? Afin d’inspirer, lui aussi, le goût des saines distractions pendant les vacances, il aurait pu parler des vertus des plantes, en évitant toutefois de dire : « vertus des simples », de crainte d’apprêter à confusion.
M. le supérieur avait assez parlé de la vertu. Il avait gardé en réserve une autre pièce, annoncée déjà à MM. les académiciens : son rapport au Congrès Eucharistique.
« J’espère, dit-il, que ce compte rendu, dont vous avez fourni le sujet, vous donnera le désir de persévérer dans vos pieuses dispositions. Voici le titre et l’exorde :
Rapport sur le régime de la communion quotidienne au Collège libre de Saint-Claude (… France), pendant l’année scolaire 19…-19…
Au moment que le monde catholique assemblé rend gloire à Jésus-Eucharistie, il a paru digne de son intérêt de lui montrer ce qu’a été le régime de la communion quotidienne dans un collège libre de France, en vue de porter les directeurs des autres maisons d’éducation à répandre des principes, si riches en grâces de toutes sortes pour la communauté.
Il s’arrêta et des yeux parcourut la salle, comme avait fait le professeur d’histoire après la première phrase relative aux mœurs des lézards. Donnait-il à réfléchir au fond ou à la forme ? Voulait-il voir si ces garçons étaient frappés d’être tout à coup proposés à l’admiration du monde catholique, ou s’ils jugeaient leur supérieur digne de l’Aigle de Meaux, par l’éloquence et par le souffle ?
Cessant de lire, il continua plus familièrement :
« J’ai bien raison, mes enfants, de me féliciter et de vous féliciter. Il y a eu cette année à Saint-Claude, jusqu’à ce matin y compris, 43 973 communions. Voilà qui compte infiniment plus, soit dit sans injure à nos lauréats, que les vaines couronnes de demain. »
Il prit ses feuillets afin de compléter les chiffres :
« Du 4 octobre au 21 décembre, la moyenne des communions quotidiennes a été de 175 pour 198 élèves et 79 jours de présence ; au deuxième trimestre, de 181 — chiffre « record » — pour 193 élèves et 98 jours de présence ; au troisième enfin, de 170 pour 192 élèves et 73 jours de présence, diminution qui n’est qu’apparente, puisqu’elle provient surtout du fait que, ces derniers jours, vos aînés étaient absents, et leur ferveur vous est connue. »
Il leva la tête d’un air triomphant. On devinait qu’il se sentait honoré lui-même, autant par ces calculs que par le fait d’avoir distribué la plupart de ces communions.
« Je ne sais, poursuivit-il, s’il est beaucoup d’établissements scolaires qui puissent s’enorgueillir — j’ose employer ce terme — d’un pareil résultat. Aussi, une intense vie spirituelle n’a-t-elle cessé de régner dans cette maison. La congrégation et les confréries se sont augmentées de nouveaux membres. Les bonnes œuvres ont recueilli des cotisations plus élevées. La conduite générale a été excellente, sauf quelques écarts vite réprimés, et la vertu de l’un d’entre vous s’est signalée sous l’anonyme par un trait de zèle méritoire. »
Georges regretta de ne pouvoir se lever, ainsi qu’à l’annonce de l’élection académique.
« Fine allusion au père de Trennes, murmura Lucien. Moi qui croyais que sa mésaventure était due à l’opération des anges ! Honneur aux cafards !
— Tu sais bien, répliqua Georges, que les anges et les démons, c’est la même chose.
— Voyez, en conséquence, disait le supérieur, de quelle façon ceux dont je rappelais la piété viennent de passer leurs examens (les résultats m’ont été communiqués aujourd’hui même) : sur nos quinze candidats aux deux parties du baccalauréat, douze ont été reçus, dont un — votre camarade X… — avec la mention « Très Bien ». N’en doutez pas, ces succès ont été favorisés avant tout par l’atmosphère morale due à l’état de grâce permanent de la communion quotidienne.
« J’attends mieux de ces divines semailles : la joie de voir croître parmi vous de nombreuses vocations. Mais c’est là un point trop délicat pour que je puisse me permettre autre chose que d’entrouvrir votre conscience vers ces appels d’en haut. »
D’une voix assourdie, il donna à sa prétérition un assez long commentaire.
Georges, insensible à ce ronron, songeait plutôt aux statistiques, que Lucien avait saluées en le pressant du pied, comme André avait pressé Lucien lorsqu’il s’agissait des amitiés particulières. D’une année qui avait commencé par André Ferron, et fini par Maurice et par le père de Trennes, de l’année de Georges et d’Alexandre, il ne restait officiellement qu’une statistique de la communion quotidienne. Cependant, le supérieur n’avait pas oublié ces personnages, puisqu’il avait parlé de leurs écarts. Mais il estimait sans doute que c’était, en somme, peu de chose par rapport à tant de monde. Du moment qu’il n’y avait eu que quelques-uns de pris, il concluait à l’innocence de tous les autres, si bien préservée grâce à un trait de zèle auquel il avait tenu à rendre hommage. Peut-être aussi ne croyait-il à la vertu que dans le dessein de compter les communions. Peut-être encore était-il persuadé que la pratique des sacrements est en soi une vertu, et assez grande pour dispenser du reste : il l’admirait, avec la même confiance que les discours apocryphes ou les poésies authentiques de l’Aigle de Meaux. Peut-être enfin se rassurait-il, en constatant qu’il ne s’était produit aucun de ces malheurs décrits par le prédicateur de la rentrée : ni hosties enflammées, ni morts subites, pour près de 200 élèves et de 44 000 communions.
On avait fait d’autres statistiques à Saint-Claude : Lucien, au début, nombrant ses médailles, ses images et ses indulgences ; l’économe parlant de comptes de cuisine, le jour de la grande promenade ; le père de Trennes faisant relever les sorties des études, en vue de découvrir sans scandale le secret de Georges. Et Georges même avait imaginé ensuite, à l’usage de ce père, diverses statistiques. C’était à lui maintenant à établir les siennes — non pas celles de ses communions et de ses confréries, ni celles de ses premières places et de ses devoirs à note exceptionnelle, mais celles de ses billets et de ses rendez-vous. Il était moins prétentieux que Catulle dans celle de ses baisers.
Le père Lauzon avait écouté le supérieur avec quelque distraction. Il devait se dire que, par sa faute, l’abstention d’Alexandre, depuis plus de dix jours, avait diminué le chiffre des communions. Mais il devait se rappeler également la conversation qu’Alexandre et Georges avaient eue au mois de mars en sa présence, et au cours de laquelle ils avaient parlé de leurs communions quotidiennes d’une manière qui l’avait touché.
En somme, le supérieur n’avait pas tellement tort. Ce qu’il proclamait, c’étaient des faits indéniables et il laissait chacun s’expliquer dans son for intérieur. Il pensait comme cet auteur d’almanach du xviiie siècle qui faisant, lui aussi, une statistique — celle des maisons de Paris — disait qu’il y en avait tant de milliers, « sans compter celles de derrière ». Le supérieur ne s’intéressait pas à ce qui se passait derrière. Eh ! sauf le peu qu’il en avait su, que pouvait-il en savoir ? Chacun, ici, jouait plusieurs rôles : lequel était le vrai ? Certains, qui affichaient le libertinage, ne le pratiquaient peut-être pas. D’autres l’expiaient peut-être par de cruels remords ou par la crainte, comme avait dit Marc, de tomber brusquement — de compromettre leur santé et leurs études. Non contents des prières que l’on récitait pour eux au collège, les philosophes et les rhétoriciens qui avaient flétri l’obscurantisme en avaient sans doute récité une, avant d’affronter leurs examinateurs. Aux classes d’instruction religieuse, on avait parlé de ces grands chefs de la franc-maçonnerie, qui vont faire leurs pâques en cachette.
Oui, en vérité, il était bien difficile d’apprécier la valeur d’un acte, autant que celle d’une intention. Les indulgences de Lucien étaient plus commodes : l’intention était indiquée, on n’avait qu’à s’y conformer, et tout était dit. Mais, à Saint-Claude, quel moyen de s’y retrouver, au milieu de tant d’intérêts adverses ? Les maîtres eux-mêmes rendaient la tâche difficile, avec leur casuistique. Le supérieur n’avait-il pas joué de la direction d’intention, et le père Lauzon de la restriction mentale, ainsi que le père de Trennes jouait de l’équivoque ? De plus, le résultat des actes avait été parfois à l’opposé des intentions : lorsque Georges avait voulu séduire Lucien, il l’avait converti ; Alexandre séduit avait sauvé la pureté de Georges, et Maurice l’y avait aidé par son impureté.
Tout était vrai et faux en même temps, tout était oui ou non, comme le « Carymary-Carymara » de Panurge. Chaque être avait un double qui ne lui ressemblait pas, chaque chose impliquait une contradiction ou cachait un mystère. Selon le prédicateur, il y avait les enfants de lumière et les enfants de ténèbres, qu’il était très mal aisé de reconnaître. La statue de Tarsicius, le martyr de l’eucharistie, avait été donnée par les parents de Lucien, au temps où celui-ci combinait si bien avec André ses maux de cœurs et ses communions quotidiennes. Et sous le socle, un billet déchiré et destiné au supérieur, portait, de la main de Georges, le nom du père de Trennes. Entre les Églogues de Virgile, Georges retenait celle d’Alexis, et le père Lauzon celle de la sainte Vierge. Le père de Trennes orateur privé n’était plus le père de Trennes orateur sacré. Sa valise contenait probablement, avec sa provision de chapelets, les pyjamas de Georges et de Lucien.
Il y avait eu aussi les communions sans équivoque, les prières ferventes, les actes d’une pureté incontestable : Georges n’avait pas communié les premiers jours, parce qu’il ne s’était pas confessé. Lucien et Alexandre, pendant longtemps, avaient été tout aux offices, tout à la communion quotidienne. André Ferron avait été racheté par Marc de Blajan. Les monologues du père de Trennes avaient été remplacés par ceux du père Lauzon — les triomphes secrets de celui-ci avaient dépassé les triomphes secrets de celui-là.
C’était comme à l’égard des études : le rhétoricien qui venait de passer son baccalauréat avec la mention « Très Bien », était le même qui avait dit ne vivre que pour la danse. Sans doute avait-il travaillé plus encore que dansé. Et Georges, de son côté, n’avait songé tour à tour qu’à Lucien ou qu’à Alexandre, mais cela ne l’avait pas empêché d’être le premier de sa classe, autant qu’il avait pu.
Le mal était, en définitive, compensé par le bien. Le Congrès Eucharistique était en droit de s’édifier. Les élèves de Saint-Claude avaient trompé le supérieur, et lui pourtant ne trompait pas les congressistes. Tous avaient reçu leur récompense.
Après la récréation d’une heure, on alla, par groupes, chercher les malles au grenier. Certains soufflaient dessus pour en chasser la poussière et l’on avançait à travers un nuage. Georges évoquait les moments lointains de la rentrée, où la sœur infirmière s’était occupée de ses bagages, qui ne reprendraient pas le chemin de Saint-Claude. Il n’aurait eu ici qu’une rentrée. Comme le père Lauzon l’avait dit d’Alexandre, Georges était bien différent aujourd’hui de ce qu’il était en arrivant. Les changements qu’il avait découverts en lui aux vacances de Pâques l’entraînaient plus loin qu’il ne l’aurait cru alors. Cette malle et cette valise retrouvées lui semblaient, non les dépouilles de son amitié, suivant le mot du père Lauzon, mais celles de son ancienne existence.
Les bagages devaient rester au pied des lits ; les domestiques les charrieraient demain à la gare. Ceux des élèves qui partaient par la route avaient préparé des inscriptions, qu’ils collaient fièrement sur le couvercle : « Ne pas prendre. »
Georges avait persuadé ses parents de venir le chercher par le train, dans l’espoir de voyager avec Alexandre. Il était probable que le père Lauzon voudrait éviter l’encombrement de ce jour-là : il se jugerait suffisamment représenté auprès de son pupille par les parents de celui-ci.
Quels devaient être les préparatifs de Georges ? Fallait-il tout emporter, y compris le pyjama neuf que lui avait donné le père de Trennes, et le décolorant qui blondirait une nouvelle mèche ? Pour ne pas attirer l’attention de Lucien, il décida de faire comme s’il revenait l’année prochaine. Là-bas, à côté du lit que maintenant Georges connaissait, Alexandre se disait sans doute, en plaçant tel ou tel objet à l’intérieur de sa malle : « Je mettrai ceci dans mon sac de voyage, quand je partirai avec Georges, et ceci non. »
La dernière étude de l’année s’ouvrit par la récitation du rosaire. Le surveillant énonçait les mystères de chaque dizaine ; puis il désignait, rang par rang, l’élève qui commençait la prière à laquelle tout le monde répondait. Georges fut gratifié de l’un des mystères glorieux. Cet honneur était bien dû à un élève qui se signalait dans les voies de la mortification — un élève à cause de qui l’image du père de Trennes avait accompagné, dans d’autres circonstances, une lecture relative aux mystères douloureux du rosaire.
Ensuite, Georges contempla ses livres. Il les laissait, naturellement. Dans la lettre qu’il écrirait à Lucien avant sa fuite, il lui dirait qu’il les lui donnait. De ses devoirs, il garderait uniquement celui qu’il avait fait pour lui seul : le second « Portrait d’ami ».
Il se rappela, en voyant son Virgile, ce qu’il avait lu d’émouvant dans cet ouvrage, malgré le dépit que lui avait causé la fin d’Alexis. C’est là qu’il avait déplié le premier billet d’Alexandre. Il songea aux sorts virgiliens, sur lesquels le Tatou avait glosé récemment, à propos de la version tirée de l’Énéide. L’idée lui vint de leur demander, en ce jour, ce que l’avenir lui réservait. Il ouvrit le livre au hasard : le titre de la page lui montra qu’il était encore dans les Églogues — Églogue V. Il lui parut que le destin devait se lire à gauche en tête :
Extinctum Nymphæ creduli funere Daphnim
Flebant…
Il s’arrêta et regarda les deux premiers vers à droite, qu’il traduisit ainsi :
« Souvent dans les sillons auxquels nous avons confié la belle orge, dominent la triste ivraie et les herbes stériles. »
Il est vrai qu’à la fin, Daphnis, par sa mort, devenait un dieu et qu’on parlait déjà de réjouissances à sa mémoire. Cela se terminait plus mal, mais plus honorablement qu’à l’égard d’Alexis.
Les sorts virgiliens étaient bons à mettre avec les oracles de la Sibylle de Panzoust. Les nymphes et le semeur d’orge pouvaient pleurer tant qu’ils voulaient. Pour Georges et Alexandre, il n’était pas question de mort ni de mauvaises récoltes. Les bonnes « semailles » n’étaient pas davantage celles des âmes, figure de l’éloquence du supérieur : c’étaient celles qui avaient fourni le sujet du meilleur devoir de français rédigé par Alexandre ; et la mort de Daphnis ne valait pas « la mort d’Hector », composition où il avait eu la meilleure de ses places. Alexandre et Georges quittaient cette maison pour vivre et non pour mourir. Le même dieu les protégeait, dieu de Thespies et de l’univers, dieu plus vrai que Virgile.
À ce moment, le père Lauzon ouvrit la porte et fit signe à Georges de venir. Il ne s’était pas dérangé ainsi depuis la soirée où son premier pénitent, comme il l’avait qualifié, avait demandé à le voir. Qu’annonçait le frou-frou de cette soutane dans l’escalier ? Peut-être Georges allait-il apprendre que le prix d’instruction religieuse lui était rendu ? Il ne se troublait pas, certain que l’on ne pouvait rien désormais contre Alexandre et lui. Pourtant, lorsque arrivé dans la chambre, il observa le visage de son hôte, il ressentit quelque inquiétude.
« Georges, lui dit le père — qui ne l’avait jamais encore appelé par son prénom — vous savez d’avance de qui j’ai à vous parler. J’ai besoin non plus simplement de vos prières, mais de vos actes. Une volonté satanique anime ce gamin. Selon sa formule, qui serait un blasphème si elle était vraie, c’est pour me faire plaisir qu’il s’abstient de communier, et pour ne pas me faire plaisir qu’il refuse de se confesser. Jamais on ne vit, chez un être aussi jeune, pareille impudence ! Qu’est-ce que la pureté sans l’humilité ? L’orgueil a suffi à perdre les anges. Il est propre, l’ange du collège !
« Je déplorais qu’il affectât de prendre le contre-pied de votre attitude, et je n’aurais pas soupçonné les raisons de sa résistance, qu’il a fini par me dévoiler. Oui, je vais bien vous étonner, Georges : ce qui le soutient, c’est la persuasion que vos sentiments à son égard n’ont pas changé. Dans l’entretien que j’ai eu avec lui ce matin, et où je l’avais un peu malmené, il a eu le front de prétendre que vous le retrouveriez cet été, selon des promesses que vous veniez de lui renouveler par écrit. Je suis maintenant trop sûr de vous pour ajouter foi à ces paroles, en ce qui concerne l’avenir, non moins que le présent, mais je veux lui montrer d’une façon indubitable que le passé est bien mort entre vous deux. C’est une œuvre nécessaire, en vue d’empêcher un coup de tête de sa part. Et cette œuvre ne s’accomplira que si je peux lui rendre, en votre nom, tous les billets et toutes les lettres que vous avez de lui. »
Georges s’apercevait dans le miroir suspendu près de la fenêtre : il était devenu pâle. Le père remarqua son émotion, plus visible encore que celle de l’autre jour, car il ajouta :
« Je comprends que cette décision soit pénible pour votre délicatesse, mais l’importance des intérêts en cause doit vous la dicter. En vous l’épargnant, je vous laisserais la responsabilité la plus terrible. Peut-on mettre en balance de vains souvenirs et l’éternité ? Ce sacrifice, auquel son âme devra sans doute son salut, achèvera d’ailleurs de purifier la vôtre. Rappelez-vous saint Jérôme qui avait emporté au désert les œuvres de son cher Cicéron, et une voix lui disait pendant son sommeil : « Tu n’es pas chrétien, tu es cicéronien. » Il détruisit ces vestiges de passions révolues. Ainsi plus tard saint Philippe de Néri détruisit-il les vers profanes qu’il avait composés dans sa jeunesse. Inspirez-vous des mêmes exemples. À votre âge, on ne les choisit jamais assez haut, et vous n’avez peut-être pas oublié ceux que donnait le prédicateur au lendemain de la rentrée. Vous consentirez donc, sans autre regret, à ce que je vous demande. Je m’empresse d’ajouter que je ne lirai pas votre correspondance — il y a longues années que je ne lis plus de romans.
— Je n’ai aucun de ces billets ici, répondit Georges d’une voix éteinte. Ils datent tous du second trimestre, et je les ai laissés chez moi à Pâques.
— Ah ! je les croyais de ce trimestre, au contraire, puisque avant Pâques, vous aviez affirmé à M. le supérieur n’avoir jamais reçu de billets. »
Il regarda Georges un instant, lui faisant entendre que, désormais, les mensonges étaient superflus : Alexandre et lui, chacun à sa manière, avaient dit enfin la vérité.
« N’importe, ajouta le père. Ne revenons plus sur le passé. Je vous crois sur parole et ne vous ferai pas l’injure de demander à voir votre portefeuille. Dès que vous serez arrivé en vacances, vous m’enverrez tous ces billets à S…, par lettre recommandée. Il est essentiel que j’agisse sans délai : un jour de retard risquerait d’être fatal. Aussi me montrerai-je rigoureux avec celui de qui dépendent les remèdes. Comptons exactement, s’il vous plaît, comme quand il s’agissait de votre entrée dans la congrégation. C’est aujourd’hui le 10. Vous partez le 11. Si je n’ai pas ces billets le 13, j’irai à Saint-Claude le lendemain faire prononcer votre exclusion. Ce serait mal employer la fête nationale.
« Excusez le peu de forme que je mets à cette admonition, autrement sérieuse que la première. Retiré du jeu, vous n’êtes pas encore tout à fait quitte. L’esprit maudit qui vous habitait est allé renforcer celui de votre ancien complice ; il garde vos traits et nous devons les effacer. C’est là qu’il faut frapper le grand coup. J’ai le droit d’exiger votre collaboration. Il s’agit d’un enfant que je considérais comme mon fils spirituel, et qui, à cause de vous, n’est plus aujourd’hui le fils de personne. Non seulement vous l’avez enlevé à son directeur et à ses parents, mais vous l’avez enlevé à Dieu. Vous avez l’obligation de le leur rendre, il vous a trop appartenu. Que dis-je ? l’amitié que vous lui portiez vous commande envers lui une entière réparation. Vous me remercierez un jour de vous avoir imposé cette épreuve, quand vous aurez constaté le bien qu’elle aura produit. Et cet enfant vous remerciera, lui aussi, car il saura, alors, que vous l’avez vraiment aimé. »
Les sons de la cloche qui marquaient l’heure du goûter, et, peu après, les cris des élèves dans la cour, avaient fait écho aux dernières paroles du père Lauzon. Georges, en sortant, n’avait guère le cœur à rejoindre ses camarades. Comme le lendemain de la grande promenade, il se dirigea vers le dortoir, afin de se recueillir avec son malheur. Les bruits du dehors lui semblaient venir d’un monde inconnu. Il se sentait plus seul qu’il ne l’avait été la dernière fois au milieu du silence. Il se voyait dans un désert, devant le néant. Aujourd’hui, des larmes lui auraient paru dérisoires.
Autre chose aussi lui paraissait dérisoire : son projet de fuite. L’assurance inflexible du père lui révélait combien sa propre position était fragile. L’homme qu’on avait si longtemps abusé, savait tout et, par conséquent, préviendrait tout. Il ne servait plus à rien de lutter. Les enfants étaient vaincus.
La surveillance exercée autour d’Alexandre pendant les vacances de Pâques garantissait les précautions qui seraient prises à celles-ci. Georges et lui ne se reverraient pas quand ils se seraient quittés. Le père n’avait qu’un mot à dire pour qu’on ne tolérât pas leur réunion. Ils étaient prisonniers de l’ordre établi. On voulait leur arracher jusqu’à leurs souvenirs. Georges le premier sacrifierait-il les siens ? S’y refuser serait porter le drame dans sa famille, et sans utilité. S’y soumettre serait ajouter la honte à tous ses malheurs. Mais était-il permis de ne pas s’y soumettre ? La sommation du père Lauzon rappelait, en quelque sorte, celle du père de Trennes. Georges avait été en mesure de se défendre victorieusement contre l’une ; il était désarmé contre l’autre. De nouveau, et dans une circonstance capitale, le digne prêtre obtiendrait-il ce que le prêtre suspect avait souhaité ? Il ne resterait à leur adversaire que la mince satisfaction d’avoir pu épargner à son portefeuille une troisième visite.
Quelle naïveté avait été la sienne, de dire qu’il possédait encore les billets ! Il avait répondu comme s’il croyait vraiment à cette responsabilité dont avait parlé le père Lauzon. Il avait su faire meilleur marché de celle dont lui avait parlé le supérieur à propos du père de Trennes. Il s’en voulait, certes, mais il en voulait aussi à Alexandre d’avoir été le principal artisan de cette catastrophe, d’avoir rendu vains les efforts de son aîné, d’avoir, à la vérité, agi en enfant. Dans l’incident de mars, Alexandre avait commis une maladresse : il avait laissé deviner au père Lauzon que ses relations avec Georges étaient plus intimes que ce dernier ne l’avait dit, mais on était sur le chapitre de la communion quotidienne. Cette fois, il s’était plu à exaspérer l’homme dont l’affection le gênait : il avait oublié qu’elle le protégeait. Avait-il pensé que ce prêtre se contenterait toujours de réciter des prières ? Croyait-il le décourager en faisant montre de courage ? Ou bien s’était-il imaginé que tant de franchise ne serait pas prise au sérieux, et qu’il joindrait au plaisir d’avouer celui de tromper ? Sa fanfaronnade avait rendu impossible ce qui ne l’aurait peut-être pas été. Moitié lassitude, moitié légèreté, Georges avait fait le reste. Cette amitié condamnée, les deux amis l’avaient détruite. Ils n’auraient pu la sauver que par des prodiges d’habileté, un plan bien mûri, des efforts patients. Ils s’étaient laissé prendre d’une façon différente aux détours de l’interrogatoire, comme ils s’étaient fait prendre côte à côte dans la cabane. Les moyens leur manquaient pour se révolter, autant que pour se justifier. L’équipée à laquelle ils avaient songé demeurerait un songe.
Lorsque la cloche sonna la fin du goûter, il sembla à Georges qu’elle retentissait comme un glas dans le vide de son cœur. Il descendit machinalement.
Dernière conférence du supérieur. Il annonça qu’il traiterait des vacances. C’était le sujet par lequel il avait commencé l’année chez les grands, et il la finissait de même pour tous.
« Les vacances, dit-il, quel mot magique ! Je ne sais s’il en est aucun qui vous plaise autant que celui-là. Et cependant, ces vacances, que vous attendez toujours si impatiemment, sont une chose grave, la plus grave de l’année entière. Ici, les sacrements, le travail, la discipline concourent à vous maintenir dans la bonne voie, et il s’établit naturellement, entre élèves nourris des mêmes principes, cette émulation du bien, dont je me félicitais hier devant vous. En vacances, vous vous trouvez oisifs, vous êtes vos maîtres, vous pouvez vous laisser aller à négliger les sacrements. Un saint prêtre l’a dit : « Il y a un démon qui guette sous chaque feuille l’écolier aux champs » ; aux champs sous chaque feuille, et à la ville, sous chaque pavé ; à la montagne, sous chaque pierre et sous chaque buisson ; à la mer, sous chaque vague et sous chaque grain de sable.
« Les vacances sont le paradis des écoliers ; mais, dans tout paradis, il y a le serpent caché et les fruits défendus. Je distinguerai cinq catégories de vacances, ou du moins je leur donnerai cinq mentions, comme pour les études : il y a les vacances « Excellentes », les vacances « Bonnes », les vacances « Passables », les « Médiocres » et les « Mauvaises ».
Il s’arrêta et prit un air sévère, en détachant bien ses mots :
« Je ne permets que les bonnes, ou plutôt j’aime à croire que vous irez jusqu’aux excellentes. »
Pour les bonnes, Maurice avait dû recevoir un coup de genou sous le pupitre : par une turlupinade inconsciente, M. le supérieur l’exhortait à persévérer dans sa voie.
« Afin d’aider votre ferme propos, continua celui-ci, je vous ferai remettre, avec vos devoirs de vacances, un règlement de vacances, dont je vais vous donner lecture. Ainsi, après avoir assuré l’entretien de votre vie intellectuelle, nous préserverons votre vie morale. Ce petit catéchisme est complété, en outre, par un calendrier des fêtes liturgiques — votre vie religieuse également se poursuit hors du collège, je n’ai pas besoin de vous le répéter. »
Le supérieur prévoyait donc qu’il y avait des dangers. Il était plus perspicace en vacances qu’à Saint-Claude. Son règlement allait peut-être racheter ses statistiques et ses sonnets.
Georges regardait ses camarades. Le sérieux qu’ils continuaient d’affecter était légèrement ironique ; leur attitude témoignait déjà une certaine indépendance. Manifestement, ils prenaient au rebours ce règlement qu’on leur lisait avec tant de soin ; par-devers eux, ils en faisaient des gorges chaudes.
— « La paresse au lever compromet l’énergie du caractère : sans être aussi matineux qu’ici, soyez debout entre sept et huit heures, pas plus tard.
« Au moins trois fois la semaine, assistez à la sainte messe, et, si possible, communiez. Ne manquez, naturellement, ni à l’un ni à l’autre de ces devoirs les dimanches et fêtes, après vous être confessés la veille (assister aux vêpres, ces jours-là).
« Ensuite, ayez deux bonnes heures de travail, consacrés principalement aux devoirs de vacances et à des lectures instructives ou édifiantes, jamais à des lectures légères.
« Aux repas, n’oubliez pas le bénédicité, que vous réciterez à haute voix et même au nom de tous. À la fin, les grâces.
« Dans l’après-midi, une promenade en famille ou avec vos camarades de collège ou avec des amis sûrs et vertueux. Une petite visite dans une église, où vous entraînerez ceux qui sont avec vous.
« Il est indispensable que vous vous teniez en relations avec MM. les curés et MM. les vicaires. Mais vous ne négligerez pas, pour cela, d’écrire régulièrement à votre directeur de conscience.
« Après le dîner, vous irez vous reposer de bonne heure. Faites votre prière à genoux (au coucher et au lever), soit sur le lit, soit au pied du lit — pas dans votre lit, s’il vous plaît… »
Là-bas, Alexandre, les bras croisés, semblait écouter M. le supérieur d’un air, très convaincu. On eût dit qu’il ne pouvait avoir d’autres vacances que celles que l’on réglait si bien, divisées en trois : vie religieuse, vie intellectuelle, vie morale, avec les promenades en famille, les lettres au directeur de conscience, la visite à une église, la prière sur le lit ou au pied du lit. Et Alexandre pensait sans doute aux vacances qu’il avait réglées avec Georges, d’éternelles vacances qui seraient hors de tout cela — des vacances qui n’auraient jamais lieu.
Le soir, le surveillant se retira très tôt dans sa chambre, laissant régner la liberté. Il voulait que l’on conservât de lui un bon souvenir. Il savait, du reste, que son autorité avait expiré aujourd’hui. Il faisait comme à la baignade, quand il aimait mieux paraître distrait. On aurait pu entendre ce que disait chacun, si le bruit général des voix l’eût permis. Quelques-uns circulaient, prenant le frais. Pour un peu, on se serait cru en récréation.
Lucien s’était assis sur la table de chevet, ainsi que le faisait naguère le père de Trennes. Il appuyait sa tête au traversin de son ami. Georges lui avait appris les décisions du père Lauzon, sans ajouter combien elles avaient changé les siennes. Il lui avait avoué qu’il se résignait à obéir. Ils étaient d’accord, maintenant. Et ils se trouvaient peut-être les seuls, dans le dortoir, à converser à voix basse.
Lucien essayait, une dernière fois, de remettre les choses au point.
« Ce qui est advenu, dit-il, n’empêchera pas les Motier d’aller en vacances, que ce soit sur la Côte d’Azur, sur la Côte d’Argent ou sur la côte d’Adam. Maurice te renseignera. À lui, tu peux écrire, comme tu l’avais déclaré au petit. Et si tu crains à présent que le père Lauzon ne sonde les lettres après avoir sondé les cœurs, il te reste avec Maurice la ressource que tu avais également prévue, celle de la poste restante : lui n’est pas quelqu’un à s’en effaroucher.
« Puisque tu as le voyage facile, tu rejoindras Alexandre sans scandale et vous vous expliquerez librement. Le père Lauzon ne le suivra pas constamment par monts et par vaux, contre vent et marée, par les champs et par les grèves. Et tant pis s’il est là, le goupillon à la main, donnant la chasse à ces démons qui se cachent partout ! Tu as bien le droit d’y être aussi, toi qui es redevenu un ange. D’ailleurs, tu te mettras à couvert en séduisant la famille, ce qu’André fit pour moi. On en revient toujours au mot de l’autre : danser avec les mères. »
Lucien eut le mérite de faire sourire Georges un instant.
« Laissons les danses, dit celui-ci. La déception d’Alexandre sera affreuse. Il ne me pardonnera jamais d’avoir livré ses billets.
— Tu pourrais les déchirer, comme Isabelle déchire celui de Léandre. Tu serais bien avancé ! Sois tranquille : Alexandre ne se tuera pas si vite — un mauvais moment à passer, voilà tout. Dans ses démêlés avec le supérieur, tu avais agi presque contre son gré, et il n’en a pas moins compris que tu avais eu raison. Il comprendra qu’il était inutile de vous obstiner de nouveau à avoir tort, c’est-à-dire à braver l’humanité entière.
« Il est troisième de sa classe en histoire et n’ignore pas sans doute que les plus grands capitaines se font battre. Il convient seulement de se retirer avec les honneurs de la guerre, en attendant de recommencer. Cela semble le contraire de ce que le brave Hérodote te disait l’autre jour par ma bouche — « On réussit à force de tentatives » — mais tu vois bien que c’est la même chose. On cède, parce qu’on est sûr de se rattraper. N’est-ce pas pour cela que tu as cédé, que le supérieur a cédé, que le père Lauzon a cédé ? Le cher enfant aussi a cédé, malgré sa gentille bravoure : il n’a pas osé communier, il n’a pas bougé de l’étude, il ne t’a pas écrit (il n’a pas répondu au billet par lequel tu m’as dit que tu le calmais). Il s’est, de fait, rendu compte que votre amitié se passait de rendez-vous et de petite fleur bleue. Par conséquent, il sait d’avance qu’elle se passera d’autre chose : elle a des titres plus sérieux que vos papiers. Tu l’as constaté, lorsque au moment de votre brouille, je t’affirmais que l’incident n’était rien. Ce qui importe, ce n’est ni l’eau de roses ni l’eau bénite, c’est ce peu de sang que l’on a échangé.
— Un tel souvenir me commande justement le respect : je remettrai demain à Alexandre un dernier billet pour lui raconter toute l’histoire.
— Parfait ! Il y verra la preuve que tu l’aimes et se raccrochera aussitôt à son escampativos. Il devinera qu’au fond, tu voudrais t’enfuir, et il viendra te relancer, suivi de près par le père médecin et par le père confesseur, qui se réuniront en concile avec le père marquis. Je crains que votre situation ne soit alors un peu grotesque. Le supérieur t’a déjà averti qu’avec les gamins, il y avait à craindre le ridicule. Pis que cela : on vous fourrera tous deux dans une maison d’éducation surveillée — je veux dire : dans deux maisons différentes, bien entendu ! La sagesse est de te conformer à ce que Lauzon exige : il faut, en effet, que, pendant quelque temps, Alexandre croie que tu ne l’aimes plus — tout en croyant que tu l’aimes encore. C’est très compliqué, très désagréable, mais très nécessaire. »
Georges voyait, par la fenêtre ouverte, le ciel lumineux de juillet. Peut-être qu’en ce moment, Alexandre parlait de lui aux étoiles, rêvait déjà à un ciel étranger, faisait ses adieux aux nuits de Saint-Claude. Georges enviait à cet enfant ses illusions et sa confiance. Leur bonheur n’existait plus pour lui. Lucien laissait espérer un retour de fortune, mais lui s’efforçait vainement d’y croire : il avait cessé d’espérer. L’image du père Lauzon était toujours devant ses yeux. Sans pitié, elle offusquait celle d’Alexandre, que le père de Trennes, dans ce même lieu, avait quelquefois assombrie. La phrase de la version grecque n’avait qu’une portée limitée. Lucien venait d’ailleurs de reconnaître que si l’on réussit à force de tentatives, c’est également à force de tentatives que l’on échoue. Il avait approuvé, au nom de ce bon sens que le supérieur louait en lui, les mesures prises par le confesseur au nom de la morale. À la place d’une amitié incomparable, il n’y avait plus que de la morale et du bon sens. Ce qui avait commencé dans la gloire, dans la légende, dans la divinité, se terminait donc si platement, si tristement ! L’obéissance avait cessé d’être une ruse pour être un principe. Elle s’imposait au milieu de tant de désastres, en vue d’en prévenir un plus grand. Georges paraîtrait lâche, à titre de suprême châtiment. Après avoir trahi Lucien et le père de Trennes, il trahirait Alexandre : la fin couronnait l’œuvre.
Il se jugeait victime de la fatalité. Son amitié était soumise à une suite de lois préétablies, comme l’harmonie des mondes. C’est bien à elle que s’appliquait le vrai symbole de la Saint-Jean : semblable au soleil, elle descendait, mais ne remonterait plus. Les dieux, qui l’avaient favorisée, ne pouvaient rien eux-mêmes contre la Nécessité.
Du moins, Georges était-il reconnaissant à Lucien de l’avoir détourné d’écrire demain à Alexandre. Il aurait rougi d’apprendre sa défaite à un être qui, de l’aveu du père Lauzon, n’était soutenu que par lui. Lucien aurait estimé le cas plus embarrassant, s’il avait su qu’au lieu de calmer, le billet de Georges avait encouragé. Celui-ci ne semblerait-il pas, en faisant volte-face, avoir attendu l’heure du départ pour dire à l’enfant qu’il l’abandonnait ? Il voulait quitter le collège en emportant un sourire de tendresse et non un regard de mépris. C’est dans l’espoir de vivre qu’il avait cru quitter ce collège. Le premier choc lui avait montré ce que c’était vraiment que la vie. Il se voyait obligé de mentir à son amitié, comme on l’avait obligé à mentir pour la dernière composition de l’année. Il n’avait pas besoin de craindre des calembours sur son propre nom ; toutes les vérités finiraient dans le mensonge.
Le mot de Lucien lui revint à l’esprit : « Alexandre ne se tuera pas. » Certes, Georges n’avait jamais eu la prétention de faire tuer personne et encore moins Alexandre. Il n’avait vu mourir, d’aucune façon, aucun garçon de son âge, et l’idée de la mort ne lui rappelait que les périodes de Bossuet et les méditations du supérieur. Quant au suicide, ce n’était pour lui qu’un thème scolastique. Il songeait à la classe d’instruction religieuse où l’on avait parlé de ce sujet. Là aussi, il aurait fait la meilleure composition, s’il en avait eu licence. « Ceux qui se donnent la mort de propos délibéré » étaient inscrits sous le numéro quatre, dans la liste des sept cas entraînant le « refus de sépulture ecclésiastique ». Il y avait d’abord : « les païens, les juifs, les mahométans et les enfants morts sans baptême », « les apostats et les francs-maçons » et « les excommuniés ». Il y avait ensuite : « ceux qui ont péri en duel », « ceux qui ont laissé mandat d’incinérer leur cadavre » et « les pécheurs publics et manifestes ».
Tout le monde, dans le dortoir, était réveillé bien avant l’heure. Il est vrai que, ce matin, le lever officiel était plus tardif. Des élèves, accoudés à la fenêtre, recevaient les premiers rayons du soleil. D’autres se peignaient, assis sur leurs lits. Quelqu’un, en se mouchant, imitait « La Marseillaise ». Certains arrangeaient leurs malles. Georges pensait que, sans le savoir, il avait fait la sienne comme il fallait : elle était celle d’un collégien qui part pour les vacances et non pour toujours. Aucun motif ne devait l’empêcher de revenir à Saint-Claude, puisqu’il n’aurait pas la possibilité de retrouver ailleurs Alexandre. La situation était renversée par rapport au lendemain de la grande promenade, alors qu’Alexandre seul était censé pouvoir revenir.
Il n’y avait pas de méditation. On alla directement à la chapelle. La dernière messe de l’année était rouge, comme la première l’avait été. Georges regrettait que le cardinal, qui devait arriver tout à l’heure, ne célébrât pas sa messe au collège. Cela aurait terminé l’année convenablement : il y aurait eu un peu plus de rouge. Qu’est-ce que c’était que celui d’aujourd’hui ? Hier également, les ornements étaient rouges. Georges regarda son missel qu’il n’avait guère lu ces temps-ci : « 10 juillet, les Sept Frères Martyrs. 11 juillet, saint Pie. » Dans l’office des Sept Frères, il tomba sur ce texte : « Notre âme s’est échappée comme un oiseau des filets de l’oiseleur. Les filets se sont rompus et nous avons été délivrés. »
Petits et grands s’empressèrent à la communion : il fallait boucler dignement la statistique. Seul, Alexandre était resté à sa place lointaine — il croyait s’être affranchi déjà de tous les filets. Le salut du saint sacrement suivit la messe et se conclut par le chant du Te Deum. Peut-être d’autres élèves que Georges remerciaient-ils Dieu d’avoir réussi jusqu’au bout à duper leurs maîtres.
La salle des fêtes n’avait jamais été mieux remplie. Georges était assis à côté de ses parents. Il voyait le père Lauzon installé au premier rang, non loin de monseigneur, dans un des fauteuils verts, là où il était lui-même, le jour de la séance académique. Il évoquait la première alerte qu’il eût connue avec Alexandre, au lendemain de cette séance, et la représentation de Polyeucte, qui avait découvert leur amitié au père de Trennes. Aujourd’hui, il serait ici applaudi doublement, et c’était sur les ruines de cette amitié, en faveur de laquelle il avait tant combattu.
Il ne cherchait plus à voir l’enfant ni à être vu de lui. Et pourtant, leurs yeux s’étaient rencontrés tout de suite.
Le supérieur se leva, son discours à la main :
« Éminence, malgré les absorbements infinis de votre charge pastorale, vous avez tenu à revenir parmi nous, et nous mesurons tout le prix de l’honneur qui nous est fait. Hier encore, vous étiez à Lourdes, déposant aux pieds de Notre-Dame, l’action de grâces du diocèse et priant pour la France. Puissions-nous imiter cette activité infatigable d’une âme enflammée par les saintes causes de l’Église et de la patrie ! »
Puis, il fit l’éloge de la culture classique, qui aide notre pays, suivant le cas, à gagner des victoires et à se relever de ses défaites. « Une civilisation, dit-il, est une affaire d’âmes. Et la force des âmes finit par l’emporter sur celle de la matière. » Il se déclara satisfait des travaux de l’année, rappela les résultats brillants du baccalauréat, et, dans sa péroraison, adressa aux élèves un hommage collectif pour leurs efforts et leur piété : « Aussi, mes enfants, pouvons-nous vous rendre à vos chers parents avec le sentiment que vous avez mérité vos vacances et mieux encore : la bénédiction qu’avant de vous quitter, Son Éminence fera descendre sur vous au nom du Divin Maître : In nomine Domini.
— Amen », dit Lucien qui était derrière Georges.
Le préfet des grands donna lecture du palmarès. On applaudissait les principales mentions, coupées par le va-et-vient des bénéficiaires, qui allaient chercher leurs prix au pied de l’estrade. Cela était interminable. Enfin, arriva le tour de la classe de troisième : « Excellence : premier prix, Georges de Sarre… — Instruction religieuse… deuxième accessit, Georges de Sarre. » Mais les premiers prix revenaient en foule à Georges de Sarre : diligence (leçons et devoirs), composition française, version latine, version grecque, anglais ; le second prix en histoire, en thème latin et en thème grec. Malgré tous ses dégoûts, cela lui faisait plaisir : il était payé de sa peine.
À la distribution, il se rencontra avec Lucien, qui venait prendre un volume représentant à la fois le second prix de mathématiques et le second prix d’anglais. Ils s’étaient inclinés, l’un et l’autre, devant le cardinal, qui avait fait à Georges un petit signe gentil, en l’accompagnant de ces mots : « Très bien, très bien. Je féliciterai vos parents. » Le lauréat, en revenant à sa place, ne regarda pas Alexandre.
L’enfant n’eut rien que deux accessits, en français et en botanique. Georges aurait voulu se lever, l’appeler et lui dire : « C’est pour toi que j’ai désiré le plus avoir mes prix, je te les donne. » Mais, comme quelques instants plus tôt, il n’osait même lever la tête. Le déshonneur était son vrai prix, son unique prix. Le collège ne lui aurait pas épargné cette dernière opposition entre la réalité et les apparences.
Il feuilleta ses livres. Sous la couverture, une étiquette aux armes de Saint-Claude portait son nom, renforcé de ces mots : « Neuf fois couronné, dix fois cité. » Au reste, il n’avait pas plus neuf volumes que Lucien en avait eu deux, car les pères savaient grouper les prix. Il en avait quatre : Racine — hypothétiquement, allusion à l’acteur Léandre ; les Œuvres choisies de Henri de Bornier — il aurait préféré Henri de Régnier ; Cicéron et ses amis — « Georges et ses amis » ; enfin, comme prix de grec, Praxitèle — il ne manquait, en effet, que l’Amour de Thespies. Cet ouvrage était illustré, de même que le premier. Georges examina aussitôt la table des matières de son Praxitèle. Il était impatient de savoir si, au nombre des reproductions, il y avait celle qui l’intéressait : c’eût été une attention du supérieur. L’aimable gravure ne s’y trouvait pas.
La journée était d’importance pour les sœurs cuisinières. Traiter tant de monde, y compris un cardinal ! Mais il y avait aussi l’espoir de la bonne offrande que feraient tous les parents. Ceux de Georges étant arrivés par le train, ne pouvaient aller déjeuner là où d’ordinaire ils l’emmenaient. Ils s’étaient mis avec les parents de Lucien, dans la grande salle à manger, amusés d’avoir leur journée de collège. Ils seraient mieux que dehors, sous le préau, où l’on avait également dressé des tables. Georges et Lucien, bien complimentés, étaient montés au dortoir joindre à leur bagage palmarès et prix.
Lucien était joyeux. Tout lui souriait : l’an passé, il n’avait obtenu que des accessits, comme Alexandre cette fois ; dans quelques jours, il allait retrouver André à la montagne. Il lançait son livre en l’air, et le rattrapait après avoir battu des mains derrière le dos, singeant les petites filles qui jouent à la balle. C’était traiter bien irrespectueusement Le Génie du Christianisme, second prix d’anglais et de mathématiques. (Probablement que le père Lauzon avait voulu récompenser le congréganiste plutôt que le mathématicien, et qu’avec non moins de subtilité, le professeur d’anglais s’était rallié au choix d’un ouvrage écrit en Angleterre.) Le prix finit par tomber sur le parquet. Il s’était ouvert, présentant deux pages à la méditation du lauréat. Émule de Virgile, Chateaubriand faisait-il des prophéties ? Lucien éclata de rire devant le titre du chapitre : « Mœurs des oiseaux aquatiques. Bonté de la Providence. » M. de Quatrefages n’avait rien dit de la Providence au sujet des lézards.
Le cardinal daignait présider le repas au réfectoire. En quelques mots, M. le supérieur remercia Son Éminence. Puis, baissant le ton, comme si c’était entre les élèves et lui, il dit :
« Sachez, mes enfants, modérer votre gaieté, de manière à ne pas incommoder Monseigneur. »
Tous avaient répondu d’une voix vibrante : « Vive Monseigneur ! » Les conversations suivirent sur le mode chuchotant. Le contraste était si drôle avec la clameur précédente, que Monseigneur en parut amusé. On y vit la permission de se contraindre un peu moins. Il s’établit un moyen terme.
Alexandre se retournait souvent vers Georges et lui souriait. Il y avait tant d’exubérance que, certainement, le père Lauzon ne pouvait rien remarquer. Le rideau retombait déjà entre ces enfants et leurs maîtres. Monseigneur lui-même devait parler des vacances. Georges était sans doute le seul à penser à la rentrée. Il souffrait de se dire qu’il serait de nouveau dans ce réfectoire, et qu’Alexandre n’y serait pas.
En sortant de table, Georges demanda à Maurice s’il savait où il irait passer ses vacances.
« Elles ne seront pas fameuses, je le crains, répondit celui-ci. Il y a eu du grabuge entre mon frère et le père Lauzon, à propos de je ne sais quel micmac ; et sans doute resterons-nous à S… tout cet été. Je t’annonce, de plus, qu’on ne nous reverra pas à Saint-Claude. C’est décidé depuis ce matin avec mes parents. L’air d’ici ne nous valait rien. »
Il ajouta d’un ton plaisant :
« Nous allons reprendre la vie de famille. Tu sais ce que cela veut dire pour moi. »
Jamais Georges n’avait éprouvé si grande gêne. Parler de l’enfant après une telle évocation ! C’était commettre le même crime qu’avait commis Maurice lorsqu’il avait parlé de lui, après des confidences du même ordre et plus précises encore. Mais il n’y avait plus à réfléchir ni à hésiter. Baissant les yeux, Georges dit : « J’ai un service à te demander.
— Tu veux que je te laisse les vers de Richepin ?
— Il ne s’agit pas de ça. Tu te rappelles le jour où ton frère est venu dans la cour ? Eh bien, ensuite, nous sommes devenus amis, lui et moi. Je serais heureux de pouvoir lui écrire par ton entremise, à l’insu du père Lauzon. »
Maurice était bouche bée. Après un instant de silence, que Georges trouva bien long, il éclata de rire.
« Ah ! par exemple ! s’écria-t-il. Ainsi, la « crise », le « bossu », le « micmac », c’était toi ! »
Il dévisagea le major de sa classe d’un air qui le fit rougir, moins innocemment que lors de la remarque sur les cravates.
« À vos ordres, monsieur le comte », fit-il.
On eût dit qu’il voulait, par ses mots, lui rendre un peu d’assurance et s’avouer flatté de servir une intrigue de haut vol, autant peut-être que d’y voir engagé son cadet. Georges le regarda droit dans les yeux, comme Alexandre avait regardé le père Lauzon posant une question injurieuse.
« Mon amitié pour ton frère n’est pas ce que tu crois, déclara-t-il. Je t’en donne ma parole, et par conséquent, je te serai obligé de ne pas le tourmenter à ce sujet.
— Eh ! que votre amitié soit ce qu’elle voudra. Je m’en soucie comme du pape.
— Soucie-toi davantage du père Lauzon.
— Ne te tracasse pas : le supérieur m’a eu, mais l’autre ne m’aura pas. Même le père de Trennes y perdrait son grec et son latin. Je mets au défi la confrérie entière. »
Les Rouvère avaient à rendre visite au Tatou. En attendant la représentation, Georges proposa une promenade à ses parents. Rien ne le pressait : la séance débutait par Richard Cœur de Lion. Il voulait montrer le point de vue que l’on avait de la terrasse. Afin, dit-il, de raccourcir le chemin, il fit passer par le sentier et non par l’allée. Sa mère admira les beaux orangers. Il entra dans la serre. Près des gradins, il aperçut le bout d’une des cigarettes qu’il avait fumées avec l’enfant. Il l’écrasa du pied, comme il avait écrasé les glaïeuls, comme le père Lauzon avait écrasé les cigarettes dans la cabane.
Il crut rêver dès qu’il se retourna : au haut du sentier, venait de surgir son guide invisible. Alexandre apparaissait, léger, miraculeux, tel qu’il était apparu au premier rendez-vous, semblant avoir deviné ce dernier rendez-vous tacite. Il s’offrait à Georges, sur le théâtre de leurs anciens triomphes, le jour qui en marquait la fin. Doucement, il mit les doigts sur ses lèvres pour figurer un baiser, aussi discret que celui qu’il avait envoyé pendant la lecture au réfectoire. Maurice, qui le suivait, fit un signe d’intelligence. Le sourire de Georges s’effaça : avec les parents des deux frères, arrivait le père Lauzon. Celui-ci s’arrêta de parler. Était-il frappé de cette rencontre ? Si l’itinéraire de la promenade était dû à Alexandre, n’y devinerait-il pas un pèlerinage vers des souvenirs communs à Georges et à lui ? Au moment de les séparer, il apprenait ce que la serre du collège avait été pour eux. Cette journée, après celle de la grande promenade, achevait son instruction. Les deux amis lui confessaient, par l’effet du hasard, les rendez-vous qu’ils avaient eus ici-même, parfois au sortir de son confessionnal. Quelques minutes auparavant, il y aurait vu une pièce à conviction, désormais superflue.
Bientôt, Georges allait entrer en scène. Il pensait à faire exprès de rater son rôle, en manquant de mémoire et en estropiant les vers : ce serait la contrepartie de sa composition d’instruction religieuse, ratée par ordre. Quel bonheur, s’il faisait de la pièce un four ! Les Plaideurs paieraient pour le changement du page dans Richard Cœur de Lion. Léandre allait embarrasser Dandin, étonner le cardinal, désoler le supérieur — plus que ne l’avait fait le chanoine-doyen de la Pentecôte — consterner le préfet, se moquer de ces professeurs qui lui avaient donné tant de prix, mais qui n’en avaient pas donné à Alexandre. Il aurait voulu humilier le collège, qui perdait son plus bel ornement.
Il savait bien que ce n’étaient que des idées : ainsi que d’autres qu’il avait eues, il ne les accomplirait pas. Il songeait à jouer mal et jouerait du mieux possible. Il en avait contre Dandin, mais il se devait un peu à Isabelle. Il se devait surtout à Alexandre. Il ne lui rendrait pas un hommage si étrange et qui ne serait pas compris. L’enfant se sentirait diminué par ce ridicule. Il fallait le séduire jusqu’au bout, lui laisser une image heureuse de plus, jouer Les Plaideurs à son intention, encore mieux qu’on n’avait lu le discours sur l’Hôtel de Rambouillet et la vie de saint Bernardin.
C’est à l’intention du père Lauzon aussi que Georges décidait de bien jouer. L’homme qui avait tout prévu n’avait pas prévu ceci : que l’un des deux amis brillerait dangereusement devant l’autre, au lieu de se faire oublier. Il avait privé Alexandre de son rôle, mais il n’avait pas réfléchi que le rôle de Georges était quelque chose pour Alexandre. Il approuverait les confrères de M. Hamon d’avoir vitupéré la comédie.
Certains curés du voisinage, mis en goût par Polyeucte ou attirés par la présence du cardinal, étaient venus aux Plaideurs. Racine sembla les intéresser moins que Corneille. Peut-être aussi la présence de Monseigneur leur commandait-elle de se montrer plus retenus et de ne pas donner le signal des applaudissements. D’ailleurs, qu’auraient-ils pu applaudir avec la même confiance ? Un : « Plût à Dieu ! » et un : « Eh ! mon Dieu ! » de la comtesse, un : « Eh ! grand Dieu ! » de Léandre, deux ou trois : « Dieu sait si… » et le vers de Chicaneau :
Dans la crainte de Dieu, monsieur, et des sergents.
Encore MM. les curés devaient-ils être gênés d’entendre : « Que le diable m’emporte ? », « Va-t’en au diable ! » et expressions de cet acabit.
La représentation fut parfaite. Les acteurs firent merveille. Mais Léandre trouva que ses derniers mots étaient peu de saison :
… Ne parlons que de joie :
Grâce ! grâce ! mon père…
On prit, à la fin, la photographie en costumes qui avait été promise.
« Il me tarde de la recevoir, dit Lucien à son ami. Jusque-là, André ne croira jamais que j’aie joué Isabelle. Il sait que ce n’est pas mon genre. Mais que ne ferait-on pas pour toi ? »
Maintenant, Georges et lui se rendaient à la gare. Ils avaient décidé qu’une fois dans le train, ils fausseraient compagnie à leurs parents et iraient, comme à Pâques, d’une voiture à l’autre, à la recherche d’Alexandre. Malgré son accord avec Maurice sur le terrain épistolaire, Georges avait voulu se ménager avec l’enfant la possibilité d’une explication verbale. Il n’en avait pas moins promis à Lucien qu’il ne serait pas question de revenir au projet de fuite. Il était ému en arrivant à la station.
Sur le quai, le père Lauzon, son sac de voyage à la main, se tenait au milieu du même groupe que tantôt sur la terrasse. Le sort avait dit son dernier mot.
Le regard d’Alexandre croisa celui de son ami. Georges aurait souhaité périr devant lui à cette minute, où il n’avait pas encore démérité. Déjà, le train les divisait : ils montèrent chacun dans un wagon différent, dans une classe différente. Et bientôt, la vie dresserait entre eux une autre barrière, plus sûre que celle des divisions au collège.
Debout dans le couloir, Georges restait silencieux auprès de Lucien. Il songeait à Alexandre. Il contemplait les fils télégraphiques qui s’étiraient, se gonflaient tour à tour, pareils à l’écheveau que la Parque leur dévidait, à l’enfant et à lui, mêlant et remêlant leurs destinées, les élevant dans le ciel, les précipitant soudain vers la terre. Entre eux, l’irrémédiable était accompli, et Alexandre l’ignorait, comme André l’avait ignoré jusqu’à l’arrivée du préfet, le père de Trennes jusqu’à l’arrivée du supérieur. Sans doute l’enfant se consolait-il de la présence du père Lauzon, en se rappelant le regard échangé avec Georges, et qui, à son insu, était un adieu.
La gare de S… approchait. Le train glissait sur les aiguillages. S’il avait pu dérailler ! Alexandre s’éloignait, son imperméable au bras, et tenant à la main une valise légère, qu’il avait peut-être choisie exprès pour son prochain voyage. Il pensait certainement à bien des choses dont il ne se serait pas douté, la première fois que Georges l’avait vu descendre ici. Il semblait néanmoins tout aussi joyeux qu’alors. Il était plus beau que jamais, plus frais, plus alerte.
Avant la sortie, il se retourna, et, au même instant, un nuage de vapeur se rabattit sur le quai, enveloppant les voyageurs. Lorsque la fumée se fut dissipée, comme celle d’un sacrifice, l’enfant avait disparu.
| 1re partie | 2e partie | 3e partie |
| 4e partie | 5e partie |
Sources
- Les amitiés particulières : roman / Roger Peyrefitte. – Éd. définitive. – Paris : Librairie Générale Française, 1973 (La Flèche : impr. Brodard et Taupin). – 448 p. : couv. ill. en coul. ; 17 cm. – (Le livre de poche ; 3726). (fr)Rééditions en 1975 et 1978. – ISBN 2-253-00446-4 (broché)Texte de la quatrième partie, p. 287-394.
- Les amitiés particulières : roman / Roger Peyrefitte ; lithographies de Goor. – [Paris] : Flammarion, 1953 (J. Dumoulin ; Marcel Manequin, 10 mai 1953). – 2 vol., [8]-184 p.-12 pl., [8]-184 p.-12 pl. : 24 lithographies ; 29 × 20 cm. (fr)Tirage limité à 740 ex. numérotés (10 ex. numérotés de 1 à 10 avec une suite des lithographies tirées en bleu sur vergé crème des Papeteries de Rives et une suite des gravures refusées ; 20 ex. numérotés de 11 à 30 avec une suite des lithographies tirées en bleu sur vergé crème des Papeteries de Rives ; 700 ex. numérotés de 31 à 730 ; 10 ex. numérotés de I à X).6 lithographies de Gaston Goor, tirées du tome second.